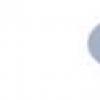Analyseur de goût, sa structure et ses fonctions. Sensibilité des récepteurs à différents types de stimuli gustatifs. Mécanisme de perception des stimuli gustatifs. Évaluation de la sensibilité gustative Découvrez ce qu'est la « sensibilité gustative » dans d'autres dictionnaires
Détermine la formation des sensations gustatives et constitue une zone réflexogène. À l'aide d'un analyseur de goût, diverses qualités des sensations gustatives et la force des sensations sont évaluées, qui dépendent non seulement de la force de l'irritation, mais également de l'état fonctionnel de l'organisme.
Caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'analyseur de goût.
Département périphérique. Les récepteurs gustatifs (cellules gustatives avec microvillosités) sont des récepteurs secondaires ; ils constituent un élément des papilles gustatives, qui comprennent également les cellules de soutien et basales. Les papilles gustatives contiennent des cellules contenant de la sérotonine et des cellules qui produisent de l'histamine. Ces substances et d’autres jouent un certain rôle dans la formation du sens du goût. Les papilles gustatives individuelles sont des structures multimodales, car elles peuvent percevoir différents types de stimuli gustatifs. Les papilles gustatives sous forme d'inclusions séparées sont situées sur la paroi arrière du pharynx, du palais mou, des amygdales, du larynx, de l'épiglotte et font également partie des papilles gustatives de la langue en tant qu'organe du goût.
La section périphérique de l'analyseur de goût est présentée Papilles gustatives, qui se situent principalement dans les papilles de la langue. Les cellules gustatives sont parsemées à leurs extrémités de microvillosités, également appelées goûter les poils. Ils atteignent la surface de la langue par les pores gustatifs.
La cellule gustative possède un grand nombre de synapses qui forment des fibres corde de tambour Et nerf glossopharyngé. Les fibres de la corde tympanique (une branche du nerf lingual) se rapprochent de toutes les papilles fongiformes, et les fibres du nerf glossopharyngé se rapprochent des papilles rainurées et foliées. L'extrémité corticale de l'analyseur de goût est située dans l'hippocampe, le gyrus parahippocampique et dans la partie inférieure du gyrus central postérieur.
Les cellules gustatives se divisent et meurent continuellement. Le remplacement des cellules situées dans la partie antérieure de la langue, là où elles se trouvent plus superficiellement, se produit particulièrement rapidement. Le remplacement des cellules des papilles gustatives s'accompagne de la formation de nouvelles structures synaptiques
Département de câblage. La papille gustative contient des fibres nerveuses qui forment des synapses afférentes aux récepteurs. Les papilles gustatives de différentes zones de la cavité buccale reçoivent des fibres nerveuses provenant de différents nerfs : les papilles gustatives des deux tiers antérieurs de la langue - de la corde tympanique, qui fait partie du nerf facial ; les reins du tiers postérieur de la langue, ainsi que le palais mou et dur, les amygdales - du nerf glossopharyngé ; Les papilles gustatives, situées dans le pharynx, l'épiglotte et le larynx, proviennent du nerf péglottique supérieur, qui fait partie du nerf vague.
Ces fibres nerveuses sont des processus périphériques des neurones bipolaires situés dans les ganglions sensoriels correspondants, qui représentent le premier neurone de la section de conduction de l'analyseur gustatif. Les processus centraux de ces cellules font partie d'un seul faisceau de la moelle oblongate, dont les noyaux représentent le deuxième neurone. De là, les fibres nerveuses du lemnisque médial se rapprochent du thalamus visuel (troisième neurone).
Département central. Les processus des neurones thalamiques vont au cortex cérébral (quatrième neurone). La section centrale, ou corticale, de l'analyseur gustatif est localisée dans la partie inférieure de la zone somatosensorielle du cortex au niveau de la langue. La plupart des neurones de cette zone sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils répondent non seulement au goût, mais aussi à la température, aux stimuli mécaniques et nociceptifs. Le système sensoriel gustatif est caractérisé par le fait que chaque bourgeon gustatif possède non seulement des fibres nerveuses afférentes, mais également efférentes, qui se rapprochent des cellules gustatives du système nerveux central, ce qui assure l'inclusion de l'analyseur gustatif dans l'activité intégrale du corps.
Mécanisme de perception du goût. Pour qu’une sensation gustative se produise, la substance irritante doit être dissoute. Une substance au goût sucré ou amer, se dissolvant en molécules dans la salive, pénètre dans les pores des papilles gustatives, interagit avec le glycocalyx et est adsorbée sur la membrane cellulaire des microvillosités, dans lesquelles le récepteur « détectant le sucré » ou « détectant l'amer » les protéines sont construites. Lorsqu'il est exposé à des substances au goût salé ou aigre, la concentration d'électrolytes à proximité de la cellule gustative change. Dans tous les cas, la perméabilité de la membrane cellulaire des microvillosités augmente, le mouvement des ions sodium dans la cellule se produit, une dépolarisation de la membrane se produit et la formation d'un potentiel récepteur, qui se propage à la fois le long de la membrane et à travers le système microtubulaire de la cellule gustative à sa base. A ce moment, un médiateur (acétylcholine, sérotonine et éventuellement substances de type hormonal de nature protéique) se forme dans la cellule gustative, ce qui dans la synapse afférente au récepteur conduit à l'émergence d'un potentiel générateur, puis d'un potentiel d'action. dans les sections extrasynaptiques de la fibre nerveuse afférente.
Perception des stimuli gustatifs. Les microvillosités des cellules gustatives sont des formations qui perçoivent directement un stimulus gustatif. Le potentiel membranaire des cellules gustatives varie de -30 à -50 mV. Lorsqu'il est exposé à des stimuli gustatifs, un potentiel de récepteur de 15 à 40 mV apparaît. Il s'agit d'une dépolarisation de la surface de la cellule gustative, qui provoque l'apparition d'un potentiel générateur dans les fibres de la corde tympanique et du nerf glossopharyngé, qui se transforme en impulsions de propagation lorsqu'il atteint un niveau critique. Depuis la cellule réceptrice, l'excitation est transmise par la synapse à la fibre nerveuse à l'aide de l'acétylcholine. Certaines substances, comme le CaCl 2, la quinine, les sels de métaux lourds, ne provoquent pas de dépolarisation primaire, mais une hyperpolarisation primaire. Son apparition est associée à la mise en œuvre de réactions négatives rejetées. Dans ce cas, aucune impulsion de propagation ne se produit.
Sensibilité des récepteurs à différents types de stimuli gustatifs.
Différentes cellules gustatives ont une sensibilité différente aux différentes substances gustatives, qui sont divisées en quatre groupes : acide, salé, sucré, amer. Chaque cellule réagit toujours à plus d'une substance gustative, parfois même aux quatre, mais est plus sensible à l'une d'entre elles. En conséquence, selon l'emplacement des cellules présentant une sensibilité particulièrement élevée à un stimulus gustatif particulier, différentes parties de la langue ont également une sensibilité différente.
Il a été établi que le bout de la langue et son tiers antérieur sont les plus sensibles aux sucreries, où se trouvent les papilles en forme de champignon, les surfaces latérales - à l'aigre et au salé (papilles en forme de feuille) et la racine de la langue. - à amer (papilles vallates, ou papilles gustatives entourées d'une tige).
Les cellules gustatives sont caractérisées par des fluctuations du seuil de stimulation et une nature différente de la réponse aux mêmes stimuli dans différentes conditions. Leur excitabilité dépend d'influences constantes les unes sur les autres, ainsi que de l'état des récepteurs du tube digestif, des récepteurs olfactifs, etc. Normalement, il existe un certain « réglage » des récepteurs gustatifs en fonction de l'état du corps, notamment. l'état de satiété.
GOÛT ET ODEUR
X. Altner, I. Beck
13.1. Caractéristiques des sensations chimiques
Les sensations gustatives et odorantes sont provoquées par une réaction sélective et très sensible de cellules sensorielles spécialisées à la présence de molécules de certains composés. De manière plus générale, des réponses spécifiques à des produits chimiques, tels que les hormones ou les neurotransmetteurs, sont caractéristiques de nombreuses cellules et tissus. Cependant, les cellules sensorielles gustatives et olfactives agissent comme extérocepteurs ; leurs réactions fournissent des informations importantes sur les stimuli externes, traités par des zones spéciales du cerveau responsables des sensations correspondantes. D'autres cellules chimioréceptrices servent d'intérocepteurs, déterminant par exemple le niveau de CO 2 (section 21.6).
Le goût et l'odorat peuvent être caractérisés et distingués sur la base de critères morphologiques et physiologiques. Les différences entre ces deux types de sensations sont plus évidentes lorsque l'on compare les types (qualités) de stimuli qui leur conviennent (tableau 13.1). D'autres caractéristiques, comme la sensibilité aux stimuli ou la condition physique de ces derniers, bien que généralement différentes, peuvent également se chevaucher.
Comparés aux autres sens, le goût et l’odorat ont une adaptabilité nettement plus élevée (cf. Fig. 8.5). Avec une exposition prolongée à un stimulus, l'excitation dans les voies afférentes est sensiblement affaiblie et la perception est en conséquence affaiblie ; par exemple, très vite dans un environnement même avec une odeur forte on cesse de la ressentir. Une sensibilité élevée à certains stimuli est également caractéristique des sensations chimiques. Dans le même temps, la gamme d’intensités de stimulation distinguables est relativement petite (1 : 500) et le seuil de discrimination est élevé. Exposant dans la fonction puissance de Stevensψ = k(φ - φо)unégal à 0,4–0,6 pour l’odeur et à environ 1 pour les stimuli gustatifs (cf. Fig. 8.14).
Procédés primaires et spécificité chimique .
Le premier événement lors de la stimulation des chimiorécepteurs est, selon les concepts modernes, une interaction chimique basée sur la faible liaison d'une molécule adéquate à protéine réceptrice. Protéines aux propriétés enzymatiques, substrat
dont la spécificité et les propriétés cinétiques sont les mêmes que celles des récepteurs eux-mêmes. Les événements ultérieurs conduisant à la réponse électrique de la membrane cellulaire sont inconnus. Chaque cellule réceptrice réagit de manière très sélective à un groupe spécifique de substances. Les moindres changements dans la structure d’une molécule peuvent modifier la façon dont elle est perçue ou en faire un stimulus inapproprié. Le pouvoir stimulateur d’un composé dépendra probablement de manière plus significative de sa taille (c’est-à-dire la longueur de la chaîne) et de la distribution interne des charges électriques (c’est-à-dire la disposition des groupes fonctionnels). Cependant, le fait que dans de nombreux cas des molécules de substances de structure chimique très différente provoquent les mêmes sensations olfactives n'a pas encore été expliqué. Par exemple, les trois substances ci-dessous, malgré leurs différences structurelles, ont la même odeur musquée (voir ci-dessous). Betteraves dedans).
Il a été suggéré que les chimiorécepteurs contiennent centres récepteurs, spécifique à certains groupes de substances. Ce point de vue est confirmé par des cas d'anosmie partielle, c'est-à-dire d'insensibilité à l'odeur de certains composés chimiques très proches. L’effet sélectif de certains médicaments sur l’organe du goût peut être interprété de la même manière. Appliquer du gymnémate de potassium (une substance isolée d'une plante indienne) sur la langueGymnéma Sylvestre) conduit à la perte uniquement de la perception du sucré – le sucre provoque une sensation granuleuse dans la bouche. Protéine contenue dans les fruits d'une plante d'Afrique de l'OuestSynsépale dulcificum, change le goût aigre en sucré, de sorte que le citron est perçu comme une orange (voir. Kurihara V). L'application de cocaïne sur la langue entraîne une perte séquentielle des quatre types de sensations gustatives : amère, sucrée, salée et, enfin, aigre.
Tableau 13.1.Classification et caractéristiques des sensations chimiques
|
Goût |
Odeur |
|
|
Récepteurs |
Cellules sensorielles secondaires |
Cellules sensorielles primaires ; l'obtention du diplôme |
|
Localisation du récepteur |
Langue |
Nerfs crâniens V, IX et X, Nez et pharynx |
|
Nerfs crâniens afférents |
VII, IX |
I, V, IX, X |
|
Niveaux de commutation synaptique dans le système nerveux central |
1. Médulla oblongate 2. Thalamus ventral 3. Cortex (gyrus postcentral) C connexions avec l'hypothalamus |
1. Bulbe olfactif 2. Télencéphale (cortex prépiriforme) Connexions avec le système limbique et l'hypothalamus |
|
Des incitations adéquates |
Molécules de substances organiques et inorganiques, principalement non volatiles. Source de stimuli – à proximité des récepteurs ou en contact direct avec eux |
Presque exclusivement des molécules de substances organiques volatiles en phase gazeuse, se dissolvant uniquement à proximité du récepteur. La source des stimuli est généralement supprimée |
|
Nombre de stimuli qualitativement distinguables |
Peu (4 principaux) |
Un très grand nombre (des milliers) de qualités mal définies |
|
Sensibilité absolue |
Relativement faible (Pas moins de 10 16 molécules dans 1 ml de solution) |
Très élevé pour certaines substances (10 7 molécules, chez les animaux – jusqu'à 10 2 – 10 3 molécules pour 1 ml d'air) |
|
Caractéristiques biologiques |
Sensation de contact. Utilisé pour évaluer la qualité des aliments, réguler leur consommation et leur digestion (réflexes salivaires) |
Sentiment lointain. Utilisé pour l'évaluation hygiénique de l'environnement et des aliments ; chez les animaux – pour la recherche de nourriture, la communication et le comportement sexuel. Comprend une forte composante émotionnelle |
Chez les adultes cellules sensorielles du goût situé à la surface de la langue. Avec les cellules de soutien, elles forment des groupes de 40 à 60 dans l'épithélium de ses papilles. éléments – papilles gustatives(Fig. 13.1). Les grandes papilles entourées d'une crête à la base de la langue contiennent chacune jusqu'à 200 papilles gustatives ; dans les papilles plus petites en forme de champignon et de feuille sur ses surfaces antérieures et latérales, il n'y en a que quelques-unes. Au total, un adulte possède plusieurs milliers de papilles gustatives. Glandes, situées entre les papilles, elles sécrètent un liquide qui lave les papilles gustatives. Les parties distales des cellules réceptrices (sensorielles), sensibles à la stimulation, forment microvillosités, sortant dans une chambre commune, qui communique avec l'environnement extérieur par un pore à la surface de la papille (Fig. 13.1). Les molécules stimulantes diffusent à travers ce pore et atteignent les cellules gustatives (récepteurs).
Comme d’autres cellules sensorielles secondaires, les cellules gustatives génèrent un potentiel de récepteur lorsqu’elles sont stimulées. Cette excitation est transmise synaptiquement fibres afférentes
Riz. 13.1.Schéma d'une papille gustative incrustée dans la papille de la langue ; montrant les cellules basales, sensorielles, de soutien et les fibres afférentes du nerf crânien correspondant
nerfs crâniens, qui le conduisent au cerveau sous forme d'impulsions. Ce processus implique : la corde tympanique est une branche du nerf facial(VII), innervant les parties antérieure et latérale de la langue, et nerf glossopharyngé(IX), innervant sa partie postérieure (Fig. 13.2). En se ramifiant, chaque fibre afférente reçoit des signaux des récepteurs des différentes papilles gustatives.

Riz. 13.2.Schéma du langage humain. Son innervation par divers nerfs crâniens est mise en évidence par la coloration ; Les zones de répartition des différents types de papilles sont délimitées (1 – en forme de champignon, 2 – entourée d'une crête, 3 – en forme de feuille). La localisation des zones de perception de certaines qualités gustatives est représentée par des icônes
Sont remplacéscellules gustatives très rapidement ; La durée de vie de chacun d'eux n'est que d'environ 10 jours, après quoi un nouveau récepteur est formé à partir de la cellule basale. Il établit une connexion avec les fibres afférentes de telle sorte que leur spécificité ne change pas. Le mécanisme qui assure cette interaction n’est toujours pas clair (voir. Oakley dans).
Réactions des cellules dans les fibres . Célibataire cellule gustative dans la plupart des cas, il réagit à des substances représentant des qualités gustatives différentes, en étant dépolarisées ou hyperpolarisées par celles-ci (Fig. 13.3). L'amplitude du potentiel du récepteur augmente avec la concentration de la substance stimulante. Le type et l'amplitude de la réponse sont également influencés par l'environnement (Fig. 13.4).
Le potentiel générateur provoque un niveau approprié d'excitation des fibres afférentes, formant une réaction appelée « profil gustatif » (Fig. 13.5). Leur impulsion dépend de la réaction des récepteurs comme suit : la dépolarisation de ces derniers a un effet excitateur, l'hyperpolarisation a un effet inhibiteur.
De nombreuses fibres de la paire IX de nerfs crâniens réagissent particulièrement fortement aux substances au goût amer. Les fibres du couple VII sont plus fortement excitées par l'action du salé, de l'aigre-doux : certaines d'entre elles réagissent plus fortement au sucre qu'au sel, d'autres au sel qu'au sucre, etc. Ces caractéristiques spécifiques au goût

Riz. 13.3.Enregistrements intracellulaires des potentiels récepteurs de deux cellules gustatives (a, b) de la langue du rat. Stimuli : 0,5 mol/L de NaCI ; 0,02 mol/l de chlorhydrate de quinine ; 0,01 mole/l HCI et 0,5 mol/l de saccharose. La durée de chaque stimulus est affichée segment horizontal(Par Sato, Beidler avec modifications)

Riz. 13.4. Influence de l'environnement sur la forme et l'amplitude des enregistrements intracellulaires du potentiel récepteur d'une seule cellule gustative de la langue du rat stimulée par 0,02 mol/l de chlorhydrate de quinine. Environnement : a – 41,4 mmol/l NaCI ; b–eau distillée (selon Sato, Beidler avec modifications)

Riz. 13.5.Réponses de deux fibres simples de la corde tympanique du rat à diverses substances : 0,1 mol/l de NaCI ;
0,5 mole/l de saccharose ; 0,01 n. HCI ; 0,02 mol/l de chlorhydrate de quinine (modifié)
différents groupes d'afférents fournissent des informations sur la qualité gustative, ceux. forme d'une molécule stimulante, et le niveau général d'excitation d'une certaine population d'entre elles est d'environ l'intensité du stimulus, c'est-à-dire sur la concentration d'une substance donnée.
Neurones centraux. Fibres aromatiques VII et IX des paires de nerfs crâniens se terminent à l'intérieur ou à proximité de noyaux du tractus solitaire ( noyau solitaire ) moelle oblongate. Ce noyau, via le lemniscus médial (lemniscus médial), est relié à thalamus dans sa région noyau postéro-médial ventral. Les axones des neurones du troisième ordre traversent la capsule interne et se terminent par gyrus postcentralcortex cérébral. DANS En raison du traitement de l'information aux niveaux ci-dessus, le nombre de neurones dotés d'une sensibilité gustative très spécifique augmente. Un certain nombre de cellules corticales ne réagissent qu'à des substances ayant une seule qualité gustative. La localisation de ces neurones indique un degré élevé d’organisation spatiale du sens du goût. D'autres cellules de ces centres réagissent non seulement au goût, mais aussi à la température et à la stimulation mécanique de la langue.
Qualités gustatives . Une personne distingue quatre qualités gustatives principales : sucré, aigre, amer et salé, qui sont assez bien caractérisés par leurs substances typiques (tableau 13.2). Le goût sucré est principalement associé aux glucides naturels tels que le saccharose et le glucose ; chlorure de sodium – salé ; d'autres sels, par ex. KCI , sont perçus comme salés et amers à la fois. Tel sentiments partagés sont caractéristiques de nombreux stimuli gustatifs naturels et correspondent à la nature de leurs composants. Par exemple, l'orange est aigre-douce et le pamplemousse
Tableau 13.2.Substances au goût caractéristique et efficacité de leurs effets sur l'homme ( Pfaffmann dans )
|
Qualité |
Substance |
Seuil de perception, mol/l |
|
Gorkoé |
Sulfate de quinine |
0,000008 |
|
Nicotine |
0,000016 |
|
|
Aigre |
Acide hydrochlorique |
0,0009 |
|
Acide de citron |
0,0023 |
|
|
Doux |
Saccharose |
0,01 |
|
Glucose |
0,08 |
|
|
Saccharine |
0,000023 |
|
|
Salé |
NaCI |
0,01 |
|
CaCl2 |
0,01 |
aigre-doux-amer. Les acides ont un goût aigre ; de nombreux alcaloïdes végétaux sont amers.
A la surface de la langue on peut distinguer zones de sensibilité spécifique. Le goût amer est perçu principalement base langue; d'autres qualités gustatives l'affectent surfaces latérales Et conseil, De plus, ces zones se chevauchent (Fig. 13.2).
Entre propriétés chimiques substances et leurs goût il n’y a pas de corrélation directe. Par exemple, non seulement le sucre, mais aussi les sels de plomb sont sucrés, et le goût le plus sucré se trouve dans les substituts artificiels du sucre tels que la saccharine. De plus, qualité perçue la substance dépend de sa concentration. Le sel de table a un goût sucré à faible concentration et ne devient purement salé que lorsque la concentration augmente. La sensibilité aux substances amères est nettement plus élevée. Comme ils sont souvent toxiques, cette caractéristique nous met en garde contre un danger, même si leur concentration dans l'eau ou les aliments est très faible. De puissants irritants amers provoquent facilement vomissement ou la presse.Composantes émotionnelles les sensations gustatives varient considérablement selon l'état du corps. Par exemple, une personne souffrant d’une carence en sel considère le goût comme acceptable, même si sa concentration dans l’aliment est si élevée qu’une personne normale refuserait cet aliment.
Les sensations gustatives sont évidemment très similaires chez tous les mammifères. Des expériences comportementales ont montré que divers animaux possèdent les mêmes qualités gustatives que les humains. Cependant, l’enregistrement de l’activité de fibres nerveuses individuelles a également révélé certaines capacités qui manquent aux humains. Par exemple, des chats ont été trouvés "fibres d'eau" soit en répondant uniquement à la stimulation de l'eau, soit en présentant un profil gustatif qui inclut l'eau parmi les stimuli efficaces (voir Sato dans ).
Signification biologique . Le rôle biologique des sensations gustatives n'est pas seulement vérifier la comestibilité des aliments(voir au dessus); ils affectent également le processus de digestion. Les connexions avec les efférents végétatifs permettent aux sensations gustatives d'influencer la sécrétion des glandes digestives, non seulement sur son intensité, mais aussi sur sa composition, selon par exemple si les substances sucrées ou salées prédominent dans les aliments.
Avec l'âgela capacité de distinguer le goût est réduite. Cela est également dû à la consommation de substances biologiquement actives telles que la caféine et au tabagisme excessif.
La surface de la muqueuse nasale est agrandie en raison des cornets nasaux, des crêtes qui dépassent des côtés dans la lumière de la cavité nasale. Espace olfactif contenant la plupart des cellules sensorielles,

Riz. 13.6.Schéma des cavités du nasopharynx humain (coupe sagittale). La région olfactive est limitée par les conques supérieures et moyennes. Les zones innervées par les nerfs trijumeau (V), glossopharyngé (IX) et vague (X) sont représentées.
limitée ici par la conque nasale supérieure, bien que celle du milieu contienne également de petits îlots d'épithélium olfactif (Fig. 13.6).
Le récepteur olfactif est une cellule sensorielle bipolaire primaire, à partir de laquelle s'étendent deux processus : au sommet - une dendrite portant cils, de la base de l'axone. Les cils, dont la structure interne est différente de celle des kinocils ordinaires, sont immergés dans une couche de mucus recouvrant l'épithélium olfactif et ne sont pas capables de bouger activement. Les substances odorantes transportées dans l'air inhalé entrent en contact avec leur membrane, site d'interaction le plus probable entre la molécule stimulante et le récepteur. Les axones se dirigeant vers le bulbe olfactif sont réunis en faisceaux ( fila olfactive ). De plus, toute la muqueuse nasale contient des terminaisons libres nerf trijumeau, et certains d'entre eux réagissent également aux odeurs. Dans le pharynx, les stimuli olfactifs sont capables d'exciter les fibres des nerfs glossopharyngé et vague (Fig. 13.6). La couche de mucus recouvrant l'épithélium olfactif le protège du dessèchement et se renouvelle constamment grâce à la sécrétion et à la redistribution des kinocils.
Les molécules de substances odorantes pénètrent aux récepteurs (cellules sensorielles) périodiquement : lors de l'inhalation par les narines et, dans une moindre mesure, depuis la cavité buccale, en diffusant à travers les choanes. Ainsi, en mangeant, nous éprouvons des sensations mixtes qui allient le goût et l’odeur des aliments.

Riz. 13.7.Enregistrement simultané de l'électroolfactogramme (Ligne rouge) et les potentiels d'action d'un seul récepteur dans l'épithélium olfactif de la grenouille lors d'une stimulation par le nitrobenzène. Durée du stimulus (segment noir)–1 s ( Gesteland en )
Le reniflement, comportement caractéristique de nombreux mammifères, augmente considérablement le flux d'air vers la muqueuse olfactive et, par conséquent, la concentration de molécules stimulantes dans celle-ci.
Au total, une personne possède environ 10 7 récepteurs dans la zone olfactive d'une superficie d'environ 10 cm 2. Chez d'autres vertébrés, il y en a beaucoup plus (chez le berger allemand, par exemple, 2,2–10 8). Les cellules olfactives, comme les cellules gustatives, sont constamment remplacées et, de ce fait, elles ne fonctionnent apparemment pas toutes en même temps.
Les électrodes placées sur l'épithélium olfactif des vertébrés enregistrent des potentiels lents de forme complexe avec une amplitude de plusieurs millivolts lorsqu'elles sont exposées à une odeur. Ces électroolfactogrammes(EOG, fig. 13.7, voir Ottoson c), comme les électrorétinogrammes (ERG), reflètent l'activité totale de nombreuses cellules et ne fournissent donc pas d'informations sur les propriétés des récepteurs individuels. Enregistrer l'activité récepteur unique dans la muqueuse olfactive des vertébrés, cela n'a été possible que par hasard (Fig. 13.7). Il a été démontré que l’activité spontanée de ces cellules est très faible (plusieurs impulsions par seconde) et que chacune d’elles réagit à diverses substances. Comme pour le profil aromatique, on peut construire éventail de réponses récepteur olfactif unique (voir Gesfeland dans).
Une personne peut distinguer l’odeur de milliers de substances différentes. Les sensations olfactives peuvent être classées selon certaines similitudes, révélant certaines les types, ou qualité, odeur. Cependant, cela est beaucoup plus difficile à réaliser que dans le cas des sensations gustatives. L'incertitude des catégories est également évidente dans le fait que les classifications proposées par les différents auteurs ne sont pas les mêmes. La corrélation entre la structure chimique et la qualité de l’odeur est encore plus faible que pour les stimuli gustatifs. Tableau 13.3 montre que les classes d'odeurs sont généralement nommées d'après leur nature
Tableau 13.3.Caractéristiques distinctives des classes d'odeurs ( Amoor, Skramlik)
|
Classe d'odeur |
Substances typiques connues |
Similitude avec l'odeur |
Origine « standard » |
|
Floral |
Géraniol |
Des roses |
d –1-β-phényléthylméthylcarbinol |
|
Éthéré |
Acétate de benzyle |
Des poires |
1,2-dichloroéthane |
|
Musqué |
Muscon |
musc |
3-méthylcyclopentadécane-1-one |
|
Camphre |
Cinéole, camphre |
Eucalyptus |
1,8-cinéole |
|
Putréfié |
Sulfure d'hydrogène |
Oeufs pourris |
Sulfure de diméthyle |
|
Caustique |
Acide formique, acide acétique |
Vinaigre |
Acide formique |
sources ou substances typiques ; chaque catégorie peut également être caractérisée par une source « standard ».
La base neurophysiologique permettant d'attribuer les odeurs à une classe ou à une autre n'a pas encore été découverte. Le point de vue selon lequel les groupes qui combinent des substances ayant des odeurs similaires diffèrent d'une certaine manière les uns des autres est confirmé par des cas d'altération partielle de l'odorat. (anosmie partielle). Avec de tels défauts (au moins certains d'entre eux sont de nature génétique), le seuil de perception de certains stimuli olfactifs augmente. De plus, cela change souvent pour plusieurs substances qui appartiennent généralement à la même classe d'odeurs. Les données expérimentales utilisées pour classer les odeurs peuvent être obtenues en analysant adaptation croisée. Cela réside dans le fait que lorsqu'une exposition prolongée à une odeur provoque une augmentation du seuil de sa perception, la sensibilité à l'odeur de certaines autres substances diminue également (Fig. 13.8). En étudiant quantitativement ces changements mutuels de seuils, il est possible de construire un diagramme de relations d'adaptation croisée (Fig. 13.9). Cependant, cela ne suffit pas pour une classification univoque et détaillée de nombreuses substances odorantes selon les sensations qu’elles provoquent.
Lors de l'interprétation des caractéristiques de l'odorat humain, il convient de garder à l'esprit que les terminaisons sont également sensibles aux substances odorantes. nerf trijumeau dans la muqueuse nasale, ainsi que glossopharyngé Et nerf vague dans la gorge. Tous participent à la formation de la sensation olfactive (Fig. 13.6). Leur rôle, qui n'a aucun lien avec le nerf olfactif, reste le même lorsque la fonction de l'épithélium olfactif est altérée en raison, par exemple, d'une infection (grippe), de tumeurs (et d'opérations cérébrales associées) ou de traumatismes crâniens. Dans de tels cas, unis par le terme hyposmie, le seuil de perception est nettement supérieur à la normale, mais la capacité de distinguer les odeurs n'est que légèrement réduite. Dans l'hypogonadisme hypophysaire (syndrome de Kalman), l'odorat est assuré exclusivement par ces nerfs crâniens, car dans cette maladie congénitale se produit une aplasie des bulbes olfactifs. Des températures et des expositions chimiques nocives peuvent provoquer une hyposmie ou une anosmie aiguë ou chronique, réversibles ou irréversibles, selon la nature et la voie d'exposition. Enfin, la sensibilité aux odeurs diminue avec l'âge.
L'odorat humain est très sensible, même si l'on sait que chez certains animaux, cet appareil est encore plus avancé. Dans le tableau 13.4 montre les concentrations de deux substances odorantes suffisantes pour provoquer les sensations correspondantes chez une personne. Lorsqu’elle est exposée à de très petites quantités, la sensation qui en résulte n’est pas spécifique ; Ce n’est qu’après avoir dépassé un certain seuil que l’odeur est non seulement détectée, mais également reconnue. Par exemple, le skatole a une odeur tout à fait acceptable à faibles concentrations ; à des niveaux plus élevés, c'est répugnant. Il faut donc distinguer seuil de détection et seuil de reconnaissance odeur.
De tels seuils, déterminés à partir des réponses des sujets ou des réactions comportementales des animaux, ne permettent pas d'établir sensibilité d'une seule cellule sensorielle(récepteur). Cependant, connaissant l’étendue spatiale de l’organe olfactif humain et le nombre de récepteurs qui le composent, il est possible de calculer leur sensibilité. De tels calculs montrent qu'une seule cellule sensorielle se dépolarise et génère un potentiel d'action en réponse à une ou au plus plusieurs molécules d'un odorant. Bien entendu, une réponse comportementale nécessite l’activation d’un nombre important de récepteurs, c’est-à-dire dépasser un certain niveau critique du rapport signal sur bruit dans les fibres afférentes.
Codage.Le codage des stimuli olfactifs par les récepteurs ne peut jusqu’à présent être décrit qu’en première approximation. Premièrement, une cellule sensorielle individuelle est capable de réagir à de nombreuses odeurs différentes. Deuxièmement,

Riz. 13.8.Augmentation de l'intensité de la sensation avec l'augmentation de l'intensité de la stimulation (propanol) sans adaptation (noir droit) et après adaptation au pentanol (courbe rouge avec triangles noirs) ( Caïn, Engen avec modifications)

Riz. 13.9.Les relations adaptatives croisées de sept substances odorantes : 1-citral, 2-cyclopentanone, acétate de 3-benzyle, 4-safrole, 5-m-xylène, 6-salicylate de méthyle, acétate de 7-butyle. Les interactions réciproques sont généralement inégales. Le degré d'augmentation du seuil de perception est indiqué comme suit : les lignes noires sont très grand; grandes lignes rouges pleines ; lignes pointillées rouges : modérées ; ligne pointillée rouge – faible(tel que modifié)
Tableau 13.4.Seuil de détection des odeurs d'acide butyrique et de butyl mercaptan ( Neuhaus, Stuiver)
|
Substance g |
Nombre de molécules dans 1 ml d'air |
Concentration substances à proximité source de stimulus, mol/l |
|
Acide butyrique |
2,4–10 9 |
10 –10 |
|
Butyle mercaptan |
10 7 |
2,7– 10 –12 |
Différents récepteurs olfactifs (ainsi que les récepteurs gustatifs) ont des profils de réponse qui se chevauchent. Ainsi, chaque substance odorante excite spécifiquement une population entière de cellules sensorielles ; dans ce cas, la concentration de la substance se reflète dans le niveau général d'excitation.
Traitement central des informations olfactives
Bulbe olfactif . Histologiquement, le bulbe olfactif est divisé en plusieurs couches, caractérisées par des cellules d'une forme spécifique, à partir desquelles s'étendent des processus d'un certain type avec des connexions caractéristiques entre elles. Les principales caractéristiques du traitement de l'information sont ici les suivantes : significatives convergence cellules sensorielles sur la mitrale ; exprimé mécanismes inhibiteurs et contrôle efférent impulsion d'entrée. Dans la couche glomérulaire, les axones d'environ 1 000 récepteurs se terminent sur les dendrites primaires d'un cellule mitrale(Fig. 13.10). Ces dendrites forment également des synapses dendrodendritiques réciproques avec périglomérulaire cellules. Les contacts mitral-périglomérulaires sont excitateurs, tandis que les contacts opposés sont inhibiteurs. Les axones des cellules périglomérulaires se terminent sur les dendrites des cellules mitrales du glomérule voisin. Cette organisation permet de moduler la réponse dendritique locale, fournissant freinage automatique Et inhibition des cellules environnantes. Cellules-grains forment également des synapses dendrodendritiques avec les cellules mitrales (dans ce cas, avec leurs déidrites secondaires) et influencent ainsi leur génération d'impulsions. Les apports sur les cellules mitrales sont également inhibiteurs, c'est-à-dire les contacts réciproques sont impliqués dans l'auto-inhibition. Enfin, les cellules granulaires forment des synapses avec les collatérales des cellules mitrales, ainsi qu'avec axones efférents (bulbopétales) d'origines diverses. Certaines de ces fibres centrifuges proviennent du bulbe controlatéral en passant par la commissure antérieure.
La particularité de l'inhibition provoquée par les cellules granulaires dépourvues d'axones est que, contrairement à l'inhibition typique de Renshaw, elles peuvent être partiellement activées, c'est-à-dire avec un gradient spatial. Ce

Riz. 13.10.Schéma des connexions neuronales dans le bulbe olfactif. Dans les glomérules (glomérules), les axones des récepteurs olfactifs se terminent sur les dendrites primaires ( D 1) cellules mitrales. Les cellules périglomérulaires et les cellules granulaires forment des synapses réciproques avec les synapses primaire et secondaire ( D 2) dendrites des cellules mitrales. K-garanties. Le sens de la transmission synaptique est indiqué par des flèches : influences excitatrices – noir, frein -rouge(avec généralisations et changements)
le schéma d'interactions très complexes est tout à fait comparable à celui connu dans la rétine, bien que le traitement de l'information repose sur un principe d'organisation cellulaire différent. Tout ce qui est décrit ci-dessus n'est qu'un schéma approximatif des événements qui se produisent dans le bulbe olfactif. En plus des neurones mitraux, les neurones secondaires comprennent également une variété de cellules en touffes, différant par leurs projections et leurs transmetteurs.
Connexions centrales . Axones cellules mitrales formulaire tractus olfactif latéral, en direction de cortex prépiriforme Et lobe piriforme. Les synapses avec des neurones d'ordre supérieur assurent la communication avec hippocampe et, à travers l'amygdale, avec les noyaux végétatifs hypothalamus. Les neurones qui répondent aux stimuli olfactifs se trouvent également dans formation réticulaire mésencéphale et cortex orbitofrontal.
L'influence de l'odeur sur d'autres systèmes fonctionnels . Une connexion directe avec le système limbique (voir section 16.6) explique la composante émotionnelle sensations olfactives. Les odeurs peuvent provoquer du plaisir ou du dégoût (composantes hédoniques), influençant ainsi l'état affectif du corps. De plus, l’importance des stimuli olfactifs dans régulation du comportement sexuel, bien que les résultats des expériences sur les animaux, en particulier les expériences visant à bloquer l'odorat chez les rongeurs, ne puissent pas être directement transférés aux humains. Il a également été démontré chez l'animal que les réponses des neurones du tractus olfactif peuvent être altérées par l'injection de testostérone. Ainsi, leur excitation est également influencée par les hormones sexuelles.
Troubles fonctionnels . Outre l’hyposmie et l’anosmie, il existe également des perceptions olfactives incorrectes. (iarosmie) et sensations olfactives en l'absence de substances odorantes (hallucinations olfactives). Les causes de ces troubles sont variées. Par exemple, ils peuvent survenir en cas de rhinite allergique et de traumatismes crâniens. Des hallucinations olfactives de nature désagréable (cacosmie) sont observées principalement dans la schizophrénie.
Tutoriels et guides
1. BeidlerLM.(Éd.). Sens chimiques. Partie 1. Olfaction. Partie 2. Goût. Manuel de physiologie sensorielle, Vol. IV, Berlin-Heidelberg-New York, Springer, 1971.
2. PfaffD.(Éd.). Goût. Olfaction et système nerveux central. New York, Rockfeller University Press, 1985.
Articles et critiques originaux
3. Breipohl W.(Éd.). Olfaction et régulation endocrinienne, Londres, IRL Press, 1982.
4. Denton D.A., Coghlan J.P.(Éd.). Olfaction et Goût, Vol. V, New York, Academic Press, 1975.
5. Hayushi T. (Éd.). Olfaction et Goût, Vol. II, Oxford-Londres New York-Paris, Pergamon Press, 1967.
6. Kare M.R., Mailer 0.(Éd.). Les sens chimiques et la nutrition, New York – San Francisco Londres, Academic Press, 1977.
7. Koster E. Adaptation et adaptation croisée en olfaction, Rotterdam, Bronder, 1971.
8. Le Magnen J., Mac Lead P.(Éd.). Olfaction et goût., Vol. VI, Londres – Washington DC, IRL Press, 1977.
9. Norris D.M.(Éd.). Perception des produits chimiques comportementaux, Amsterdam-New York-Oxford, Elsevier/Hollande du Nord, 1981.
10. Pfaffmann AVEC. (Éd.). Olfaction et Goût, Vol. Malade, New York, Rockfeller University Press, 1969.
11. Sato T. Potentiel de récepteur dans les cellules gustatives du rat. Dans: Autrum H., Ottoson D., PerlE.R., Schmidt R.F., Shimazu H., Willis WD.(Éd.). Progrès en physiologie sensorielle, Vol. 6, p. 1-37, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, Springer, 1986.
12. Schneider D.(Éd.). Olfaction et Goût, Vol. IV, Stuttgart, Wiss, Verlagsges, 1972.
13. Berger G.M. Organisation synaptique du bulbe olfactif des mammifères. Physiol. Tour. 52, 864, (1972).
14. Van der Starre H.(Éd.). Olfaction et Goût. Vol. VII, Londres – Washington DC, IRL Press, 1980.
15. Zotterman Y.(Éd.). Olfaction et Goût. Vol. I. Oxford – Londres – New York Paris, Pergamon Press, 1963.
16. Sens chimiques. Londres. IRL Press (publié dans des installations régulières).
Les papilles gustatives de la langue répondent aux stimuli situés dans la bouche. En d’autres termes, la sensibilité gustative chez tous les vertébrés est impliquée dans l’orientation à courte distance. Dans le même temps, chez les poissons, le sens du goût peut également servir d’orientation sur de longues distances. Dans l'eau, les substances aromatiques se déplacent par diffusion et convection depuis des sources très éloignées jusqu'aux papilles gustatives, qui peuvent être dispersées sur toute la surface du corps du poisson.
En plus de son rôle d’orientation à courte distance, le sens du goût remplit une fonction importante en déclenchant un certain nombre de réflexes. Par exemple, le lavage de la langue avec les sécrétions des glandes séreuses est contrôlé par un réflexe sous l'influence des papilles gustatives. La sécrétion de salive est également déclenchée par réflexe par la stimulation correspondante des papilles gustatives. Même la composition de la salive varie en fonction de la nature des stimuli agissant sur les cellules sensorielles, et les stimuli gustatifs influencent également la sécrétion du suc gastrique. Enfin, il a été prouvé que les vomissements sont provoqués par la participation de la sensibilité gustative.
Littérature
- 1. Batuev A.S., Kulikov G.L. Introduction à la physiologie des systèmes sensoriels. - M. : Ecole Supérieure, 1983. -263 p.
- 2. Cours sur la physiologie du système nerveux central : Manuel. Faculté de biologie et de chimie, Université d'État d'Oudmourtie, Pronichev I.V. -- Propulsé par swift.engine.edu, 2003. - 162 p.
- 3. Shulgovsky V.V. Fondements de la neurophysiologie : un manuel pour les étudiants universitaires. - M. : Aspect Presse, 2000. p. 277.
- 4. Shulgovsky V.V. Physiologie de l'activité nerveuse supérieure avec les bases de la neurobiologie : Manuel pour les étudiants en biologie. spécialités des universités - M. : Centre d'édition "Académie", 2003. - 464 p.
Pourquoi un même plat est-il perçu différemment par différentes personnes ? Par exemple, la soupe vous semble merveilleuse dans sa forme originale, mais votre partenaire souhaite y ajouter du poivre ou du sel. Dans le premier cas, nous parlons de la catégorie de personnes « super-goûteurs », sur la langue desquelles se trouvent de nombreuses papilles et dont le goût semble plein. En règle générale, les « super-goûteurs » préfèrent les aliments mous aux aliments épicés et aiment ajouter de la crème à leur café. La catégorie des personnes à faible densité papillaire - les « sous-goûteurs » - adore les aliments épicés qui « brûlent » la cavité buccale. Bien que la sensibilité gustative ne soit pas seulement influencée par les papilles.
On sait que le cerveau humain distingue cinq goûts : aigre, salé, amer, sucré et umami (le riche goût exotique de la cuisine orientale). Cependant, l’ensemble des produits chimiques qui provoquent ces signaux diffère d’une personne à l’autre. Les experts notent que les humains possèdent entre 20 et 40 gènes responsables des détecteurs de goût amer.
Les différentes perceptions de l’amertume sont très probablement une conséquence de la pression évolutive dans différentes parties de la planète. Les plantes les plus toxiques sont dotées d'un goût amer et les tribus nomades qui sont entrées en contact avec différents types de plantes au fil du temps ont reçu différents récepteurs.
Les résidents des pays où le paludisme est courant sont susceptibles d'avoir un gène qui les rend moins sensibles à certains amers, notamment ceux contenant du cyanure. Les chercheurs pensent que le cyanure, en petites quantités, peut neutraliser les insectes responsables du paludisme sans empoisonner les humains. À propos, les gens ont une aversion naturelle pour l'amertume et certaines odeurs, c'est pourquoi la bière que beaucoup aiment est rarement appréciée du premier coup.
Si vous voulez savoir si vous êtes un « super testeur » ou un « sous-testeur », mettez de la nourriture avec un colorant bleu sur votre langue. Ce colorant bleu n’adhère pas aux papilles gustatives de la langue. S’il reste peu de bleu sur la langue, vous êtes un « super-testeur » ; si la langue entière devient bleue, vous êtes un « sous-testeur ».
Une forme de sensibilité, un des types de chimioréception.
Spécificité.Sensibilité des récepteurs oraux aux irritants chimiques. Subjectivement, elle se manifeste sous forme de sensations gustatives (amères, acides, sucrées, salées et leurs complexes). En alternant plusieurs produits chimiques, un contraste gustatif peut apparaître (après l'eau salée, l'eau douce semble douce). Une image gustative holistique naît de l’interaction des récepteurs gustatifs, tactiles, thermiques et olfactifs.
Conditionnement.Pour expliquer le mécanisme de formation des sensations gustatives, deux hypothèses ont été avancées : analytique et enzymatique.
Dictionnaire psychologique. EUX. Kondakov. 2000.
Voyez ce qu'est la « sensibilité gustative » dans d'autres dictionnaires :
Sensibilité gustative- la capacité de percevoir et de transmettre des informations sur des stimuli chimiques à travers les papilles gustatives ou les papilles gustatives situées à la surface de la langue, de la gorge et du larynx (environ 10 000 tubercules mesurant jusqu'à 2 mm contenant... ... Dictionnaire encyclopédique de psychologie et de pédagogie
Sensibilité- I La sensibilité (sensibilitas) est la capacité du corps à percevoir diverses irritations émanant de l'environnement externe et interne et à y répondre. Ch. est basé sur des processus de réception dont la signification biologique réside dans... ... Encyclopédie médicale
Sensibilité- (sensibilitas) - la capacité du corps à percevoir les stimuli des environnements externe et interne et à y répondre en conséquence, est également inhérente aux cellules individuelles : douleur, vibration, viscérale, gustative, profonde, différentielle, cutanée, ... ... Glossaire de termes sur la physiologie des animaux de ferme
sensibilité gustative- (s. gustatoria) Ch. à un effet chimique, réalisé par l'émergence d'une sensation gustative de la substance active... Grand dictionnaire médical
Sensibilité Goût (Gustation)- le goût ou la perception gustative. Source : Dictionnaire Médical... Termes médicaux
GOÛT- une sensation qui se produit lorsque diverses substances alimentaires et non alimentaires (par exemple certaines substances chimiques et médicinales) pénètrent dans la cavité buccale. Les sensations gustatives ne peuvent être provoquées que par des substances qui sont à l'état dissous.... ... Encyclopédie concise de l'entretien ménager
GOÛT- une sensation qui se produit lors de l'exposition à des solutions chimiques. substances sur les récepteurs du goût chez les animaux. Basique les sensations gustatives - acides, salées, sucrées, amères - sont déterminées par la configuration des molécules de substances adsorbées de manière spécifique. récepteurs... ... Dictionnaire encyclopédique biologique
NERFS HUMAINS- NERFS HUMAINS. [Anatomie, physiologie et pathologie du nerf, voir art. Nerfs du tome XX ; au même endroit (Art. 667 782) dessins de Nerfs Humains]. Vous trouverez ci-dessous un tableau des nerfs qui met systématiquement en évidence les aspects les plus importants de l'anatomie et de la physiologie de chacun... ... Grande encyclopédie médicale
capacités de perception du nourrisson- Caractéristiques générales de la perception du nourrisson Dans ses Principes de psychologie, W. James caractérise ainsi le monde perceptuel du nourrisson : « Le bébé est attaqué par des irritations qui proviennent simultanément des yeux, des oreilles, du nez, de la peau et... ... Encyclopédie psychologique
Nerf glossopharyngé- Schéma des nerfs glossopharyngé, vague et accessoire... Wikipédia
Lire aussi...
- Contes populaires russes sur l'hiver
- Correspondance de Tatiana Golikova : le SP de la Fédération de Russie a dénoncé le Premier ministre d'Ingouchie pour des violations malveillantes
- Un responsable important a comparu dans l’affaire du père de Zakharchenko
- Une femme de Kharkov a réussi à « percer l'armure » : que sait-on de la vie personnelle de Dmitri Maryanov Qui a rencontré Evgenia Brik ?