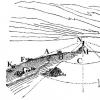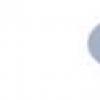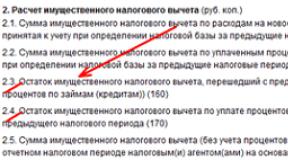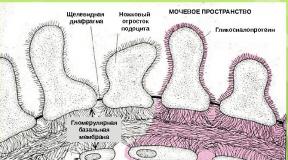Catégories d'alcoolisme en narcologie. Stades de l'alcoolisme dans différentes classifications. Mécanismes de défense psychologique dans l'alcoolisme
Le développement de la compréhension des caractéristiques de l’alcoolisme en tant que maladie est largement associé aux recherches de Jellinek. Il a été démontré qu'au début, la consommation d'alcool est généralement déterminée par des facteurs psychologiques et sociaux. Ces derniers provoquent un changement de comportement alcoolique et, par le mécanisme de « résolution de problèmes », contribuent à la formation d'une dépendance mentale à l'alcool, qui devient une sorte de « baguette magique » qui remplace les relations réelles avec la réalité. L'alcool devient un moyen de soulager le stress et les tensions psychologiques, physiologiques et sociaux, y compris ceux qui surviennent du fait même de l'abus d'alcool. Cela crée un cercle vicieux. Par la suite, des symptômes de dépendance physique se développent : tolérance accrue, gueule de bois, incapacité à s'abstenir de boire de l'alcool, perte de contrôle. A ce stade, l’auteur définit une personne qui abuse de l’alcool comme un « alcoolique » dont le comportement alcoolique est un processus douloureux. Jellinek a proposé une classification de l'alcoolisme basée sur l'identification d'une forme de dépendance psychologique (alcoolisme alpha), de trois formes d'alcoolisme avec dépendance physique (gamma, delta et epsilon), ainsi que d'une forme bêta, comprise comme un dommage au cerveau et organes internes par l'alcool. L'isolement du bêta-alcoolisme, de notre point de vue, a violé le principe de base de la classification - la division des types d'alcoolisme par type de dépendance.
Il ne fait aucun doute que les dommages causés à divers organes et systèmes par l'alcool sont possibles sous quelque forme que ce soit, parfois même chez des personnes qui ne souffrent pas de cette maladie, par exemple en cas d'intoxication accidentelle par l'alcool ou ses dérivés. Le principe de différenciation des formes d'alcoolisme basé sur la prise en compte des caractéristiques de son syndrome principal - le syndrome de dépendance à l'alcool - a été utilisé dans notre classification.
La classification de Jellinek a été élargie en identifiant de nouvelles formes d'alcoolisme présentant des symptômes de dépendance mentale (eta, iota et kappa), des formes de dépendance physique (zeta). La forme bêta a été exclue de la classification.
Les lésions cérébrales alcooliques, selon leur gravité, ont été prises en compte pour identifier les stades de l'alcoolisme : démence cérébrale, encéphalopathique et partielle. Il est également nécessaire d'inclure dans la classification de l'alcoolisme, ainsi que les symptômes de la toxicomanie, les caractéristiques des changements organiques dans le cerveau, ainsi que les troubles de divers organes et systèmes causés par les effets toxiques de l'alcool. Tous ces changements doivent être pris en compte lors de la réalisation d'un traitement anti-alcoolique.
Voici une brève description des formes et stades identifiés de l’alcoolisme.
Alcoolisme alpha est une forme de dépendance mentale à l'alcool. Le contenu de la dépendance mentale réside dans le désir de soulager le stress émotionnel grâce à l'alcool, de se débarrasser des pensées désagréables et d'échapper pendant un certain temps à la nécessité de prendre une décision difficile. L'alcool est utilisé comme moyen d'éliminer temporairement les troubles qui n'atteignent pas un niveau névrotique. Avec l'alcoolisme alpha, on a généralement tendance à boire plus fréquemment, ce qui commence à devenir de plus en plus habituel. Toute difficulté peut donner envie de boire de l’alcool.
L'alcoolisme alpha se développe souvent chez les personnes qui, en raison d'une mauvaise éducation, ont une attitude passive envers la vie. Face à des difficultés, ils subissent facilement un stress émotionnel, reflétant une violation de l'adaptation mentale. La tendance à boire de l'alcool dans l'alcoolisme alpha augmente, comme le montrent nos recherches, dans un environnement de stimulation rarement changeante, à la fois lorsqu'elle augmente et lorsqu'elle diminue. Les conséquences sociales de cette forme concernent les relations interpersonnelles. La famille et le travail en souffrent.
C'est de l'alcoolisme- une forme avec des symptômes de dépendance mentale. La consommation d'alcool est masquée par des « traditions » avec leur expansion et leur exagération. La consommation d’alcool se fait généralement en compagnie de personnes que vous connaissez bien. Il n’y a pas de motivation claire pour boire de l’alcool. Dans ces cas, tout divertissement, toute forme ordinaire de communication entre les personnes s'accompagne de la consommation d'alcool. Boire des boissons alcoolisées devient un moyen d'établir des contacts professionnels et personnels. L’attirance pour la boisson est en réalité associée au désir de plaisir provoqué par le fait de passer du temps ensemble en état d’ivresse. Il y a une destruction des motivations constructives, leur remplacement par un stéréotype de comportement, conduisant à une diminution du niveau général de l'individu, de ses intérêts, de sa culture et de son utilité sociale. Caractérisé par une séparation de la réalité et une tendance aux fantasmes improductifs et infructueux.
Alcoolisme Iota- une forme présentant des symptômes de dépendance mentale à l'alcool. Comme pour l'alpha alcoolisme, le contenu de la dépendance mentale réside dans le désir de soulager un état mental inhabituel et un stress émotionnel. Cependant, avec la forme iota, ces troubles atteignent un niveau névrotique. Une consommation constante d'alcool est nécessaire pour soulager les peurs obsessionnelles ou d'autres symptômes névrotiques et de type névrose à long terme, y compris l'impuissance. La dépendance à l'alcool est initialement étroitement liée à un état névrotique, mais devient ensuite moins distincte.
Alcoolisme Kappa est une forme assez rare d'alcoolisme qui se développe dans certaines maladies mentales. La dépendance mentale à l’alcool est provoquée par le désir de changer son état mental, de se débarrasser, au moins temporairement, d’expériences difficiles de nature psychotique.
Alcoolisme d'Epsilon les moins étudiés. La dépendance à l’alcool ne peut être décrite uniquement en termes de psychologie. L'abus d'alcool est périodique, mais extrêmement intense. Les intervalles entre les excès alcooliques peuvent atteindre plusieurs années.
Dans l’état normal, il n’y a pas de besoin d’alcool. Lors d'excès périodiques, les personnes souffrant d'alcoolisme epsilon peuvent causer de graves dommages à elles-mêmes, à leur famille et à la société. L'alcoolisme Epsilon ne doit pas être confondu avec une autre forme - gamma.
Certains chercheurs admettent que l'alcoolisme epsilon survient chez les individus souffrant de changements d'humeur périodiques, se manifestant par de la morosité, de l'irritabilité, de la colère, de la mélancolie et une grande tension dans ces états émotionnels négatifs. La probabilité d'un lien entre ces troubles et des changements dans la nature épileptique est à l'étude. La relative rareté de tels cas et, évidemment, leur hétérogénéité ne permettent pas de tirer une conclusion définitive.
Alcoolisme gamma - une forme avec des symptômes de dépendance physique à l'alcoolisme. Le principal symptôme de la dépendance physique est la perte de contrôle. La perte de contrôle n’est parfois pas entièrement comprise comme une consommation incontrôlée d’alcool, une « ivresse incontrôlée ». Parallèlement, la définition précise du symptôme de perte de contrôle est d'une grande importance pour évaluer les conditions inhérentes à l'alcoolisme gamma.
Un symptôme de perte de contrôle est que la consommation de presque n'importe quelle dose initiale d'alcool entraîne une chaîne d'événements incontrôlables, consistant en des doses ultérieures prises jusqu'à ce qu'une intoxication grave se développe, généralement avec une altération de la conscience sous forme de stupeur ou même de stupeur. Boire de l'alcool en présence d'un symptôme de perte de contrôle ne conduit pas à l'effet attendu, sur la base de l'expérience antérieure, ou ce dernier s'avère extrêmement éphémère. Par exemple, le calme et la détente attendus ne se produisent pas et l'humeur ne s'améliore pas. Au contraire, de l'agitation et de l'anxiété apparaissent, l'humeur chute fortement, les mains commencent à trembler et des contractions musculaires individuelles sont souvent observées. La méfiance envers les autres est caractéristique.
L’intoxication alcoolique accompagnée de symptômes de perte de contrôle est très différente de l’intoxication alcoolique ordinaire. Ce dernier s'accompagne généralement de bonne humeur, d'enjouement et de gaieté. Caractérisé par le bavardage, la pseudo-philosophie, la vantardise, les fantasmes, parfois les larmes et la sentimentalité exagérée. Dans les cas où un symptôme de perte de contrôle apparaît, le tableau de l'intoxication est complètement différent. L’anxiété prend le dessus, la concentration sur son état, le contact avec les autres est formel, l’intérêt se limite à l’envie de boire plus et le plus tôt possible. Les patients développent un sentiment subjectif selon lequel « il suffit de boire plus et tout ira bien », c'est pourquoi il existe une forte envie d'alcool. Cependant, la prise de doses ultérieures, si elle atténue la maladie, ne dure que très peu de temps. En conséquence, la consommation d’alcool continue.
Dans les cas où il n'y a pas d'alcool, divers substituts peuvent être bu. Le symptôme de perte de contrôle est défini par le psychiatre américain Oloart comme la « perte de liberté » de boire de l'alcool après la première dose. Nos observations montrent que les personnes en perte de contrôle changent fortement leur style de consommation d'alcool ; elles arrêtent notamment de boire dans les anciennes entreprises, craignant de se discréditer par le fait qu'elles ne peuvent pas, comme auparavant, entretenir une conversation, supporter les intervalles de temps entre les consommations d'alcool. l'alcool, et le résultat final inévitable est une intoxication grave avec l'incapacité même de rentrer chez soi de manière indépendante. La consommation d'alcool par des personnes en perte de contrôle se produit souvent seule, dans un cercle très restreint ou en compagnie de personnes présentant une dégradation évidente de l'alcool. L’apparition d’un symptôme de perte de contrôle provoque de l’anxiété (« il m’est arrivé quelque chose »), et chez certains, une envie d’expérimenter l’alcool : voir s’ils peuvent résister à une certaine dose de consommation. Ces « expériences » se terminent généralement par un nouvel excès d'alcool. Même si, au prix d'efforts extrêmement volontaires, le patient arrête de boire, alors le lendemain ou un peu plus tard, sous l'influence d'un sentiment illusoire de « victoire sur soi », il essaie de boire « comme avant » et redevient alcoolique.
Il convient de garder à l’esprit que les personnes atteintes d’alcoolisme gamma naissant peuvent dans un premier temps réduire le nombre de verres, craignant leurs conséquences. Leur comportement se caractérise par des absences du travail de plus en plus fréquentes pendant plusieurs jours, généralement après des jours de congé, qu'ils tentent par tous les moyens de justifier par des « raisons objectives ».
L'alcoolisme gamma se caractérise également par la présence d'un syndrome de gueule de bois alcoolique, qui n'est pas soulagé par la consommation de petites doses d'alcool, car la perte de contrôle conduit au développement du prochain excès d'alcool. Avec l'alcoolisme gamma, les conséquences sociales dans le domaine des relations familiales et professionnelles s'expriment fortement.
Alcoolisme zêta - une forme avec dépendance physique à l'alcool. Elle se caractérise par des doses fréquentes, mais non régulières, qui provoquent des symptômes d'intoxication prononcés.
Sous cette forme, le symptôme de perte de contrôle n'apparaît que lors de la prise de doses d'alcool relativement importantes et ne s'installe pas après de petites et moyennes doses. Cela permet au patient de contrôler dans une certaine mesure son comportement lorsqu'il boit. Dans certains cas, la consommation d’alcool est limitée à des doses d’alcool qui n’entraînent pas de perte de contrôle. Dans le processus de soulagement d'une gueule de bois, le symptôme de perte de contrôle ne se développe pas, ce qui permet de soulager les symptômes de sevrage avec de petites doses d'alcool. Les conséquences sociales de l'alcoolisme zêta sont différentes, les relations interpersonnelles sont perturbées et la situation sociale et financière peut fortement se détériorer.
Alcoolisme delta - une forme avec dépendance physique à l'alcool. Elle se caractérise par l'incapacité de s'abstenir de boire de l'alcool de manière répétée, par la prise régulière de doses individuellement différentes qui ne provoquent pas d'intoxication prononcée. En raison de la formation du syndrome de sevrage, il est nécessaire d'être constamment en état d'ébriété. Cependant, la possibilité de contrôler la quantité bue dans chaque cas individuel demeure. Pendant une période relativement longue, l'alcoolisme delta peut se produire de manière cachée. Auparavant, on pensait que l'alcoolisme delta consommait principalement des boissons alcoolisées à faible teneur en alcool : vins de raisin, bière. Cependant, au cours de la dernière décennie, même dans les régions traditionnellement productrices de vins de raisin, comme le sud de l’Europe, la consommation de boissons à forte teneur en alcool a augmenté dans un style caractéristique de la forme delta de l’alcoolisme. Dans les pays où la consommation d'alcool est totalement libre, comme la France, il existe un grand nombre de cas cachés d'alcoolisme delta, comme en témoignent les psychoses alcooliques, qui se développent souvent chez des personnes qui affirment n'avoir "jamais vraiment été ivres du tout". , ils consommaient régulièrement des doses relativement faibles de boissons alcoolisées.
Tout le monde sait depuis longtemps que le C2H5OH est un poison psychotrope et ne l’habillez pas dans des tenues haute couture, c’est addictif, mais on ignore encore ce qu’il y a dans les gènes ! Et en conséquence, en médecine, on a observé entre-temps une augmentation marquée du nombre de jeunes souffrant d’addiction à ces « aides ». La dépendance à l'alcool dépend dans une large mesure de la motivation initiale de consommation, de la manière dont une personne explique et justifie la consommation de boissons alcoolisées. Si le motif de la consommation d'alcool est de satisfaire un besoin émotionnel pressant - se détendre, améliorer la communication, calmer les nerfs, etc., alors une telle motivation accélérera la dépendance. Plus la boisson est nécessaire, plus la consommation d'alcool est répétée souvent, plus tôt la dépendance se produit. Un mode de vie alcoolique se forme, une position alcoolique persistante de l'individu se produit, lorsque l'alcool remplace de plus en plus la réalité et qu'une personne reçoit de moins en moins de plaisir véritablement humain de la vie.
Qu’est-ce que la dépendance à l’alcool ? Tout d’abord, il s’agit d’un changement dans la réactivité du corps à l’alcool, de l’apparition de changements biochimiques et psychophysiologiques dans le corps en réponse à une intoxication alcoolique chronique. Le syndrome de dépendance comprend le désir d'obtenir certains effets de la consommation d'alcool, un système de croyance selon lequel l'alcool produit de tels effets, un « alibi alcoolique » ou la preuve de l'impossibilité de ne pas boire d'alcool, l'intolérance à la sobriété et le désir d'« en ajouter » lorsqu'il est léger. une intoxication se produit.
L'image imposée du « vrai alcoolique » s'est imposée dans l'esprit des gens : un ivrogne sur la clôture, ivre d'une cuillerée de vin, ils essaient de ne pas classer toutes les autres options dans l'alcoolisme ; Mais vers cette image de « vrai alcoolique » (alcoolisme du troisième stade), il a fait plus d'un pas !
En prêtant attention à l'évolution progressive et imperceptible de cette maladie pour vous-même et pour les autres, nous vous présentons une classification de l'alcoolisme qui aiguisera votre sensibilité à l'apparition d'une addiction, vous alertant peut-être de la consommation d'alcool de votre part ou de celle de vos proches.
"Alcoolisme alpha"
« L'alcoolisme alpha » consiste le plus souvent à consommer des vins légers presque tous les jours « pour l'appétit ». Et une légère ivresse est dans ce cas perçue comme un « tempérament vital prononcé » : la personne est en permanence joyeuse, active et énergique. Mais une caractéristique importante de l'alpha alcoolisme est qu'une personne « ne s'enivre pas » au point de s'empoisonner gravement ! Principalement parce qu'il n'a pas besoin d'un évanouissement complet - au contraire, il a besoin d'une stimulation avec une légère dose. Mais en outre, sa tolérance augmente constamment, quoique extrêmement lentement (syndrome d’altération de la réactivité). Au fil du temps, une personne boit déjà non pas un, mais deux, trois, quatre verres du même vin léger chaque jour. Et son psychisme change aussi à « petites doses », imperceptiblement, progressivement. En raison du processus prolongé dans le temps, tous les changements se produisent plus doucement, moins frappants ; La conséquence la plus frappante d’un tel alcoolisme est peut-être la fameuse embryopathie alcoolique (malformations congénitales du fœtus). Ce qui est très développé dans les pays dits de la « ceinture viticole européenne ». Aux mêmes troubles mentaux progressifs s'ajoutent des troubles somatiques, et une certaine préoccupation sexuelle surgit souvent (diminution de la puissance, d'abord « sobre », puis en général).
"Bêta alcoolisme"
Cette dépendance a également une « localisation géographique approximative » - en règle générale, les pays d'Europe centrale, où s'est formée une culture de consommation de boissons alcoolisées comme la bière. Dans la bêta-alcoolisme, la consommation et l'abstention d'alcool sont de nature dite sporadique (aléatoire), c'est pourquoi ce type est le plus souvent associé à la culture de la « bière », qui est tout aussi aléatoire. Si vous avez un ami, vous devez « aller boire une bière », mais si vous n’en avez pas, vous n’en avez pas besoin. Une telle utilisation caractérise également l'apparition du bêta-alcoolisme. Mais néanmoins : un accident est un accident, et avec le bêta-alcoolisme, les gens ne boivent pas très rarement, ce qui coïncide aussi avec la culture de la bière (surtout où ils boivent de la bière aussi souvent que nous buvons du thé). Bien que nous puissions dire qu'une personne ayant une telle consommation est sobre et ivre pendant à peu près le même temps. Petit à petit, toutes les rencontres amicales, les fêtes de jeunes et la communication en général dans cette culture se conjuguent forcément avec la même bière. Les limites des « périodes d'ivresse et de sobriété » - deux étapes spécifiques du bêta-alcoolisme - s'estompent progressivement (car l'intoxication par des boissons comme la bière ne se produit pas immédiatement). La tolérance au bêta-alcoolisme augmente également, y compris les somatiques, au moins les intoxications chroniques aux huiles de fusel, la fameuse « cirrhose de la bière » et ce qu'on appelle le « cœur de taureau ».
"Alcoolisme gamma"
Il est également courant dans d'autres pays dits « aux climats modérément froids » - probablement parce qu'il s'agit généralement de boissons fortes prises en interne « pour se réchauffer » - whisky, rhum, cognac (également des stimulants typiques de l'alcoolisme gamma), et en Russie. et l'Ukraine le plus souvent de la vodka. Et, comme vous le savez, la concentration en alcool des boissons répertoriées est élevée, comparée à celle du vin et de la bière. Alors, bon gré mal gré, dans tous les cas, vous recevez presque toujours un « coup prononcé au cerveau »
L'alcoolisme gamma se caractérise par trois étapes :
Le premier est le développement de la tolérance (comme d’ailleurs chez toutes les espèces), mais relativement rapidement ;
Le second est ce qu'on appelle le « plateau de tolérance » (pendant plusieurs années environ, la dose tolérante atteint un maximum et n'augmente plus : ce qu'on appelle habituellement « je connais ma norme ») ;
Le troisième est une baisse de tolérance (l’organisme a épuisé ses ressources de défense face à l’alcool). À ce stade, un alcoolique gamma expérimenté peut « s'éteindre » même avec seulement cent grammes de vin léger.
On ne peut véritablement étudier et corriger les formes d’addiction qu’en s’adressant à des professionnels. Vous pouvez obtenir un rendez-vous au centre médical Polinar n'importe quel jour et à toute heure - le centre est ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Copie et réimpression du matériel uniquement avec l'autorisation du détenteur des droits d'auteur et en indiquant un lien hypertexte actif vers www.polinar.com.ua
En moyenne, environ 95 % des personnes boivent de l'alcool tout au long de leur vie (Shabanov. 1999). Des études épidémiologiques menées dans notre pays ont montré que presque tous les hommes (99,94 %) et la majorité absolue des femmes (97,9 %) consommaient ou consomment des boissons alcoolisées. Évidemment, seul un petit pourcentage d’entre eux deviennent des alcooliques chroniques.
Le concept d'ivresse et d'alcoolisme implique une consommation excessive de boissons alcoolisées, qui a un effet néfaste sur la santé, le travail, le bien-être et les fondements moraux de la société.
Les troubles mentaux provoqués par la consommation d'alcool sont généralement divisés en groupes en fonction de la durée de sa consommation : ceux survenant après une consommation unique ou épisodique et ceux résultant d'une consommation répétée sur une longue période, ainsi qu'en fonction de l'absence ou de la présence de troubles psychotiques.
Groupes de troubles liés à l'alcool :
1) Intoxication alcoolique aiguë (intoxication) :
Intoxication alcoolique simple ;
Formes altérées d'intoxication alcoolique simple (atypique) ;
Intoxication pathologique.
2) Alcoolisme chronique ;
3) Psychoses alcooliques.
Dans la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10), utilisée en Russie depuis la seconde moitié des années 90, les troubles liés à la consommation d'alcool sont identifiés comme suit :
Léna à la rubrique « Troubles mentaux et comportementaux dus à l'usage de substances psychoactives » (F 1). Cette section comprend une variété de troubles dont la gravité va de l'intoxication simple et de l'usage nocif aux troubles mentaux graves et à la démence. Ces troubles peuvent s'expliquer par la consommation d'une ou plusieurs substances psychoactives (PAS). La substance est indiquée par les deux premiers chiffres après la lettre F. Ainsi, la catégorie F 10 comprend les troubles mentaux et comportementaux dus à la consommation d'alcool (ICD-10, 1994).
Ivresse domestique
L'alcoolisme chronique est toujours précédé d'une étape d'ivresse quotidienne, qui peut être assez longue. Selon la CIM-10, l'ivresse domestique est diagnostiquée comme « la consommation d'alcool ayant des conséquences néfastes » (F 10.1). E. E. Bechtel (1986) a proposé une classification de l'ivresse quotidienne, où seules les deux dernières options peuvent être attribuées directement à « l'ivresse » (tableau 3.1) :
Retraits- il s'agit de personnes qui s'abstiennent de boire de l'alcool soit par intolérance (réactions allergiques sévères), soit en raison de la formation de certaines attitudes (par exemple, suite à la réaction de protestation d'un jeune homme face à un père alcoolique ou en raison de la présence de certaines opinions religieuses ou philosophiques qui interdisent la consommation d'alcool).
En règle générale, les buveurs occasionnels ne ressentent pas de sensations agréables liées à l'intoxication et ne s'efforcent donc pas d'augmenter la dose ou la fréquence de leur consommation. La consommation d'alcool dans ce groupe se fait généralement sous la pression des autres.
Parmi les buveurs occasionnels d’alcool, on trouve des buveurs modérés. Ils éprouvent du plaisir en cas d'ivresse, bien que l'effet euphorisant de l'alcool soit modéré. Ils prennent rarement sur eux d'organiser leur consommation d'alcool et ont encore moins souvent une envie spontanée de boire. L'alcoolisation se produit généralement au sein d'un groupe informel permanent (amis, parents, etc.). En dehors de l’état d’ivresse, aucune anomalie comportementale n’est détectée.
L'ivresse systématique, outre l'augmentation de la fréquence de consommation d'alcool et l'augmentation de la dose unique d'alcool, se caractérise par des changements dans les systèmes de valeurs et l'émergence d'actions comportementales socialement négatives liées à l'ivresse. À cet égard, on peut parler de la formation d'un certain style, mode de vie. Ces individus se familiarisent avec l'alcool au début de l'adolescence et la consommation systématique commence après 16 ans. Le besoin alcoolique commence rapidement à acquérir une importance égale à celle des autres besoins personnels. Ces individus commencent à boire ; l'alcool commence progressivement à acquérir l'importance d'une orientation de valeur dominante, devenant la principale source de plaisir dans la vie. On assiste ainsi à un certain déclin personnel dans les sphères sociale, familiale et professionnelle.
L'ivresse habituelle est la forme extrême et la plus grave de consommation épisodique et présente parfois certaines difficultés pour le diagnostic différentiel de l'alcoolisme chronique. La dynamique de cette forme d'ivresse quotidienne conduit souvent au développement de l'alcoolisme.
Motivations pour boire de l'alcool
Il existe différentes motivations et raisons pour lesquelles les gens commencent à boire de l’alcool. je
1. Hédonique - la consommation d'alcool est associée à une soif de plaisir. Le raisonnement se résume à ceci : « Pourquoi devrais-je me refuser un verre, car il n’y a qu’une seule vie, il n’y en aura pas d’autre comme celle-là. Et en général, pourquoi vivre s’il n’y a pas de plaisir.
2. Ataractic - l'alcool est consommé pour soulager les troubles affectifs, soulager l'état de stress émotionnel, d'anxiété, d'agitation et d'incertitude. "Docteur, j'avais besoin de me déconnecter des souvenirs désagréables."
3. Soumission - la consommation d'alcool est associée à une soumission accrue et à une incapacité à résister à l'environnement. "Je bois comme tout le monde, je ne veux pas être un mouton noir."
4. Avec hyperactivation du comportement - l'alcool est utilisé comme dope afin d'augmenter le tonus, d'augmenter l'activité et d'améliorer les performances. "Je bois quand je suis fatigué pour me remonter le moral."
5. Pseudoculturel - l'alcool est consommé afin d'attirer l'attention des autres avec une recette de cocktail complexe et des marques de vin rares. Ces patients se considèrent comme de fins connaisseurs d’alcool.
6. Traditionnel - l'alcool est consommé lors des jours fériés sanctionnés.
Intoxication alcoolique aiguë (intoxication alcoolique)
L'intoxication alcoolique est un ensemble de symptômes de troubles mentaux, autonomes et neurologiques causés par l'effet psychotrope de l'alcool. Selon les critères de la CIM-10, le diagnostic d'intoxication alcoolique aiguë (F10.0) ne peut être posé que dans les cas où l'intoxication ne s'accompagne pas de troubles liés à la consommation d'alcool plus persistants.
Il existe trois degrés : léger, modéré et sévère. Pour quantifier le degré d'intoxication alcoolique, la concentration d'éthanol dans le sang est le plus souvent déterminée. En conséquence, une concentration de 0,5 à 1,5 ‰ est légère, 1,5 à 2,5 est moyenne, 3 à 5 est lourde. A une concentration de 6-8 ‰, l'intoxication alcoolique est la cause du décès.
Il existe trois formes d'intoxication alcoolique : simple ; formes altérées d'intoxication simple (intoxication alcoolique atypique) ; intoxication pathologique.
Intoxication alcoolique simple . Degré léger. Caractérisé par un sentiment de confort mental et physique (euphorie), de légères fluctuations du fond émotionnel, une hyper-expressivité et une verbosité. La réflexion est accélérée, les associations sont superficielles. La critique est réduite (sentiment subjectif de « dégriser » après la 2-3ème dose d'alcool). Les symptômes végétatifs comprennent une hyperémie de la peau (en particulier du visage) et une légère tachycardie. Il n'y a pas d'amnésie. Diplôme moyen. Des troubles affectifs plus prononcés, une désinhibition motrice et une dysarthrie sont typiques. Les critiques à l’égard de cette maladie ont été considérablement réduites. Le rythme de la réflexion et le processus associatif ralentissent. On note une instabilité de la démarche. Des nausées et des vomissements sont possibles. Amnésie partielle. Degré sévère. Elle se caractérise par l'apparition de symptômes de stupeur de gravité variable : du coma léger au coma. Les symptômes neurologiques sont prononcés - ataxie cérébelleuse, atonie musculaire, amymie, dysarthrie ; troubles vestibulaires - vertiges, nausées, vomissements. Cyanose, hypothermie. Des crises d'épileptiforme peuvent survenir. Il existe une amnésie narcotique complète pendant la période d'intoxication. À des concentrations d'éthanol plus élevées, la mort survient par paralysie du centre respiratoire.
La durée de l'intoxication alcoolique dépend de nombreux facteurs (sexe, âge, poids corporel, caractéristiques raciales, dépendance à l'alcool), mais surtout de la quantité d'alcool consommée et du taux de son métabolisme dans le corps.
Après une intoxication alcoolique modérée et particulièrement sévère, les symptômes post-intoxication persistent pendant plusieurs heures le lendemain - maux de tête, soif, manque d'appétit, fatigue, faiblesse, nausées, vomissements, étourdissements, tremblements et forte diminution des performances. Les gens ne le font pas
Pour ceux qui souffrent d'alcoolisme, la vue de l'alcool et même sa mention provoquent du dégoût (contrairement au syndrome de la gueule de bois, évoqué ci-dessous).
Formes altérées d’intoxication alcoolique simple. Le tableau clinique de l'intoxication alcoolique dépend en grande partie du « sol » sur lequel l'alcool affecte. La présence d'un tel sol (conséquences d'un traumatisme crânien, changements de personnalité, etc.) conduit à l'émergence de formes altérées d'intoxication alcoolique. L'intoxication atypique est appelée intoxication dans laquelle il y a une augmentation ou une diminution excessivement forte de tout trouble, ou la séquence de leur apparition est perturbée, ou des symptômes inhabituels pour une simple intoxication se développent. Les troubles mentaux subissent les plus grands changements. Des modifications d'une simple intoxication alcoolique peuvent survenir aux stades II et III de l'alcoolisme. On distingue les formes suivantes d'intoxication alcoolique atypique : 1) Un ami d'entre eux se produit plus souvent Variante dysphorique de l'intoxication, Quand, au lieu de l'euphorie habituelle, il y a dès le début un état de tension colérique avec irritabilité et conflit, une tendance à l'agressivité. On l'observe plus souvent chez les alcooliques chroniques, ainsi que chez les patients présentant diverses lésions organiques du cerveau. 2) Option dépressive On l'observe chez les ivrognes dits sombres. L'intoxication s'exprime par une augmentation de la dépression, de la mélancolie, d'un sentiment de désespoir, de désespoir avec larmes et d'insatisfaction envers soi-même. Parfois, des pensées suicidaires et des tentatives pour les réaliser surviennent. 3) Quand Version hystérique L'intoxication se manifeste par un comportement démonstratif (théâtre, se tordant les mains, émotivité inadéquate avec pathétique, louange de soi, légère automutilation en guise de démonstration de tentatives de suicide). 4) Alcool Intoxication à traits hébéphréniques La folie se manifeste par des jeux, des stéréotypies, des pitreries, des actions impulsives (kleptomanie, pyromanie, vagabondage, perversion sexuelle) et une violence insensée. De telles images peuvent être observées en présence de schizophrénie latente, ainsi que chez les adolescents et les jeunes hommes.
Intoxication pathologique au sens strict, il ne s’agit pas d’une intoxication en soi, mais d’une psychose transitoire hyperaiguë provoquée par la prise, même en petites quantités.
Alcool et écoulement sous la forme d'un état crépusculaire avec conscience ; se termine soit par le sommeil, soit par un épuisement psycho-physique. Plus de 80 % sont accompagnés d'actions illégales. Avec tous les types de désorientation, la coordination des mouvements est maintenue avec la capacité d'effectuer des actions nécessitant de l'habileté, voire de la dextérité. Les patients ne sont pas disponibles pour un contact ; toutes les actions sont effectuées seuls. L'épisode est complètement amnésique. Peut être accompagné de troubles productifs - délires, hallucinations. Dans 84 % des cas, il n'y a aucun symptôme d'intoxication alcoolique aiguë. Deux tendances principales se manifestent dans le comportement : la défense avec le désir de détruire la source du danger et la fuite d'une situation menaçante.
On distingue les formes épileptoïdes et hallucinatoires-paranoïdes d'intoxication pathologique. Dans la forme épileptoïde, sur fond de désorientation, d'affect de colère, de rage et d'extrême pauvreté de production de parole, il existe une forte excitation motrice avec agression, qui a souvent le caractère d'actions chaotiques et stéréotypées. Dans la forme paranoïaque, le comportement du patient reflète des expériences délirantes et hallucinatoires de nature effrayante. Ce confort est mis en évidence par des paroles individuelles, des cris, des ordres, des menaces, même si en général la production vocale du patient est rare et incompréhensible. L’activité motrice est relativement ordonnée et prend la forme d’actions complexes et ciblées. L'intoxication pathologique est favorisée par un « fond organique », l'épilepsie et une asthénie sévère.
L'examen d'une intoxication pathologique est souvent difficile et extrêmement responsable. Les actes criminels sont souvent commis dans un état de simple ivresse alcoolique dont la présence, selon la législation pénale, augmente le degré de culpabilité et de responsabilité. En cas d'intoxication pathologique, le patient est déclaré fou, ce qui le libère. de la responsabilité pénale.
Classification de l'alcoolisme chronique
Pour la première fois, les trois étapes de l'alcoolisme ont été décrites par I.V. Strelchuk (1949). Dans un premier temps, une modification de la réaction de l’organisme à l’alcool se produit (le réflexe nauséeux disparaît, la tolérance augmente, etc.). La deuxième étape commence par la formation de syndro-
Ma gueule de bois. Dans la troisième étape, la dégradation se produit. Un groupe relativement restreint de patients y survivent.
Dans la classification répandue de l'alcoolisme par A. A. Portnov et I. N. Pyatnitskaya (1971), on distingue également trois stades : initial (neurasthénique), moyen (narcotique), initial (encéphalopathique).
En Occident, la classification Jellinek (Jellinek, I960) est répandue, dans laquelle une attention particulière est accordée au type de boisson alcoolisée consommée. Il existe cinq formes d'alcoolisme :
Alcoolisme alpha - l'alcool est utilisé comme moyen d'atténuer les phénomènes psychologiques négatifs et les sensations somatiques. Typique des régions viticoles (pays méditerranéens.
Bêta alcoolisme - consommation d'alcool conformément aux coutumes du milieu social (mariage russe ou géorgien). Selon Jellinek, ce n’est pas une maladie.
L'alcoolisme tamma est la consommation de boissons alcoolisées fortes avec développement du syndrome de la gueule de bois. Il existe une sorte d’ivresse excessive. Accompagné de graves conséquences sociales. Typique des pays où les boissons alcoolisées fortes sont préférées (Europe du Nord, Russie, etc.
Alcoolisme delta - se manifeste par une forme constante de consommation d'alcool avec des conséquences somatiques prononcées et des conséquences sociales légères. Typique des régions viticoles.
L'alcoolisme d'Epsilon se manifeste par de véritables crises de boulimie qui commencent sans raison apparente. Entre les beuveries, il n’y a aucune envie d’alcool. Selon la plupart des chercheurs, il s'agit d'une manifestation secondaire d'une maladie mentale phasique ou paroxystique (trouble affectif, épilepsie, etc.).
Dans la CIM-10 (1994), il n'y a pas de division de l'alcoolisme chronique en étapes. Les sections suivantes sont mises en évidence séparément : syndrome de dépendance (F10.2) ; état d'annulation (F10.3). En rejoignant un psychotique ; « Les complications ressortent : état de sevrage avec délire (F10.4), trouble psychotique (F10.5), syndrome amnésique (F10.6) : trouble mental résiduel et trouble psychotique d'apparition tardive (F10.7).
En Russie, les classifications liées à la division de la maladie en trois stades sont encore traditionnellement utilisées. Parallèlement, un certain nombre d'auteurs et de classifications incluent le taux de développement (progression) de la maladie : faible, moyen et élevé, les formes d'abus (voir ci-dessous), la gravité des conséquences sociales, les manifestations somatoneurologiques de l'alcoolisme, ainsi que comme l'état actuel de la dynamique de la maladie : rémission ou rechute (Lectures in Narcology, 2000).
Manifestations cliniques et schémas d'évolution de l'alcoolisme
Le tableau clinique se compose d’un syndrome de toxicomanie et de changements dans la personnalité du patient. Le syndrome de toxicomanie comprend la dépendance pathologique à l'alcool (syndrome de dépendance selon la CIM-10), ainsi qu'une réactivité altérée à celui-ci. Dans la pratique clinique, il est d'usage de distinguer deux types d'envie pathologique d'alcool - primaire et secondaire. Attraction principale Ou Dépendance mentale, Il combine deux symptômes : une attirance mentale pour l'alcool et l'apparition d'une euphorie pendant la phase d'intoxication. Attraction secondaire Ou Dépendance physique, Elle se manifeste par l'incapacité à tolérer l'état de sevrage, exprimée par le désir d'une nouvelle consommation d'alcool pour se débarrasser des symptômes désagréables.
Ces principaux syndromes appartiennent aux symptômes généraux qui réunissent toutes les variantes cliniques de l'alcoolisme. Ils se forment systématiquement au cours du développement de la maladie.
P.Premier stade de l'alcoolisme caractérisé par les caractéristiques suivantes : 1) Attirance pathologique primaire pour l'alcool. L'envie d'alcool apparaît dans certaines situations. Se préparer à boire de l'alcool s'accompagne d'émotions positives. La prise de la première dose accélère l'utilisation des doses suivantes jusqu'à un état d'intoxication plus prononcé. Un signe extérieur de ceci est ce qu'on appelle. Symptôme de pain grillé anticipé Boire de l'alcool jusqu'au fond. Le signe le plus important de dépendance mentale est Contrôle quantitatif et situationnel réduit, Lorsque les patients commencent à boire régulièrement au point de devenir une intoxication alcoolique grave et le font là où ils ne sont pas autorisés (par exemple, en présence de leurs supérieurs immédiats). 2) Une augmentation de la tolérance à l'alcool est déterminée par le fait que la dose initialement consommée ne provoque pas une agréable sensation d'ivresse et nécessite de prendre plus d'alcool ou de passer à des boissons plus fortes. 3) L'amnésie d'intoxication se manifeste plus souvent sous forme de palimpsestes. Les palimpsestes d'ivresse se manifestent par le fait que des fragments de certains événements survenus en état d'ébriété tombent hors de la mémoire.
Le premier stade de l'alcoolisme est généralement diagnostiqué chez les personnes âgées de 16 à 35 ans. Sa durée est le plus souvent de 1 à 6 ans.
Deuxième étape de l'alcoolisme caractérisé par une aggravation de tous les symptômes du premier stade. De plus, on note : 1) L'apparition d'un syndrome de sevrage (gueule de bois). 2) Formation d'une consommation excessive d'alcool ou d'un abus d'alcool systématique (constant). 3) Affûtage des traits de personnalité prémorbides.
L'attirance pathologique pour l'alcool se produit non seulement dans certaines situations, mais aussi spontanément. Deux variantes de l'attraction pathologique primaire sont décrites. La première s'accompagne d'une lutte de motivations (« boire ou ne pas boire »), puisque l'abus d'alcool contredit les normes sociales et éthiques du patient et de son environnement. Elle survient plus souvent aux premiers stades de la maladie, lorsque le patient tente de lutter de manière autonome contre sa dépendance : il visite les magasins, sort de la ville pour le week-end ; ne rencontre pas d'amis. Mais après un certain temps, une panne survient. La deuxième option suppose l’absence de lutte des motivations. Le patient lui-même propose des raisons pour boire de l'alcool. Dans ce cas, prévenir l’alcoolisme est beaucoup plus difficile. Dans la deuxième étape, on note Perte totale du contrôle quantitatif- le patient s'enivre toujours et partout. Une certaine dose d’alcool (« critique ») provoque une envie irrésistible (compulsive) de boire « jusqu’à s’évanouir ».
installée Tolérance maximale A l'alcool, qui n'évolue pas longtemps (plateau de tolérance). Événement Changer l’image de l’ivresse : La période d'euphorie diminue, les intoxications de type dysphorique surviennent plus souvent. Amnésie alcoolique Devenez systématique.
Syndrome de sevrage alcoolique(AAS) est un complexe de troubles neurovégétatifs, somato-neurologiques et psychopathologiques qui surviennent chez les patients alcooliques suite à l'arrêt ou à une forte réduction de l'alcoolisme.
Vous pouvez trouver des noms tels que syndrome de sevrage, état de sevrage (dans la CIM-10), syndrome de la gueule de bois, syndrome du deuxième jour, etc. Il a été décrit pour la première fois par le psychiatre domestique S. G. Zhislin (1935), qui a défini son symptôme principal comme « des troubles causés par des excès alcooliques antérieurs, qui ne s’atténuent ou ne disparaissent complètement qu’après une consommation répétée de certaines doses d’alcool.
On distingue les variantes suivantes de l'AAS : 1) Avec une prédominance de composantes végétatives (1er degré de gravité). Caractérisé par des sueurs, une tachycardie, une bouche sèche, une diminution de l'appétit. L’envie de s’enivrer ne se réalise pas toujours immédiatement. La circonstance limitante réside dans des raisons sociales et éthiques (par exemple, la nécessité de conduire le matin). Par conséquent, la gueule de bois est reportée au soir. La durée de l’AAS peut aller jusqu’à une journée. 2) SAA avec prédominance de troubles végétatifs-somatiques et neurologiques (2e degré). On l'observe généralement après plusieurs jours d'abus. Cliniquement, on observe une hyperémie et des gonflements du visage, une injection sclérale, une tachycardie avec extrasystole, des douleurs cardiaques, des fluctuations de la tension artérielle, des tremblements des mains, des troubles de la démarche, des réflexes tendineux inégaux et des troubles du sommeil. Les maladies chroniques du tractus gastro-intestinal inférieur et du système cardiovasculaire s'aggravent souvent. Ils ont généralement la gueule de bois le matin, car les facteurs socio-éthiques passent au second plan. 3) L'AAS avec une prédominance de la composante mentale (3ème degré) se caractérise par une attitude anxieuse-paranoïaque, une humeur peu anxieuse. Les fluctuations quotidiennes de l'affect sont fréquentes, avec une amélioration relative dans la première moitié de la journée. Il peut y avoir des pensées suicidaires. Le sentiment de culpabilité se conjugue à une attitude négative envers les autres et leur rejet, ce qui peut aggraver encore la dépression. Sommeil superficiel, agité de cauchemars. Ils ont tout le temps la gueule de bois. Durée 2-5 jours. Les psychoses alcooliques surviennent dans le contexte d'AAS de grade 3.
Le SAA doit être distingué du syndrome post-intoxication, qui peut survenir chez des personnes ne souffrant pas d'alcoolisme au lendemain d'un alcoolisme massif. Les manifestations somatovégétatives sont similaires dans les deux syndromes. La différence fondamentale sera l’absence de besoin d’alcool chez les non-alcooliques. De plus, la vue, l’odorat et même la mention de l’alcool leur provoqueront du dégoût, notamment des nausées et des vomissements.
Dans la deuxième étape, les types d'abus d'alcool suivants se forment : 1) Type permanent Caractérisé par une consommation quotidienne ou quasi quotidienne d'alcool. 2) Type périodique, Ou Pseudo-binges, Ce caractère consiste à alterner des périodes d'ivresse quotidienne avec des intervalles pendant lesquels le patient ne boit pas d'alcool. Les pseudo-binges diffèrent des véritables beuveries (voir ci-dessous) en ce qu'elles sont provoquées par des occasions sociales (rencontre entre amis, fin de semaine, salaire, vacances, ennuis, etc.) et sont également interrompues sous l'influence de la situation ( manque d'argent, besoin d'aller travailler, face à des menaces de répression familiale, etc.). Type intermittent (mixte), Lorsque, dans un contexte d'ivresse constante, des périodes de son intensification sont observées avec la consommation d'alcool à doses maximales (une combinaison d'une forme constante et de pseudo-frénésie).
A partir du deuxième stade, l'apparition d'une psychose alcoolique (voir ci-dessous) est possible aussi bien sur fond de syndrome de la gueule de bois qu'au plus fort de l'ivresse lors d'une frénésie.
Au deuxième stade de l’alcoolisme, des changements dans la personnalité du patient commencent à apparaître, souvent sous la forme Affûtage des caractéristiques prémorbides. Cela s'accompagne de troubles de la sphère émotionnelle sous forme de labilité émotionnelle, de rugosité et d'excitabilité.
Le deuxième stade de la maladie se forme généralement entre 25 et 35 ans après un abus d'alcool pendant 10 à 15 ans.
Troisième étape se caractérise par une aggravation de toutes les manifestations notées dans la seconde, ainsi que par l'apparition d'une véritable consommation excessive d'alcool et d'une dégradation de la personnalité.
L'attraction pathologique est comparable en force à la faim et à la soif (caractère compulsif de l'attraction). La perte du contrôle quantitatif s'accompagne d'une perte totale du contrôle situationnel : la prise d'une petite dose d'alcool entraîne l'émergence d'une attirance irrésistible avec le désir de l'obtenir par tous les moyens, y compris illégalement. La consommation d’alcool peut se faire dans les endroits les plus inappropriés. Des substituts d'alcool (alcool technique, eaux de Cologne, lotions, etc.) sont souvent utilisés.
L'un des symptômes les plus importants de la troisième étape est Diminution de la tolérance à l'alcool.
Il y a un changement prononcé dans l'image de l'intoxication avec une prédominance d'affect dysphorique. Dans certains cas, chez certains patients, l'intoxication est représentée par une image de stupeur alcoolique : les patients sont léthargiques, passifs, répondent aux questions avec retard et ne sont capables d'effectuer que des actions simples. Les patients du troisième stade se caractérisent par une amnésie alcoolique totale, qui se manifeste lors de la prise de doses d'alcool relativement faibles. Le syndrome de sevrage est généralement du 3ème degré de gravité.
La troisième étape est caractérisée par De vraies crises de boulimie(interrompu en raison de l'impossibilité pour le patient lui-même de continuer à boire de l'alcool). Ils sont précédés d’une attirance (compulsive) non provoquée et irrésistible. Le premier jour de la frénésie, buvez la quantité maximale. Les jours suivants, en raison d'une diminution de la tolérance, la dose diminue. A la fin de la frénésie, une intolérance se développe, conduisant à l'arrêt de l'alcoolisme.
Persistant Changements de personnalité : 1) La dégradation de type psychopathique se caractérise par un changement de comportement, se manifestant par un cynisme grossier, de l'agressivité, une franchise agaçante et le désir de dénigrer les autres. 2) La dégradation de l’alcool avec une prédominance d’euphorie se caractérise par une humeur complaisante et insouciante avec une forte diminution des critiques à l’égard de sa position et de son environnement. Les patients se caractérisent par ce qu'on appelle l'humour alcoolique avec des clichés primitifs et des blagues stéréotypées, principalement sur des sujets alcooliques et sexuels. 3) La dégradation de l'alcool avec spontanéité se caractérise par la léthargie, la passivité, une diminution de la motivation, une perte totale d'intérêt et d'initiative. L'activité n'apparaît que lors de l'achat d'alcool.
Les conséquences somatiques au troisième stade sont difficilement réversibles (cirrhose du foie, pancréatite, polyneuropathie, etc.).
La dynamique de l'alcoolisme s'exprime non seulement par les étapes, mais aussi par la vitesse de formation des symptômes, c'est-à-dire Progression de la maladie. Pour évaluer le degré de progression, le moment de la formation du SAA après le début de l'abus systématique d'alcool est utilisé. Si la SA se développe avant l'âge de 6 ans, un degré élevé de progression de la maladie est diagnostiqué, si entre 7 et 15 ans - en moyenne et plus de 15 ans - un faible degré de progression.
La dynamique de l'alcoolisme est déterminée par de nombreux facteurs : de la prédisposition héréditaire, du type de personnalité, de la présence
Maladies neuropsychiatriques ou autres pathologies concomitantes, sexe, âge, qualité et quantité des boissons alcoolisées consommées.
Mécanismes de défense psychologique dans l'alcoolisme
La grande majorité des personnes qui abusent systématiquement ou périodiquement de l’alcool nient l’existence d’un problème. Cela est dû au fait que la composante émotionnelle négative de l'ivresse est nivelée à l'aide de mécanismes de défense psychologique qui forment l'état de ce qu'on appelle Anosognosie alcoolique. C'est-à-dire le déni de la présence de signes de la maladie. Les mécanismes de défense psychologique changent à mesure que la maladie progresse à chaque étape, offrant ainsi un état émotionnel relativement acceptable au patient. Les mécanismes de défense psychologiques se forment au niveau subconscient. Les patients peuvent croire sincèrement ce qu’ils disent. Par conséquent, le succès du traitement de la maladie est invariablement associé à la découverte et au dépassement de ces mécanismes.
Au stade initial, il est noté Ignorer l'ivresse. Le problème n’est tout simplement pas reconnu en principe. Tous. les remontrances des parents et amis passent. Le patient croit que tout le monde autour de lui a tort et est partial.
De plus, lorsqu'il devient impossible de nier l'alcoolisme massif auquel le patient est susceptible, Changement d’accent. Le changement d’orientation se manifeste par la minimisation de l’ampleur de l’ivresse et la réévaluation des événements dans la direction souhaitée pour le patient. Formé Défense perceptuelle Lorsque seul ce qui est cohérent avec les attitudes personnelles de l'individu est sélectionné parmi ce qui se passe. Un exemple est le fait qu'à la question d'un médecin : « À quelle fréquence buvez-vous ? », les patients répondent invariablement : « Cela varie, parfois je ne bois pas pendant un mois entier (une semaine, deux mois, etc.). »
Aux stades ultérieurs, la défense perceptuelle cède la place à Rationalisation motivationnelle, Lorsque les données sont sélectionnées conformément aux désirs personnels, garantissant une conclusion pratique nécessaire pour le moment. Divers arguments sont avancés pour justifier l'alcoolisme. Dans ce cas, le motif sera remplacé par une version (pseudo-motiv) à un niveau subconscient. Diverses raisons sont avancées pour expliquer que, de l’avis du patient,
ils ont « provoqué » un autre excès alcoolique (« mauvais patron », « femme ou belle-mère maigre », « mal de dents », etc.). La formation a lieu Système explicatif(système d’alibi), qui justifie le comportement du patient.
A la fin de la deuxième étape, on rencontre un système explicatif universel. Le patient explique son alcoolisme par le fait que « tout le monde autour boit », « l'ivresse est la norme dans notre vie sale ». Alors que la dégradation personnelle se développe au troisième stade de la maladie, Dépréciation- réduction ou disparition de la composante négative de la consommation excessive d'alcool.
Méthodes de diagnostic et d'identification de l'alcoolisme chronique
Récemment, divers tests permettant d'identifier l'alcoolisme ont été largement utilisés, qui peuvent également être utilisés dans des enquêtes de masse. En Occident, les tests CAGEAID (Cut down. Annoyance, Guilt, Eye opener questions Adapted to Include Drags) et T-ACE (Take, Annoyance, Cut down, Eye opener - adaptés aux femmes) se sont généralisés.
Test CAGEAID
Avez-vous déjà pensé à réduire votre consommation d’alcool ? Drogues?
Vous sentez-vous agacé lorsque les gens vous critiquent parce que vous buvez ou consommez de la drogue ?
Vous êtes-vous déjà senti coupable de trop boire ou de consommer des drogues ?
Avez-vous déjà bu de l'alcool pour vous remonter le moral ou pour avoir la gueule de bois (Eye Opener) ? Avez-vous déjà consommé de la drogue pour vous motiver le matin ?
Deux réponses positives aux questions CAGEAID - suspicion d'alcoolisme.
Pour une étude plus approfondie, les tests MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) et AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) sont utilisés.

2 Score : 0-4 = sans alcool ; 5-6 = suspicion d'alcoolisme ; 7 ou plus = alcoolisme.

Littérature
1. Altshuler V. B. Alcoolisme // Guide de psychiatrie / Ed. A.S. Tiganova. - M. : Médecine, 1999. T. 2. P. 250-338.
2. Alcoolisme : (Guide du médecin) / Éd. G. V. Morozova, V. E. Rozhnova, E. A. Babayan. - M. : Médecine, 1983. - 432 p.
3. Bekhtel E. E. Formes prénosologiques d'abus d'alcool. - M. : Médecine, 1986. - 272 p.
4. Dunaevsky V.V., Styazhkin V.D. Toxicomanie et toxicomanie. - P. : Médecine, 1991. - 214 p.
5. Egorov A. Yu. Fondamentaux de la narcologie : manuel. allocation. - Saint-Pétersbourg : ISPIP, 2000. - 46 p.
6. Conférences sur la dépendance. 2e éd. / Éd. N.N. Ivanets. - M. : Nolidzh, 2000. - 448 p.
7. Classification internationale des maladies. (10e révision). Classification des troubles mentaux et comportementaux. Descriptions cliniques et directives diagnostiques : Trans. en russe langue / Éd. Yu. L. Nullera, S. Yu. Tsirkina. - Saint-Pétersbourg : Adis, 1994. - 303 p.
8. Pyatnitskaya I. N. Abus d'alcool et stade initial de l'alcoolisme. - L. : Médecine, 1988. - 285 p.
9. Narcologie / Éd. L. S. Friedman et autres - M. : Binom ; Saint-Pétersbourg : dialecte Nevski, 1998. - 318 p.
10. Shabanov P.D. Guide de narcologie. 2e éd. - Saint-Pétersbourg : Lan, 1999. - 352 p.
La dépendance à l'alcool a longtemps été considérée non seulement comme une dépendance, mais comme une maladie dangereuse qui comporte plusieurs stades de développement. Déterminer la gravité de l'alcoolisme vous permet de clarifier jusqu'où est allé le problème et de sélectionner le schéma thérapeutique le plus approprié.
Classification généralement acceptée
Selon la classification généralement acceptée de la maladie, il existe 4 stades de l'alcoolisme, qui diffèrent par la gravité de la dépendance, la fréquence de consommation d'alcool et les conséquences de sa consommation.
Séparément, les experts distinguent le stade prodromique (zéro), qui n'est pas encore considéré comme une maladie, mais qui constitue également une condition dangereuse, car en quelques mois seulement, elle peut évoluer vers l'alcoolisme.
Cette étape est caractérisée par « l'ivresse quotidienne » - une consommation épisodique d'alcool, qui provoque souvent une gueule de bois. Après de lourdes libations, les pensées sur l'alcool provoquent du dégoût pendant un certain temps, de sorte que la personne n'a plus envie de boire. De plus, à ce stade, le corps a encore la capacité de rejeter de grandes quantités d’alcool, éliminant l’excès par les vomissements.

D'abord
Le stade initial de la maladie est caractérisé par l'émergence d'une dépendance mentale à l'alcool, se manifestant par un fort désir constant de boire, que le patient peut surmonter si nécessaire. La fréquence de consommation et la dose d’alcool consommée augmentent. L'alcool a un effet extrêmement négatif sur le corps, donc déjà à ce stade se produisent les premiers changements somatiques, qu'une personne n'associe pas encore à la consommation de boissons fortes. La phase primaire du développement de la dépendance dure de 1 à 5 ans.
Deuxième
Au stade 2 de la dépendance, la résistance à l'alcool augmente, de sorte qu'une personne commence à boire de l'alcool de plus en plus souvent. L'envie de boissons fortes augmente, le lendemain survient une grave gueule de bois, dont le patient cherche à se débarrasser en buvant à nouveau de l'alcool. Cela conduit souvent à des crises de boulimie qui durent plusieurs jours. Les symptômes des maladies somatiques s'aggravent, les troubles mentaux progressent. La durée du stade 2 de l'addiction varie de 5 à 15 ans.
Déjà à ce stade, le syndrome de sevrage survient : si l'éthanol ne pénètre pas dans l'organisme pendant une longue période, la santé du toxicomane se détériore considérablement, on observe des troubles du sommeil, une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence cardiaque, une transpiration accrue, un manque d'appétit et des hallucinations.
À ce stade, de nombreux alcooliques nient le problème et croient fermement qu’ils peuvent arrêter complètement de boire de l’alcool à tout moment.
Troisième
L'alcoolisme chronique de stade 3 s'accompagne d'une forte dépendance à l'alcool, qui nécessite la consommation quotidienne de boissons fortes, une diminution de la résistance à l'alcool et le développement d'une encéphalopathie, caractérisée par des modifications du tissu cérébral et un dysfonctionnement de l'organe. Les crises de boulimie à ce stade durent de 1 semaine à plusieurs mois. Des psychoses alcooliques se développent souvent.

Quatrième
Le quatrième est le stade le plus grave de l'alcoolisme, au cours duquel les processus de pensée sont perturbés et une dégradation complète de la personnalité se produit. En raison d'une intoxication continue à long terme du corps par l'éthanol, de multiples anomalies se développent dans le fonctionnement de tous les systèmes internes, ce qui conduit rapidement à des maladies graves (cirrhose du foie, cancer, infarctus du myocarde, insuffisance rénale et hépatique) et à la mort.
Le pronostic de cette forme d'alcoolisme est défavorable : l'espérance de vie moyenne des patients est de 3 à 6 ans.
Au stade 4 de l'addiction, il n'est plus possible d'arrêter de boire et de retrouver la santé au moins partiellement.
Selon Bechtel
En 1986, docteur en sciences médicales, psychiatre E. I. Bechtel a développé sa propre classification de l'alcoolisme (« ivresse domestique »), proposant de diviser les personnes en 4 groupes en fonction de la fréquence de consommation d'alcool et de la quantité d'alcool :
- abstinents - ceux qui n'ont pas pris d'alcool depuis un an ou qui en ont consommé à petites doses (jusqu'à 100 g de vin 2 à 3 fois sur 12 mois) ;
- buveurs occasionnels - ne buvant pas plus de 250 ml de vodka 1 à 2 fois par mois ou 2 à 3 fois par an ;
- buveurs modérés - prenant 100 à 150 ml (maximum 400 ml) d'alcool plusieurs fois par mois ;
- buveurs systématiques - buvez de l'alcool à raison de 200 à 500 ml 1 à 2 fois par semaine;
- les buveurs habituels boivent une bouteille de vodka ou autre alcool 2 à 3 fois par semaine.

Selon Fedotov
Le psychiatre domestique D. D. Fedotov distingue également 4 stades de la maladie, chacun étant déterminé par le degré de dépendance de l'alcoolique aux boissons alcoolisées.
Au début (premier) stade de la dépendance, une personne prend de l'alcool pour soulager le stress, se détendre et ressentir un confort intérieur. Au stade 2, une tolérance aux dosages habituels d'alcool se développe et le patient commence donc à boire plus d'alcool. Au stade 3, d'autres signes d'alcoolisme incluent le syndrome de sevrage, que la personne dépendante soulage à l'aide de la gueule de bois.
Au stade 4 de la maladie, l'alcoolique subit de graves troubles du fonctionnement des organes internes et du psychisme, qui sont aggravés par une consommation ultérieure d'alcool. Cette étape mène inévitablement à la mort, estime Fedotov.

Méthodes de détermination
Le diagnostic de l'alcoolisme consiste en un entretien détaillé du patient, réalisé par un narcologue ou un psychothérapeute. Cependant, vous pouvez reconnaître vous-même ou vos proches une dépendance à un stade précoce en prêtant attention aux signes suivants :
- Le désir obsessionnel de boire apparaît de plus en plus souvent et les raisons de boire deviennent souvent farfelues.
- Le contrôle sur la quantité d'alcool est perdu, tandis que la personne commet des actes irréfléchis, se comporte de manière inappropriée, perd le contrôle de soi, devient agressive et inadéquate. De manière caractéristique, il n’y a pas de vomissements même avec une grande quantité d’alcool dans le sang.
- Les pertes de mémoire (amnésie alcoolique) se produisent de plus en plus : une personne ne se souvient pas des événements qui lui sont arrivés en état d'ébriété.
- Une personne peut boire de l’alcool plusieurs jours de suite.
- L'abstinence forcée d'alcool provoque de l'irritabilité, de la mauvaise humeur et un inconfort interne.
- Le patient nie le problème, prétend qu'il peut arrêter quand il le souhaite ou justifie sa consommation fréquente d'alcool par des raisons extérieures.

Aux stades ultérieurs de la dépendance à l'alcool, une personne boit constamment de l'alcool et l'intoxication se produit même aux plus petites doses. Il cesse de prendre soin de son apparence, se désintéresse de son environnement, cesse de communiquer avec sa famille et ses amis et consacre tout son temps libre dans le seul but de boire. Pour satisfaire le besoin d'éthanol, en l'absence d'alcool de haute qualité, le toxicomane peut prendre n'importe quel type de liquide contenant de l'alcool.
Traitement à différentes étapes
L'alcoolisme de stade 1 est le plus facile à traiter. Pour se débarrasser de la dépendance, le patient doit suivre une thérapie psychologique individuelle ou de groupe et se rendre dans un établissement médical pour éliminer les troubles somatiques provoqués par la consommation d'alcool. Le soutien des proches joue un rôle important. L'utilisation d'outils spécialisés n'est pas requise à ce stade.
Si une personne souffre d'alcoolisme de stade 2 et 3, il est tout d'abord nécessaire de suivre une thérapie de désintoxication visant à éliminer les manifestations du syndrome de sevrage et à éliminer les substances nocives du corps.
Cela facilite grandement l'envie d'alcool, réduisant ainsi la dépendance physiologique à l'alcool.
Après cela, un schéma thérapeutique individuel est sélectionné. La pharmacothérapie implique l'utilisation de médicaments qui provoquent une aversion pour l'alcool ou provoquent des conséquences négatives prononcées lors de la consommation d'alcool, ce qui réduit également le besoin de boissons fortes.
À une époque, E. Jellinek (1946, 1952) proposait la typologie suivante de patients alcooliques : alpha (« ivrognes de conflit » ; la dépendance mentale et la perte de contrôle ne sont pas observées) ; bêta (« buveurs sociaux », buveurs pour une raison précise avec manque de dépendance et perte de contrôle) ; gamma (« ivrognes dépendants » qui développent d’abord une dépendance mentale, puis physique et une perte de contrôle) ; delta (« ivrognes habituels », chez qui il existe une dépendance mentale, mais aucun syndrome de sevrage ne s'est formé et il n'y a pas de perte de contrôle lors de la consommation d'alcool) ; epsilon (« ivrognes épisodiques » avec dépendance mentale et cas de perte de contrôle).
Les éléments de construction d'une classification de l'alcoolisme doivent actuellement prendre en compte le stade de la maladie (I, I-II, II, II-II, III), le taux d'évolution (favorable, moyennement évolutif, malin) et la forme ou le type. de la consommation d'alcool (constante, périodique sous forme de fausses et vraies beuveries, mixtes ou intermittentes).
La notion d'alcoolisme chronique dans la CIM-9 (303) correspond au syndrome de dépendance résultant de la consommation d'alcool (F10.2). Très tôt, trois stades d'alcoolisme ont été distingués (selon la CIM −9) : I - 303.1 ; II-303.2 et III-303.3.
La compréhension des modèles statiques et dynamiques de l'alcoolisme nous permet de résoudre efficacement les problèmes de prévention précoce et de diagnostic rapide de l'alcoolisme, de traitement efficace et de réadaptation des patients souffrant de cette maladie.
Fardeau héréditaire de l'alcoolisme ; des traits de caractère hystériques, schizoïdes et excitables dans la personnalité prémorbide, un niveau initialement élevé de tolérance à l'éthanol, selon nos données, peuvent être des lignes directrices originales pour identifier un groupe à risque de développement de l'alcoolisme avec la consommation systématique de boissons alcoolisées.
Le diagnostic de l'alcoolisme implique non seulement de reconnaître les principaux syndromes, mais également de déterminer la structure et la dynamique de la maladie dans son ensemble.
A noter que l'abus d'alcool n'exclut pas l'abstinence à long terme d'en prendre.
Pour le diagnostic de dépistage, le questionnaire CAGE est actuellement souvent utilisé, dans lequel une réponse positive à l'une des 4 questions indique une dépendance cachée à l'alcool et sert d'indication pour un interrogatoire ou un examen plus approfondi.
Le traitement ciblé et la réadaptation des patients alcooliques sont presque impossibles sans prendre en compte les informations sur les principaux facteurs qui déterminent les schémas structurels et dynamiques de la maladie qui influencent les syndromes alcooliques.
Identification de diverses formes de perte de contrôle quantitatif lors de la consommation d'alcool, d'aversion primaire et secondaire pour les boissons alcoolisées, des principales étapes de la formation de la dégradation de la personnalité alcoolique et du syndrome psychoorganique, des composantes de l'anagnosie, des variantes cliniques de la formation de schémas altérés d'intoxication et , enfin, les types d'évolution de la maladie, en tant que composant efficace, sont nécessaires pour construire une classification détaillée de l'alcoolisme.
|
Types d'alcoolisme Progressif lentement
Modérément progressif
Malin
|
L'identification et le diagnostic différentiel des signes de dégradation de la personnalité alcoolique et des symptômes du syndrome psychoorganique jouent un rôle particulier dans l'expertise (médicale, professionnelle, judiciaire) d'un patient alcoolique.
Les indicateurs pronostiques de l'évolution de la maladie, nécessaires à la prévention de ses complications, à la sélection de tactiques thérapeutiques optimales et à la mise en œuvre de mesures de réadaptation, revêtent une importance particulière.
|
Classification moderne de l'alcoolisme (ICD-10)
|
L'intoxication aiguë causée par la consommation d'alcool dans la CIM-10 est désignée par le code F10.0 (intoxication légère - F.10.01, intoxication modérée - F10.02, intoxication grave - F10.03).
Lire aussi...
- Pourquoi rêvez-vous du dos d'un homme ?
- La bonne aventure avec des cœurs en ligne : un moyen simple et gratuit de prédire l'amour d'un homme
- Interprétation des rêves : voler au-dessus du sol dans un rêve
- Description du zeste d'orange avec photo, sa teneur en calories ; comment faire à la maison ; utilisation du produit en cuisine; méfaits et propriétés bénéfiques