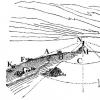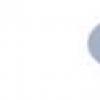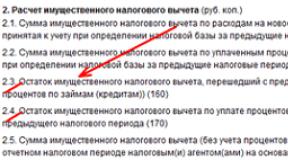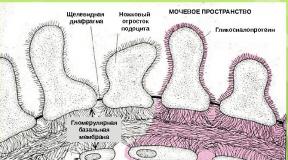A quoi ressemble un bubon de la peste ? Traitement de la peste. Indications et contre-indications à la vaccination
Peste- une infection transmissible zoonotique aiguë, particulièrement dangereuse, avec intoxication grave et inflammation séreuse-hémorragique des ganglions lymphatiques, des poumons et d'autres organes, ainsi que le développement possible d'une septicémie.
Brèves informations historiques
Il n’existe aucune autre maladie infectieuse dans l’histoire de l’humanité qui puisse entraîner une dévastation et une mortalité aussi colossales parmi la population que la peste. Depuis l'Antiquité, des informations ont été conservées sur la peste, qui s'est déclarée chez l'homme sous la forme d'épidémies entraînant un grand nombre de décès. Il a été noté que les épidémies de peste se développaient à la suite de contacts avec des animaux malades. Parfois, la propagation de la maladie ressemblait à une pandémie. Il existe trois pandémies de peste connues. La première, connue sous le nom de peste de Justinien, a fait rage en Égypte et dans l’Empire romain d’Orient de 527 à 565. La seconde, dite de la « grande » ou « noire » mort, en 1345-1350. couvrait la Crimée, la Méditerranée et l'Europe occidentale; Cette pandémie des plus dévastatrices a coûté la vie à environ 60 millions de personnes. La troisième pandémie a débuté en 1895 à Hong Kong, puis s’est propagée à l’Inde, où plus de 12 millions de personnes sont mortes. À ses débuts, d'importantes découvertes ont été faites (l'agent pathogène a été isolé, le rôle des rats dans l'épidémiologie de la peste a été prouvé), qui ont permis d'organiser la prévention sur des bases scientifiques. L'agent causal de la peste a été découvert par G.N. Minkh (1878) et indépendamment de lui A. Yersin et S. Kitazato (1894). Depuis le XIVe siècle, la peste s'est rendue à plusieurs reprises en Russie sous forme d'épidémies. Travaillant sur les épidémies pour prévenir la propagation de la maladie et soigner les patients, les scientifiques russes D.K. ont apporté une grande contribution à l'étude de la peste. Zabolotny, N.N. Klodnitski, I.I. Mechnikov, N.F. Gamaleya et autres Au 20ème siècle N.N. Joukov-Verezhnikov, E.I. Korobkova et G.P. Rudnev a développé les principes de la pathogenèse, du diagnostic et du traitement des patients atteints de peste et a également créé un vaccin anti-peste.
L’émergence de la peste
L'agent causal est une bactérie anaérobie facultative à Gram négatif, non mobile, Y. pestis, du genre Yersinia de la famille des Enterobacteriaceae. Dans de nombreuses caractéristiques morphologiques et biochimiques, le bacille de la peste est similaire aux agents pathogènes de la pseudotuberculose, de la yersiniose, de la tularémie et de la pasteurellose, qui provoquent de graves maladies chez les rongeurs et les humains. Il se distingue par un polymorphisme prononcé, les plus typiques étant des bâtonnets ovoïdes qui se colorent de manière bipolaire. Il existe plusieurs sous-espèces de l'agent pathogène, de virulence différente. Pousse sur un milieu nutritif régulier avec l'ajout de sang hémolysé ou de sulfite de sodium pour stimuler la croissance. Contient plus de 30 antigènes, exo- et endotoxines. Les capsules protègent les bactéries de l'absorption par les leucocytes polymorphonucléaires, et les antigènes V et W les protègent de la lyse dans le cytoplasme des phagocytes, ce qui assure leur reproduction intracellulaire. L'agent causal de la peste est bien conservé dans les excréments des patients et des objets de l'environnement extérieur (dans le pus d'un bubon, il persiste pendant 20 à 30 jours, dans les cadavres de personnes, de chameaux, de rongeurs - jusqu'à 60 jours), mais il est très sensible à la lumière du soleil, à l’oxygène atmosphérique, aux températures élevées, aux réactions environnementales (en particulier acides) et aux produits chimiques (y compris les désinfectants). Sous l'influence du chlorure mercurique dilué au 1:1000, il meurt en 1 à 2 minutes. Tolère les basses températures et bien la congélation.
Épidémiologie
Une personne malade peut, dans certaines conditions, devenir source d'infection : avec le développement d'une peste pneumonique, un contact direct avec le contenu purulent d'un bubon de la peste, ainsi qu'à la suite d'une infection par des puces sur un patient atteint de septicémie pesteuse. Les cadavres des personnes décédées de la peste sont souvent la cause directe de l'infection d'autrui. Les patients atteints de peste pneumonique sont particulièrement dangereux.
Mécanisme de transmission diverses, le plus souvent transmissibles, mais des gouttelettes en suspension dans l'air sont également possibles (avec des formes pneumoniques de peste, une infection en laboratoire). Les porteurs de l'agent pathogène sont les puces (environ 100 espèces) et certains types de tiques, qui soutiennent le processus épizootique dans la nature et transmettent l'agent pathogène aux rongeurs synanthropes, aux chameaux, aux chats et aux chiens, qui peuvent transporter les puces infectées jusqu'aux habitations humaines. Une personne n'est pas infectée tant par une piqûre de puce qu'après avoir frotté ses excréments ou les masses régurgitées lors de l'alimentation sur la peau. Les bactéries qui se multiplient dans les intestins d'une puce sécrètent de la coagulase, qui forme un « bouchon » (blocage de la peste) qui empêche la circulation du sang dans son corps. Les tentatives d'un insecte affamé de sucer du sang s'accompagnent d'une régurgitation de masses infectées à la surface de la peau au niveau du site de la morsure. Ces puces ont faim et tentent souvent de sucer le sang de l'animal. La contagiosité des puces dure en moyenne environ 7 semaines et, selon certaines données, jusqu'à 1 an.
Des contacts (par la peau et les muqueuses endommagées) lors de la découpe des carcasses et du traitement des peaux d'animaux infectés tués (lièvres, renards, saïgas, chameaux, etc.) et des voies nutritionnelles (en mangeant leur viande) d'infection par la peste sont possibles.
La susceptibilité naturelle des personnes est très élevée, absolue dans tous les groupes d’âge et quelle que soit la voie d’infection. Après une maladie, une immunité relative se développe, qui ne protège pas contre une réinfection. Les cas répétés de la maladie ne sont pas rares et ne sont pas moins graves que les cas primaires.
Principales caractéristiques épidémiologiques. Les foyers naturels de peste occupent 6 à 7 % de la masse terrestre du globe et sont enregistrés sur tous les continents, à l'exception de l'Australie et de l'Antarctique. Chaque année, plusieurs centaines de cas de peste humaine sont enregistrés dans le monde. Dans les pays de la CEI, 43 foyers naturels de peste ont été identifiés avec une superficie totale de plus de 216 millions d'hectares, situés dans les régions de plaine (steppe, semi-désertique, désert) et de haute montagne. Il existe deux types de foyers naturels : les foyers de peste « sauvage » et les foyers de peste du rat. Dans les foyers naturels, la peste se manifeste par une épizootie chez les rongeurs et les lagomorphes. L'infection par les rongeurs qui ne dorment pas en hiver (marmottes, spermophiles, etc.) survient pendant la saison chaude, tandis que par les rongeurs et les lagomorphes qui ne dorment pas en hiver (gerbilles, campagnols, pikas, etc.), l'infection connaît deux pics saisonniers. , qui est associé aux périodes de reproduction des animaux. Les hommes tombent plus souvent malades que les femmes du fait de leurs activités professionnelles et restent dans un foyer naturel de peste (transhumance, chasse). Dans les foyers anthropurgiques, le rôle de réservoir d'infection est assuré par les rats noirs et gris. L'épidémiologie de la peste bubonique et pneumonique présente des différences significatives dans ses caractéristiques les plus importantes. La peste bubonique se caractérise par une progression relativement lente de la maladie, tandis que la peste pneumonique, en raison de la transmission facile des bactéries, peut se propager en peu de temps. Les patients atteints de la forme bubonique de la peste sont peu contagieux et pratiquement non infectieux, car leurs sécrétions ne contiennent pas d'agents pathogènes et il y a peu ou pas d'agents pathogènes dans le matériel provenant des bubons ouverts. Lorsque la maladie passe à la forme septique, ainsi que lorsque la forme bubonique se complique d'une pneumonie secondaire, lorsque l'agent pathogène peut être transmis par des gouttelettes en suspension dans l'air, de graves épidémies de peste pneumonique primaire se développent avec une très forte contagiosité. Généralement, la peste pneumonique suit la peste bubonique, se propage avec elle et devient rapidement la principale forme épidémiologique et clinique. Récemment, l'idée selon laquelle l'agent causal de la peste peut rester longtemps dans le sol à l'état inculte a été intensément développée. Une primo-infection des rongeurs peut survenir lors du creusement de trous dans des zones de sol infectées. Cette hypothèse s'appuie à la fois sur des études expérimentales et sur des observations sur l'inutilité de rechercher le pathogène chez les rongeurs et leurs puces en période inter-épizootique.
Evolution de la maladie Peste
Les mécanismes d'adaptation humaine ne sont pratiquement pas adaptés pour résister à l'introduction et au développement du bacille de la peste dans l'organisme. Ceci s'explique par le fait que le bacille de la peste se multiplie très rapidement ; les bactéries produisent de grandes quantités de facteurs de perméabilité (neuraminidase, fibrinolysine, pesticine), d'antiphagines qui suppriment la phagocytose (F1, HMWPs, V/W-Ar, PH6-Ag), ce qui contribue à une dissémination lymphogène et hématogène rapide et massive principalement dans les organes mononucléaires phagocytaires. système avec son activation ultérieure. L'antigénémie massive, la libération de médiateurs inflammatoires, dont des cytokines chocogènes, conduisent au développement de troubles microcirculatoires, syndrome DIC, suivis d'un choc infectieux-toxique.
Le tableau clinique de la maladie est largement déterminé par le site d'introduction de l'agent pathogène, pénétrant par la peau, les poumons ou le tractus gastro-intestinal.
La pathogenèse de la peste comprend trois étapes. Premièrement, l'agent pathogène se diffuse de manière lymphogène depuis le site d'introduction vers les ganglions lymphatiques, où il persiste pendant une courte période. Dans ce cas, un bubon de peste se forme avec le développement de modifications inflammatoires, hémorragiques et nécrotiques dans les ganglions lymphatiques. Les bactéries pénètrent alors rapidement dans la circulation sanguine. Au stade de la bactériémie, une toxicose sévère se développe avec des modifications des propriétés rhéologiques du sang, des troubles de la microcirculation et des manifestations hémorragiques dans divers organes. Et enfin, une fois que l'agent pathogène a surmonté la barrière réticulohistiocytaire, il se diffuse dans divers organes et systèmes avec le développement d'une septicémie.
Les troubles microcirculatoires provoquent des modifications du muscle cardiaque et des vaisseaux sanguins, ainsi que des glandes surrénales, ce qui provoque une insuffisance cardiovasculaire aiguë.
Avec la voie d'infection aérogène, les alvéoles sont touchées et un processus inflammatoire avec des éléments de nécrose s'y développe. La bactériémie ultérieure s'accompagne d'une toxicose intense et du développement de manifestations septiques-hémorragiques dans divers organes et tissus.
La réponse anticorps contre la peste est faible et se forme aux derniers stades de la maladie.
Symptômes de la peste
La période d'incubation est de 3 à 6 jours (en cas d'épidémie ou de formes septiques, elle est réduite à 1 à 2 jours) ; La période d'incubation maximale est de 9 jours.
Caractérisé par un début aigu de la maladie, exprimé par une augmentation rapide de la température corporelle jusqu'à des valeurs élevées accompagnées de frissons stupéfiants et le développement d'une intoxication grave. Les patients se plaignent généralement de douleurs au niveau du sacrum, des muscles et des articulations, ainsi que de maux de tête. Des vomissements (souvent sanglants) et une soif atroce surviennent. Dès les premières heures de la maladie, une agitation psychomotrice se développe. Les patients sont agités, trop actifs, essaient de courir (« court comme un fou »), ils ont des hallucinations et des délires. La parole devient difficile et la démarche est instable. Dans des cas plus rares, une léthargie, une apathie sont possibles et la faiblesse atteint un tel degré que le patient ne peut pas sortir du lit. Extérieurement, on note une hyperémie et des gonflements du visage et une injection sclérale. Il y a une expression de souffrance ou d’horreur sur le visage (« masque de peste »). Dans les cas plus graves, une éruption cutanée hémorragique peut apparaître sur la peau. Les signes très caractéristiques de la maladie sont un épaississement et un revêtement de la langue d’une épaisse couche blanche (« langue crayeuse »). Du côté du système cardiovasculaire, on note une tachycardie prononcée (jusqu'à l'embrycardie), une arythmie et une baisse progressive de la pression artérielle. Même avec les formes locales de la maladie, une tachypnée, ainsi qu'une oligurie ou une anurie, se développent.
Cette symptomatologie se manifeste, surtout dans la période initiale, dans toutes les formes de peste.
Selon la classification clinique de la peste proposée par G.P. Rudnev (1970), distinguent les formes locales de la maladie (cutanée, bubonique, cutanée-bubonique), les formes généralisées (septique primaire et septique secondaire), les formes disséminées extérieurement (pulmonaire primaire, pulmonaire secondaire et intestinale).
Forme cutanée. La formation d'un anthrax sur le site d'introduction de l'agent pathogène est caractéristique. Initialement, une pustule très douloureuse au contenu rouge foncé apparaît sur la peau ; elle est localisée sur le tissu sous-cutané œdémateux et est entourée d'une zone d'infiltration et d'hyperémie. Après ouverture de la pustule, il se forme un ulcère au fond jaunâtre, qui a tendance à grossir. Par la suite, le fond de l'ulcère est recouvert d'une croûte noire, après quoi des cicatrices se forment.
Forme bubonique. La forme de peste la plus courante. Caractérisé par des lésions des ganglions lymphatiques régionaux par rapport au site d'introduction de l'agent pathogène - inguinaux, moins souvent axillaires et très rarement cervicaux. Habituellement, les bubons sont uniques, moins souvent multiples. Dans le contexte d'une intoxication grave, des douleurs surviennent dans la zone delocalisation future du bubon. Après 1 à 2 jours, vous pouvez palper des ganglions lymphatiques très douloureux, d'abord de consistance dure, puis ramollis et devenant pâteux. Les ganglions fusionnent en un seul conglomérat, inactif en raison de la présence d'une périadénite, fluctuant à la palpation. La durée du pic de la maladie est d'environ une semaine, après quoi commence une période de convalescence. Les ganglions lymphatiques peuvent se résoudre d'eux-mêmes ou devenir ulcérés et sclérotiques en raison d'une inflammation séreuse-hémorragique et d'une nécrose.
Forme bubonique cutanée. C'est une combinaison de lésions cutanées et de modifications des ganglions lymphatiques.
Ces formes locales de la maladie peuvent évoluer vers une septicémie pesteuse secondaire et une pneumonie secondaire. Leurs caractéristiques cliniques ne diffèrent pas respectivement des formes septiques primaires et pulmonaires primaires de la peste.
Forme septique primaire. Elle survient après une courte période d'incubation de 1 à 2 jours et se caractérise par le développement ultra-rapide d'une intoxication, des manifestations hémorragiques (hémorragies de la peau et des muqueuses, hémorragies gastro-intestinales et rénales) et la formation rapide d'un tableau clinique d'infection. -choc toxique. Sans traitement, elle est mortelle dans 100 % des cas.
Forme pulmonaire primaire. Se développe lors d'une infection aérogène. La période d'incubation est courte, de quelques heures à 2 jours. La maladie débute de manière aiguë par des manifestations du syndrome d'intoxication caractéristique de la peste. Au 2-3ème jour de la maladie, une toux sévère apparaît, une douleur aiguë dans la poitrine et un essoufflement apparaissent. La toux s'accompagne de la libération d'expectorations vitreuses puis liquides, mousseuses et sanglantes. Les données physiques des poumons sont rares ; les radiographies montrent des signes de pneumonie focale ou lobaire. L'insuffisance cardiovasculaire augmente, se traduisant par une tachycardie et une baisse progressive de la pression artérielle, ainsi que le développement d'une cyanose. Au stade terminal, les patients développent d'abord un état de stupeur, accompagné d'un essoufflement accru et de manifestations hémorragiques sous forme de pétéchies ou d'hémorragies étendues, puis d'un coma.
Forme intestinale. Dans le contexte du syndrome d'intoxication, les patients ressentent de fortes douleurs abdominales, des vomissements répétés et une diarrhée accompagnée de ténesme et de selles abondantes et sanglantes. Étant donné que des manifestations intestinales peuvent être observées dans d'autres formes de la maladie, la question de l'existence de la peste intestinale en tant que forme indépendante, apparemment associée à une infection entérale, reste controversée jusqu'à récemment.
Diagnostic différentiel
Les formes cutanées, buboniques et buboniques de la peste doivent être distinguées de la tularémie, des anthrax, de diverses lymphadénopathies, des formes pulmonaires et septiques - des maladies pulmonaires inflammatoires et de la septicémie, y compris l'étiologie méningococcique.
Avec toutes les formes de peste, dès la période initiale, les signes d'intoxication grave, qui augmentent rapidement, sont alarmants : température corporelle élevée, frissons intenses, vomissements, soif atroce, agitation psychomotrice, agitation, délire et hallucinations. Lors de l’examen des patients, l’attention est attirée sur des troubles de l’élocution, une démarche instable, un visage gonflé et hyperémique avec injection sclérale, une expression de souffrance ou d’horreur (« masque de peste ») et une « langue crayeuse ». Les signes d'insuffisance cardiovasculaire, de tachypnée augmentent rapidement et l'oligurie progresse.
Les formes cutanées, buboniques et buboniques de la peste se caractérisent par des douleurs intenses au site de la lésion, des stades de développement de l'anthrax (pustule - ulcère - gale noire - cicatrice), des phénomènes prononcés de périadénite lors de la formation du bubon de la peste. .
Les formes pulmonaires et septiques se distinguent par le développement ultra-rapide d'une intoxication grave, des manifestations prononcées du syndrome hémorragique et un choc infectieux-toxique. Si les poumons sont touchés, on note une douleur aiguë dans la poitrine et une toux sévère, une séparation d'expectorations sanglantes vitreuses puis liquides. Les rares données physiques ne correspondent pas à l’état général extrêmement grave.
Diagnostic de la peste
Diagnostic de laboratoire
Basé sur l'utilisation de méthodes microbiologiques, immunosérologiques, biologiques et génétiques. L'hémogramme montre une leucocytose, une neutrophilie avec un déplacement vers la gauche et une augmentation de la VS. L'isolement de l'agent pathogène est effectué dans des laboratoires spécialisés de haute sécurité pour travailler avec des agents pathogènes d'infections particulièrement dangereuses. Des études sont menées pour confirmer les cas cliniquement significatifs de la maladie, ainsi que pour examiner les personnes présentant une température corporelle élevée qui sont à l'origine de l'infection. Le matériel provenant des malades et des morts est soumis à un examen bactériologique : ponctuations de bubons et d'anthrax, écoulements d'ulcères, crachats et mucus de l'oropharynx, sang. Le passage est effectué sur des animaux de laboratoire (cobayes, souris blanches), qui meurent 5 à 7 jours après l'infection.
Parmi les méthodes sérologiques utilisées figurent RNGA, RNAT, RNAG et RTPGA, ELISA.
Les résultats positifs de la PCR 5 à 6 heures après son administration indiquent la présence d'ADN spécifique du microbe de la peste et confirment le diagnostic préliminaire. La confirmation finale de l'étiologie pesteuse de la maladie est l'isolement d'une culture pure de l'agent pathogène et son identification.
Traitement de la peste
Les malades de la peste sont traités uniquement en milieu hospitalier. Le choix des médicaments pour la thérapie étiotrope, leurs doses et leurs schémas d'utilisation sont déterminés par la forme de la maladie. La durée du traitement étiotrope pour toutes les formes de la maladie est de 7 à 10 jours. Dans ce cas, on utilise ce qui suit :
Pour la forme cutanée - cotrimoxazole 4 comprimés par jour ;
Pour la forme bubonique - chloramphénicol à la dose de 80 mg/kg/jour et en même temps streptomycine à la dose de 50 mg/kg/jour ; les médicaments sont administrés par voie intraveineuse; La tétracycline est également efficace ;
Dans les formes pulmonaires et septiques de la maladie, l'association du chloramphénicol avec la streptomycine est complétée par l'administration de doxycycline à la dose de 0,3 g/jour ou de tétracycline à la dose de 4 à 6 g/jour par voie orale.
Parallèlement, une thérapie de désintoxication massive est effectuée (plasma frais congelé, albumine, rhéopolyglucine, hémodez, solutions cristalloïdes intraveineuses, méthodes de désintoxication extracorporelles), des médicaments sont prescrits pour améliorer la microcirculation et la réparation (trental en association avec solcoseryl, picamilon), forçant diurèse, ainsi que des glycosides cardiaques, des analeptiques vasculaires et respiratoires, des agents antipyrétiques et symptomatiques.
Le succès du traitement dépend de la rapidité du traitement. Les médicaments étiotropes sont prescrits dès la première suspicion de peste, sur la base de données cliniques et épidémiologiques.
Prévention de la peste
Surveillance épidémiologique
Le volume, la nature et l'orientation des mesures préventives sont déterminés par la prévision de la situation épizootique et épidémique de peste dans des foyers naturels spécifiques, en tenant compte des données de suivi de l'évolution de la morbidité dans tous les pays du monde. Tous les pays sont tenus de signaler à l'OMS l'émergence de la peste, l'évolution de la morbidité, les épizooties chez les rongeurs et les mesures de lutte contre l'infection. Le pays a développé et exploite un système de certification des foyers naturels de peste, qui a permis de réaliser un zonage épidémiologique du territoire.
Actions préventives
Les indications pour l'immunisation préventive de la population sont une épizootie de peste chez les rongeurs, l'identification d'animaux domestiques atteints de peste et la possibilité d'une infection apportée par une personne malade. En fonction de la situation épidémique, la vaccination est réalisée sur un territoire strictement défini à l'ensemble de la population (universellement) et sélectivement aux contingents particulièrement menacés - personnes ayant des liens permanents ou temporaires avec les territoires où l'épizootie est observée (éleveurs, agronomes, chasseurs, récolteurs, géologues, archéologues, etc.). En cas de détection d'un patient pesteux, tous les établissements médicaux et préventifs doivent disposer d'un certain approvisionnement en médicaments et moyens de protection individuelle et de prévention, ainsi que d'un système de notification du personnel et de transmission verticale des informations. Des mesures visant à empêcher les personnes d'être infectées par la peste dans les zones enzootiques, les personnes travaillant avec des agents pathogènes d'infections particulièrement dangereuses, ainsi que la prévention de la propagation de l'infection au-delà des foyers vers d'autres régions du pays, sont prises par les services anti-peste et autres soins de santé. établissements.
Activités pendant la flambée épidémique
Lorsqu'une personne malade de la peste ou suspectée de cette infection apparaît, des mesures urgentes sont prises pour localiser et éliminer l'épidémie. Les limites du territoire où sont introduites certaines mesures restrictives (quarantaine) sont déterminées en fonction de la situation épidémiologique et épizootologique spécifique, des facteurs opératoires possibles de transmission de l'infection, des conditions sanitaires et hygiéniques, de l'intensité de la migration de la population et des liaisons de transport avec d'autres territoires. La gestion générale de toutes les activités liées à l'épidémie de peste est assurée par la Commission anti-épidémique d'urgence. Dans le même temps, le régime anti-épidémique est strictement observé à l'aide de combinaisons anti-peste. La quarantaine est introduite par décision de la Commission anti-épidémique d'urgence, couvrant l'ensemble du territoire de l'épidémie.
Les malades de la peste et les malades suspectés d'être atteints de cette maladie sont hospitalisés dans des hôpitaux spécialement organisés. Le transport d'un malade pesteux doit être effectué conformément aux règles sanitaires en vigueur pour la sécurité biologique. Les patients atteints de peste bubonique sont placés en groupes de plusieurs personnes dans une pièce, tandis que les patients atteints de forme pulmonaire sont placés uniquement dans des pièces séparées. Les patients atteints de peste bubonique sortent au plus tôt 4 semaines, pour la peste pneumonique - au plus tôt 6 semaines à compter de la date de guérison clinique et des résultats négatifs de l'examen bactériologique. A sa sortie de l’hôpital, le patient est placé sous surveillance médicale pendant 3 mois.
La désinfection actuelle et finale est effectuée dans le foyer. Les personnes ayant été en contact avec des pestiférés, des cadavres, des objets contaminés, ayant participé à l'abattage forcé d'un animal malade, etc., sont soumises à l'isolement et à l'observation médicale (6 jours). Pour la peste pneumonique, un isolement individuel (pendant 6 jours) et une prophylaxie aux antibiotiques (streptomycine, rifampicine, etc.) sont effectués pour toutes les personnes susceptibles d'avoir été infectées.
maladie infectieuse aiguë causée par une bactérie Yersinia pestis et se manifeste sous deux formes principales : bubonique et pulmonaire. Dans la nature, la peste est courante chez les rongeurs, à partir desquels elle se transmet à l'homme par la piqûre de puces infectées. La forme prédominante de peste chez l'homme, la peste bubonique, se caractérise par une inflammation des ganglions lymphatiques (le plus souvent de l'aine) ; En apparence, les ganglions lymphatiques hypertrophiés ressemblent à des haricots, d'où vient le nom de la maladie : « Jumma » - arabe. "haricot".
Aspect historique.
Dans l’histoire de l’humanité, des épidémies dévastatrices de peste ont laissé dans la mémoire des gens l’idée de cette maladie comme d’un terrible désastre, dépassant en dégâts causés les conséquences destructrices des épidémies de paludisme ou de typhus qui ont « décimé » des armées entières pour les civilisations passées. L’un des faits les plus étonnants de l’histoire des épidémies de peste est leur reprise sur de vastes territoires après de longues périodes (des siècles) de relative prospérité. Les trois pires pandémies de peste sont séparées par des périodes de 800 et 500 ans.
Certains experts estiment que les premières références historiques à la peste se trouvent dans les cinquième et sixième chapitres du Premier Livre des Rois, qui décrivent une épidémie au cours de laquelle les Philistins furent frappés par des « excroissances ». Ces mêmes auteurs admettent que les « excroissances » désignent des bubons de la peste, et les « cinq excroissances dorées et cinq souris dorées » exigées des Philistins indiquent que déjà dans les temps anciens, ils avaient probablement deviné le lien entre la peste et les rongeurs. Il est généralement admis que le philosophe et médecin Sushruta, qui vivait en Inde au Ve siècle. AD connaissait également le lien entre les épidémies de peste et les rongeurs.
Rufus d'Éphèse (Ier siècle après JC) a décrit une vaste épidémie d'une maladie infectieuse, accompagnée du développement de bubons et d'une mortalité élevée, sur le territoire de l'Égypte, de la Libye et de la Syrie modernes. La première grande pandémie enregistrée dans les chroniques s'est produite sous le règne de Justinien, en 542. La deuxième grande pandémie, connue sous le nom de peste noire, a balayé le monde au 14ème siècle, avec une incidence maximale de 1347 à 1350. Elle a tué environ un quart de la population européenne et entraîné des changements dans les sphères spirituelles, sociales et économiques de la société. La grande épidémie de peste qui a frappé l’Angleterre en 1665 s’est limitée principalement à Londres. Une grave épidémie de peste s'est produite à Marseille en 1720. À la suite de ces épidémies, des épidémies locales ont été constatées dans un certain nombre de villes portuaires du monde ; la peste, cependant, ne s’est pas répandue profondément dans les continents. La troisième grande pandémie a débuté au XIXe siècle. en Chine et atteint Hong Kong en 1894. Sur les navires, accompagné de rats infectés, la peste s'est rapidement propagée de ce grand port à l'Inde, au Proche et Moyen-Orient, au Brésil, à la Californie et à d'autres régions du monde. Sur une période de 20 ans, environ 10 millions de personnes sont mortes à cause de la pandémie.
Épidémiologie.
Les principaux porteurs d'agents pathogènes de la peste sont les rongeurs, principalement les rats, les écureuils terrestres, les coyotes, les écureuils terrestres, les gerboises - environ 300 espèces au total. La peste est toujours transmise aux humains à partir d'un réservoir naturel : des animaux infectés. Dans les villes, les bactéries de la peste persistent parmi les rats et les souris ; Ce sont les rats qui constituent la principale source d’infection humaine. Dans les zones rurales, les principaux vecteurs d'infection sont les rongeurs des champs ou des forêts qui vivent dans la zone. Dans certaines régions de Sibérie, de Mandchourie, d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud et des États-Unis, l'incidence de la peste est endémique : les cas d'infection sont limités à certaines zones de répartition des animaux. Aux États-Unis, les maladies ont été signalées principalement dans le sud-ouest du pays : Californie, Nevada, Colorado, Arizona et Nouveau-Mexique.
On pense que des cas de peste surviennent dans presque tous les pays, avec des taux d'incidence relativement élevés signalés en Inde, en Birmanie, au Vietnam, au Brésil, au Pérou, en Tanzanie, à Madagascar et aux Philippines. La susceptibilité à la peste ne varie pas selon la race, l'âge ou le sexe. La peste bubonique est plus fréquente dans les zones où les températures moyennes sont inférieures à 27°C ; à 29°C, les épidémies commencent à décliner. La forme pneumonique de la peste s’observe principalement pendant les saisons fraîches de l’année et survient principalement dans les pays au climat tempéré et humide. Cependant, en 1994, une épidémie de peste pneumonique s'est produite à Surat (Inde), située dans la partie tropicale du pays.
La période d'incubation dure de 2 à 10 jours. La peste bubonique se caractérise par une apparition soudaine sous la forme de frissons intenses, d'une fièvre rapide, de maux de tête intenses, d'étourdissements, de soif et de vomissements. L'inflammation se développe dans les ganglions lymphatiques régionaux les plus proches du site de la piqûre de puce ; ils augmentent de volume, forment des bubons et deviennent très douloureux. Le plus souvent, les ganglions lymphatiques de l'aine sont touchés, mais parfois aussi les ganglions lymphatiques axillaires, cervicaux et autres. À la suite d'une intoxication grave, les patients développent rapidement un état de prostration complète (stupéfaction et léthargie), de confusion et de coma. Certains patients, au contraire, éprouvent de l'agitation, des délires, des hallucinations et un désir d'évasion. La peste est une maladie de courte durée : la mort ou un tournant dans la maladie survient en quelques jours. Dans la forme septique de la peste, le tableau clinique du choc infectieux-toxique se développe si rapidement que les patients meurent d'insuffisance cardiovasculaire et de syndrome hémorragique avant même le développement des bubons. La peste bubonique peut être compliquée par une pneumonie, qui à un moment donné entraînait presque toujours la mort. Lors des grandes épidémies de peste bubonique, le taux de mortalité atteint 90 %.
La forme pneumonique de la peste se caractérise par le fait que dans les 24 heures suivant son apparition soudaine, de graves frissons et une augmentation rapide de la température provoquent des douleurs thoraciques et des crachats sanglants et mousseux. L'évolution de cette forme de la maladie est très rapide : avant l'ère des antibiotiques, les patients mouraient en 2 à 4 jours. Actuellement, si la maladie peut être reconnue précocement et si les antibiotiques sont instaurés dans les premières 24 heures, la guérison se produit dans de nombreux cas.
Traitement et prévention.
Avec le début de l'utilisation d'antibiotiques, le pronostic de la maladie est devenu plus favorable, même s'il n'existe pas de traitements absolument fiables. Il est très important de commencer le traitement le plus tôt possible. La streptomycine est la plus efficace contre toutes les formes de peste et entraîne moins d’effets secondaires que les autres antibiotiques. Il est recommandé à ceux qui voyagent dans des « zones de peste » de prendre quotidiennement de la tétracycline prophylactique pendant la période d’infection possible.
La peste fait partie du groupe des infections particulièrement dangereuses. Il est donc primordial de prendre des mesures pour empêcher sa propagation. Dans les zones endémiques, une extermination des rats doit être réalisée. Les cas suspects de peste doivent être signalés immédiatement aux autorités sanitaires locales. Les patients atteints de peste pneumonique doivent être immédiatement isolés des autres, car cette forme d'infection est la plus contagieuse. Il est recommandé que toutes les personnes en contact avec le patient soient soumises à un examen de quarantaine.
La peste bubonique est une forme de peste. La peste est une maladie infectieuse causée par la bactérie Yersinia Pestis. Cette bactérie vit sur les petits animaux et sur les puces qui y vivent. L'infection se produit par une voie transmissible, c'est-à-dire par une piqûre de puce, ainsi que par contact direct et gouttelettes en suspension dans l'air. Nous comprendrons comment se produit l'infection par la peste bubonique, comment se déroulent la période d'incubation et les symptômes de l'infection pesteuse, le traitement aux antibiotiques et la prévention de cette maladie la plus dangereuse aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble l'agent causal de la peste, la bactérie Yersinia Pestis, au microscope et en microscopie à fluorescence. Commençons par le contexte des derniers cas de peste et leurs conséquences pour des milliers de personnes.
Important! La peste bubonique se caractérise par des ganglions lymphatiques douloureux et enflammés et constitue la forme la plus courante de la maladie.
Antécédents d'infections récentes par la peste bubonique
Au XVIe siècle, la peste bubonique se propage dans toute l’Europe et tue un tiers de la population. Les rats sont devenus ses porteurs. Jusqu'au 19ème siècle, ils ne savaient pas comment traiter la maladie, le taux de mortalité était donc de près de 100 % - certains se sont miraculeusement rétablis d'eux-mêmes.

Et à ce jour, des cas d'infection par la peste bubonique ont été enregistrés, la plupart des cas d'infection sont observés en Asie centrale, ainsi que dans le nord de la Chine.
L'agent causal, la bactérie Yersinia Pestis, n'a été découvert qu'en 1894. Ainsi, en même temps, les scientifiques ont pu étudier l'évolution de la maladie et développer un vaccin. Mais avant cette époque, des millions de personnes sont mortes. La plus célèbre épidémie de peste bubonique a touché l’Europe entre 1346 et 1353. Vraisemblablement, il est originaire d'un centre naturel du Gobi, puis s'est répandu sur le territoire de l'Inde, de la Chine et de l'Europe avec les caravanes.
En vidéo le film L'Âge des Ténèbres du Moyen Âge : Peste noire
En 20 ans, la peste bubonique a tué au moins 60 millions de personnes. Au Moyen Âge, il n'y avait pas de salut contre une telle maladie - ils essayaient de la traiter par des saignées de sang, ce qui compliquait encore davantage l'état des patients, car ils perdaient leurs dernières forces.
Des épidémies répétées de peste bubonique ont eu lieu en 1361 et 1369. La maladie a touché tous les domaines de la vie des gens. L’histoire montre qu’après la peste bubonique, la situation démographique n’est devenue stable que 400 ans après la fin de la maladie.
Il existe plusieurs formes de la maladie, selon lesquelles elle acquiert une évolution spécifique.
Important! Les formes dans lesquelles les poumons sont touchés sont très contagieuses, car elles entraînent une propagation rapide de l'infection par les gouttelettes en suspension dans l'air. Avec la peste bubonique, les patients ne sont pratiquement pas contagieux.
L'agent causal de la peste bubonique est la bactérie Yersinia Pestis
Spoiler avec exemple de photo de choc léger, manifestations de peste bubonique sur la jambe droite.
 Manifestation de peste bubonique sur la jambe droite.
Manifestation de peste bubonique sur la jambe droite.
[effondrement]
Une fois dans l’organisme, l’infection commence à se développer rapidement et une résistance aux médicaments utilisés pour traiter la peste bubonique, la bactérie Yersinia Pestis, peut survenir.
La durée de vie de la bactérie dans les crachats est d'environ 10 jours. Elle peut persister encore plus longtemps (plusieurs semaines) sur les vêtements, dans les sécrétions de peste et dans les cadavres des personnes décédées de la maladie - jusqu'à plusieurs mois. Les processus de congélation et les basses températures ne détruisent pas l'agent pathogène de la peste.
Important! La lumière du soleil et les températures élevées sont dangereuses pour la bactérie de la peste bubonique. En une heure, la bactérie de la peste Yersinia Pestis meurt ; à une température de 60 degrés, lorsqu'elle atteint 100, elle ne survit que quelques minutes.
La période d'incubation après l'infection par la peste bubonique est assez courte - 1 à 3 jours, alors que chez certaines personnes, elle ne peut durer que quelques heures en raison d'un système immunitaire affaibli. La cible de l'agent pathogène est le système lymphatique humain. Après avoir pénétré le flux lymphatique, l'infection se propage instantanément dans tout le corps. Dans le même temps, les ganglions lymphatiques cessent de fonctionner et des bactéries pathogènes commencent à s'y accumuler.
Il existe des formes cutanées et buboniques de peste. Sous forme cutanée, une papule rapidement ulcéreuse apparaît au site de la morsure. Après cela, une croûte et une cicatrice apparaissent. Ensuite, des signes plus graves de la maladie commencent généralement à apparaître.
La forme bubonique commence par une augmentation des ganglions lymphatiques les plus proches du site de la morsure.
Wikipédia indique que les ganglions lymphatiques de n'importe quelle zone peuvent être affectés. Dans ce cas, les ganglions lymphatiques de l'aine sont le plus souvent touchés, moins souvent les ganglions axillaires.


Symptômes de l'infection par la peste bubonique
Les symptômes au stade initial de l'infection par la bactérie de la peste Yersinia Pestis ne sont pas spécifiques et ressemblent dans leurs manifestations à un rhume. Le patient subit les changements suivants :
- Un gros gonflement rouge apparaît au site de la morsure, ressemblant à une réaction allergique en apparence ;
- la tache résultante se transforme progressivement en une papule remplie de sang et de contenu purulent ;
- l'ouverture de la papule entraîne l'apparition d'un ulcère à ce site, qui ne guérit pas longtemps.
Parallèlement, la peste bubonique présente également d’autres symptômes, tels que :
- augmentation de la température;
- signes caractéristiques d'intoxication : nausées, vomissements, diarrhée, etc. ;
- une augmentation de la taille des ganglions lymphatiques (au début quelques-uns, puis la maladie affecte le reste) ;
- maux de tête semblables à la méningite.
Après quelques jours, les ganglions lymphatiques grossissent considérablement, cessent de fonctionner, perdent leur mobilité et une douleur apparaît lorsque vous les touchez.
Spoiler avec une photo choc de la peste bubonique, 10 jours après l'infection.

[effondrement]
Après 4 à 5 jours supplémentaires, les ganglions lymphatiques deviennent mous et remplis de liquide. Au toucher, vous pouvez ressentir ses vibrations. Au 10ème jour, les ganglions s'ouvrent et des fistules non cicatrisantes se forment.
Sur la photo de droite, toutes ces manifestations sont visibles, cliquez sur la photo pour l'agrandir.
La peste bubonique survient souvent en association avec une méningite. Le patient ressent de graves maux de tête et des crampes dans tout le corps.
La forme bubonique ne s'accompagne pas du développement d'une réaction locale à la piqûre, contrairement à la peste bubonique cutanée. Dans le second cas, le microbe pénètre dans la peau puis pénètre dans les ganglions lymphatiques par le flux lymphatique.
Forme septique primaire et forme septique secondaire
La pénétration de l'agent pathogène dans le sang s'accompagne de l'apparition de formes généralisées de la maladie. Il existe des formes septiques primaires et des formes septiques secondaires.
Forme septique primaire de la peste bubonique se développe dans les cas où l'infection pénètre dans le sang sans affecter les ganglions lymphatiques. Les signes d'intoxication sont observés presque immédiatement. Étant donné que l'infection se propage instantanément dans tout le corps, de nombreux foyers d'inflammation apparaissent dans tout le corps. Un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée se développe, accompagné de lésions de tous les organes. Un patient atteint de peste bubonique décède des suites d'un choc infectieux-toxique.

Forme septique secondaire de la peste accompagné du développement d'une septicémie infectieuse.
Complications. La peste bubonique peut être compliquée par une pneumonie. Dans de tels cas, cela devient une forme pulmonaire.
Forme pulmonaire de la peste bubonique se manifeste par de la fièvre, des maux de tête sévères, une pneumonie, des douleurs thoraciques, de la toux et une expectoration de sang. L'infection se produit par des gouttelettes en suspension dans l'air, mais peut se développer comme une forme secondaire bubonique ou septique. La maladie se propage rapidement dans tout le corps, mais les médicaments antibactériens modernes peuvent y faire face avec succès. Malheureusement, même un traitement intensif ne peut garantir l’élimination de la mort.
Avec forme septique de peste les signes de la maladie comprennent de la fièvre, des frissons, des douleurs abdominales et des hémorragies internes. Une nécrose massive des tissus est observée, le plus souvent les tissus des doigts des extrémités meurent. Les bubons ne se forment pas sous cette forme, mais des troubles du système nerveux surviennent presque immédiatement. Si elle n'est pas traitée, la mort est presque garantie, mais avec un traitement adéquat, la probabilité de guérison est également élevée.
Traitement de la peste bubonique
Spoiler avec une photo choc du processus de nécrosation de la main lors de la peste bubonique.

[effondrement]
Au Moyen Âge, les médecins ne pouvaient proposer aucune méthode de traitement efficace contre la peste bubonique. Premièrement, cela était dû au fait que la médecine n'était pratiquement pas développée, car la religion occupait la place principale et la science n'était pas soutenue. Deuxièmement, la plupart des médecins avaient simplement peur de contacter les personnes infectées pour ne pas mourir eux-mêmes.
Néanmoins, des tentatives ont été faites pour traiter la peste, sans toutefois donner de résultats. Par exemple, les bubons ont été ouverts et cautérisés. La peste étant considérée comme un empoisonnement du corps tout entier, des tentatives ont été faites pour utiliser des antidotes. Des grenouilles et des lézards ont été appliqués sur les zones touchées. Bien entendu, de telles méthodes ne pouvaient pas aider.
Les villes furent asservies par la panique. Les mesures administratives prises à Venise sont un exemple intéressant de la manière dont la maladie a été contenue. Une commission sanitaire spéciale y fut organisée. Tous les navires arrivés étaient soumis à une inspection spéciale et, si des cadavres ou des infectés étaient découverts, ils étaient brûlés. Les marchandises et les voyageurs ont été mis en quarantaine pendant 40 jours. Les cadavres ont été immédiatement collectés et enterrés dans une lagune séparée à une profondeur d'au moins 1,5 mètre.
La peste existe encore aujourd'hui
Ne pensez pas que cette maladie reste seulement dans les livres d’histoire. La peste bubonique a été enregistrée dans l'Altaï l'année dernière (2016), et en général, environ 3 000 cas d'infection sont enregistrés par an. Il n'y a pas eu d'épidémie dans le territoire de l'Altaï, mais toutes les mesures ont été prises pour empêcher la propagation de l'infection et les personnes ayant été en contact avec la personne infectée ont été mises en quarantaine.
La méthode principale et moderne de traitement de la peste bubonique à notre époque est l’utilisation d’antibiotiques. Les médicaments sont administrés par voie intramusculaire, ainsi que dans les bubons eux-mêmes. En règle générale, la tétracycline et la streptomycine sont utilisées pour le traitement.
Important! Les patients atteints de peste bubonique infectés par la bactérie Yersinia Pestis sont soumis à une hospitalisation obligatoire et sont placés dans des services spéciaux. Tous les objets et vêtements personnels sont soumis à désinfection. Le contact avec un patient infecté par la peste nécessite le respect des mesures de sécurité par le personnel médical - le port de combinaisons de protection est obligatoire.
Le traitement symptomatique des manifestations de la peste et des bubons sur le corps humain est obligatoire, dont le but est de soulager l'état du patient et d'éliminer les complications.
Pour confirmer la récupération, une culture bactérienne est réalisée sur la bactérie Yersinia Pestis et l'analyse est répétée 3 fois. Et même après cela, le patient reste à l'hôpital pendant encore un mois. Après sa sortie, il doit être suivi par un infectiologue pendant 3 mois.
En vidéo : 10 faits intéressants sur la peste, de Dameoz
Dans la vidéo, le programme Live Healthy parlera de la peste bubonique, de l'infection par la bactérie de la peste Yersinia Pestis et du traitement :
Qu'est-ce que la peste et pourquoi est-elle appelée la peste noire ?
La peste est une maladie infectieuse grave qui entraîne des épidémies à grande échelle et aboutit souvent à la mort de la personne malade. Elle est causée par Iersinia pestis, une bactérie découverte à la fin du XIXe siècle par le scientifique français A. Yersin et le chercheur japonais S. Kitazato. À l'heure actuelle, les agents responsables de la peste ont été assez bien étudiés. Dans les pays développés, les épidémies de peste sont extrêmement rares, mais cela n’a pas toujours été le cas. La première épidémie de peste décrite dans les sources s'est produite au VIe siècle sur le territoire de l'Empire romain. Ensuite, la maladie a coûté la vie à environ 100 millions de personnes. Huit siècles plus tard, l’histoire de la peste s’est répétée en Europe occidentale et en Méditerranée, où plus de 60 millions de personnes sont mortes. La troisième épidémie à grande échelle a débuté à Hong Kong à la fin du XIXe siècle et s'est rapidement propagée à plus de 100 villes portuaires de la région asiatique. Rien qu’en Inde, la peste a entraîné la mort de 12 millions de personnes. En raison de ses conséquences graves et de ses symptômes caractéristiques, la peste est souvent appelée « peste noire ». Elle n’épargne en réalité ni les adultes ni les enfants et, en l’absence de traitement, « tue » plus de 70 % des personnes infectées.
De nos jours, la peste est rare. Cependant, il existe encore dans le monde des foyers naturels où des agents infectieux sont régulièrement détectés chez les rongeurs qui y vivent. Ces derniers sont d'ailleurs les principaux porteurs de la maladie. Les bactéries mortelles de la peste pénètrent dans le corps humain par les puces, qui recherchent de nouveaux hôtes après la mort massive de rats et de souris infectés. De plus, la voie aérienne de transmission de l'infection est connue, ce qui détermine en fait la propagation rapide de la peste et le développement d'épidémies.
Dans notre pays, les régions où la peste est endémique comprennent la région de Stavropol, la Transbaïkalie, l'Altaï, la plaine caspienne et la région orientale de l'Oural.
Étiologie et pathogenèse
Les agents pathogènes de la peste résistent aux basses températures. Ils sont bien conservés dans les crachats et se transmettent facilement d'une personne à l'autre par des gouttelettes en suspension dans l'air. Lorsqu'une puce pique, une petite papule remplie de contenu hémorragique (peste cutanée) apparaît d'abord sur la zone de peau affectée. Après cela, le processus se propage rapidement dans les vaisseaux lymphatiques. Ils créent des conditions idéales pour la prolifération des bactéries, ce qui conduit à la croissance explosive des agents pathogènes de la peste, à leur fusion et à la formation de conglomérats (peste bubonique). Les bactéries peuvent pénétrer dans le système respiratoire avec le développement ultérieur de la forme pulmonaire. Cette dernière est extrêmement dangereuse, car elle se caractérise par un courant très rapide et couvre de vastes territoires en raison d'une propagation intensive entre les membres de la population. Si le traitement de la peste commence trop tard, la maladie se transforme en une forme septique, qui affecte absolument tous les organes et systèmes du corps et se termine dans la plupart des cas par la mort d'une personne.
Peste - symptômes de la maladie
Les symptômes de la peste apparaissent au bout de 2 à 5 jours. La maladie débute de manière aiguë par des frissons, une forte augmentation de la température corporelle jusqu'à des niveaux critiques et une baisse de la tension artérielle. À ces signes s’ajoutent ensuite des symptômes neurologiques : délire, perte de coordination et confusion. D'autres manifestations caractéristiques de la peste noire dépendent de la forme spécifique d'infection.
- peste bubonique - hypertrophie des ganglions lymphatiques, du foie, de la rate. Les ganglions lymphatiques deviennent durs et extrêmement douloureux, remplis de pus qui finit par éclater. Un diagnostic incorrect ou un traitement inadéquat de la peste entraîne la mort du patient 3 à 5 jours après l'infection ;
- peste pneumonique - affecte les poumons, les patients se plaignent de toux et d'écoulements abondants d'expectorations contenant des caillots sanguins. Si le traitement n'est pas commencé dans les premières heures suivant l'infection, toutes les autres mesures seront alors inefficaces et le patient mourra dans les 48 heures ;
- peste septique - les symptômes indiquent la propagation d'agents pathogènes dans littéralement tous les organes et systèmes. Une personne meurt en une journée au maximum.
Les médecins connaissent également la forme dite mineure de la maladie. Elle se manifeste par une légère augmentation de la température corporelle, un gonflement des ganglions lymphatiques et des maux de tête, mais ces symptômes disparaissent généralement d'eux-mêmes au bout de quelques jours.
Traitement de la peste
 Le diagnostic de la peste repose sur la culture en laboratoire, les méthodes immunologiques et la réaction en chaîne par polymérase. Si un patient est diagnostiqué avec la peste bubonique ou toute autre forme de cette infection, il est immédiatement hospitalisé. Lors du traitement de la peste chez de tels patients, le personnel des établissements médicaux doit prendre des précautions strictes. Les médecins doivent porter des bandages de gaze à 3 couches, des lunettes de protection pour empêcher les crachats de pénétrer sur le visage, des couvre-chaussures et un bonnet qui recouvre complètement les cheveux. Si possible, des combinaisons spéciales anti-peste sont utilisées. Le compartiment dans lequel se trouve le patient est isolé des autres locaux de l'établissement.
Le diagnostic de la peste repose sur la culture en laboratoire, les méthodes immunologiques et la réaction en chaîne par polymérase. Si un patient est diagnostiqué avec la peste bubonique ou toute autre forme de cette infection, il est immédiatement hospitalisé. Lors du traitement de la peste chez de tels patients, le personnel des établissements médicaux doit prendre des précautions strictes. Les médecins doivent porter des bandages de gaze à 3 couches, des lunettes de protection pour empêcher les crachats de pénétrer sur le visage, des couvre-chaussures et un bonnet qui recouvre complètement les cheveux. Si possible, des combinaisons spéciales anti-peste sont utilisées. Le compartiment dans lequel se trouve le patient est isolé des autres locaux de l'établissement.
Si une personne reçoit un diagnostic de peste bubonique, on lui administre de la streptomycine par voie intramusculaire 3 à 4 fois par jour et des antibiotiques tétracyclines par voie intraveineuse. En cas d'intoxication, il est conseillé aux patients d'utiliser des solutions salines et de l'hémodez. Une diminution de la pression artérielle est considérée comme un motif de traitement d'urgence et de mesures de réanimation en cas d'augmentation de l'intensité du processus. Les formes pneumoniques et septiques de peste nécessitent des doses croissantes d'antibiotiques, un soulagement immédiat du syndrome de coagulation intravasculaire et l'administration de plasma sanguin frais.
Grâce au développement de la médecine moderne, les épidémies de peste à grande échelle sont devenues très rares et actuellement le taux de mortalité des patients ne dépasse pas 5 à 10 %. Cela est vrai dans les cas où le traitement de la peste commence à temps et est conforme aux règles et réglementations établies. Pour cette raison, en cas de suspicion de présence d'agents pathogènes de la peste dans l'organisme, les médecins sont tenus d'hospitaliser d'urgence le patient et d'alerter les autorités chargées de contrôler la propagation des maladies infectieuses.
Vidéo de YouTube sur le sujet de l'article :
La peste a de profondes racines historiques. L’humanité a été confrontée pour la première fois à la maladie au 14e siècle. L’épidémie, surnommée « la peste noire », a coûté la vie à plus de 50 millions de personnes, soit l’équivalent d’un quart de la population de l’Europe médiévale. Le taux de mortalité était d'environ 99 %.
Faits sur la maladie :
- La peste affecte les ganglions lymphatiques, les poumons et d'autres organes internes. À la suite d'une infection, une septicémie se développe. L'état général du corps est extrêmement difficile. Le corps est soumis à des accès de fièvre constants.
- La période de développement de la peste après l'infection est en moyenne d'environ trois jours, selon l'état général du corps.
- À l'heure actuelle, le taux de mortalité dû à cette maladie ne dépasse pas 10 % de tous les cas identifiés.
- Il y a environ 2 000 cas de maladie par an. Selon l'OMS, en 2013, 783 cas d'infection ont été officiellement enregistrés, dont 126 cas ont entraîné la mort.
- Les épidémies de la maladie touchent principalement les pays africains et un certain nombre de pays d’Amérique du Sud. Les pays endémiques sont la République démocratique du Congo, l'île de Madagascar et le Pérou.
En Fédération de Russie, le dernier cas connu de peste remonte à 1979. Chaque année, plus de 20 000 personnes sont à risque, se trouvant dans la zone de foyers naturels d'infection d'une superficie totale de plus de 250 000 km2.
CAUSES
La principale cause de la peste est piqûres de puces. Ce facteur est dû à la structure spécifique du système digestif de ces insectes. Après qu'une puce a piqué un rongeur infecté, la bactérie de la peste s'installe dans son jabot et bloque le passage du sang vers l'estomac. En conséquence, l'insecte éprouve une sensation constante de faim et, avant sa mort, parvient à mordre, infectant ainsi jusqu'à 10 hôtes, régurgitant dans la piqûre le sang qu'il boit ainsi que les bactéries de la peste.
Après une morsure, la bactérie pénètre dans le ganglion lymphatique le plus proche, où elle se multiplie activement et, sans traitement antibactérien, affecte tout le corps.
Causes d'infection :
- morsures de petits rongeurs;
- contact avec des animaux domestiques infectés, des chiens errants ;
- contact direct avec une personne infectée ;
- le découpage des carcasses d'animaux atteints par la maladie ;
- traitement de la peau des animaux tués porteurs de la maladie ;
- contact de bactéries avec la muqueuse humaine lors de l'autopsie des cadavres de ceux qui sont morts de la peste ;
- manger de la viande provenant d'animaux infectés;
- entrée de particules de salive d'une personne infectée dans la cavité buccale d'une personne en bonne santé par des gouttelettes en suspension dans l'air ;
- conflits militaires et attaques terroristes utilisant des armes bactériologiques.
La bactérie de la peste est très résistante aux basses températures, se multiplie vigoureusement dans un environnement humide, mais ne tolère pas les températures élevées (supérieures à 60 degrés) et meurt presque instantanément dans l'eau bouillante.

CLASSIFICATION
Les variétés de peste sont divisées en deux types principaux.
- Type localisé- la maladie se développe après que les microbes de la peste pénètrent sous la peau :
- Peste cutanée. Il n'y a pas de réaction protectrice primaire, seulement dans 3% des cas, une rougeur des zones affectées de la peau avec induration apparaît. Sans signes extérieurs visibles, la maladie progresse, formant finalement un anthrax, puis un ulcère, qui cicatrise en guérissant.
- Peste bubonique. La forme la plus courante de la maladie. Elle affecte les ganglions lymphatiques, formant des « bubons ». Caractérisé par des processus inflammatoires douloureux. Affecte la région de l'aine et les aisselles. Accompagné d'une fièvre sévère et d'une intoxication générale du corps.
- Peste cutanée bubonique. Les bactéries de la peste voyagent avec la lymphe et se retrouvent dans les ganglions lymphatiques, provoquant un processus inflammatoire qui affecte les tissus voisins. Les « bubons » mûrissent et le taux de développement de la pathologie diminue.
- Type généralisé- l'agent pathogène pénètre dans l'organisme par des gouttelettes en suspension dans l'air, ainsi que par les membranes des muqueuses de l'organisme :
- Peste septicémique. L'agent pathogène pénètre à travers les muqueuses. La forte virulence du microbe et un organisme affaibli sont les raisons de son entrée facile dans le sang du patient, contournant tous ses mécanismes de défense. Une issue fatale avec cette forme de la maladie peut survenir en moins de 24 heures, ce qu'on appelle. "Peste de la foudre"
- Peste pneumonique. L'entrée dans le corps se fait par des gouttelettes en suspension dans l'air, par l'infection par des mains et des objets sales, ainsi que par la conjonctive des yeux. Cette forme est une pneumonie primaire et présente également un seuil épidémique élevé en raison de la sécrétion abondante d'expectorations contenant des bactéries pathogènes lors de la toux.
SYMPTÔMES
La période d'incubation de la peste varie de 72 à 150 heures. Le plus souvent, il apparaît le troisième jour. La maladie se caractérise manifestation soudaine sans symptômes primaires.
Antécédents cliniques de peste :
- une forte augmentation de la température corporelle jusqu'à 40 degrés;
- maux de tête aigus;
- nausée;
- teinte rougeâtre sur le visage et les globes oculaires ;
- inconfort musculaire;
- enduit blanc sur la langue;
- narines élargies;
- peau sèche des lèvres;
- manifestations d'une éruption cutanée sur le corps;
- sensation de soif;
- insomnie;
- excitation sans cause;
- difficultés à coordonner les mouvements;
- délires (souvent de nature érotique) ;
- digestion altérée;
- difficulté à uriner;
- forte fièvre;
- toux avec crachats contenant des caillots sanguins ;
- saignement du tractus gastro-intestinal;
- tachycardie;
- Pression artérielle faible.
Les symptômes primaires cachés conduisent à des épidémies de maladies. Ainsi, un porteur potentiel de la peste peut parcourir de longues distances en se sentant en parfaite santé, tout en infectant toute personne entrant en contact avec la bactérie de la peste.

DIAGNOSTIQUE
De retour d'un voyage dans des zones où la propagation de la peste est endémique, avec les moindres signes de la maladie - raison urgente d’isoler le patient. Sur la base des antécédents médicaux, toutes les personnes ayant eu des contacts avec la personne potentiellement concernée sont identifiées.
Le diagnostic s'effectue des manières suivantes :
- culture bactérienne à partir d'échantillons de sang, d'expectorations et de tissus ganglionnaires ;
- diagnostics immunologiques;
- réaction en chaîne par polymérase ;
- passage sur animaux de laboratoire ;
- technique sérologique;
- isolement de la culture pure suivi d'une identification ;
- diagnostics de laboratoire basés sur un antisérum fluorescent.
Dans les conditions médicales modernes, la transmission directe du patient au médecin traitant et au personnel hospitalier est pratiquement impossible. Cependant, tout les tests en laboratoire sont effectués dans des locaux spécialisés pour travailler avec des maladies infectieuses particulièrement dangereuses.
TRAITEMENT
Depuis 1947, la peste traitable avec des antibiotiques groupe d'aminoglycosides à large spectre d'action.
Le traitement hospitalier est utilisé dans les services isolés des services de maladies infectieuses dans le respect de toutes les règles de sécurité lors du travail avec des patients atteints de peste.
Déroulement de la thérapie :
- L'utilisation de médicaments antibactériens à base de sulfaméthoxazole et de triméthoprime.
- Administration intraveineuse de chloramphénicol simultanément avec la streptomycine.
- Procédures de désintoxication.
- Améliorer la microcirculation et la réparation. Obtenu en entrant .
- Prendre des glycosides cardiaques.
- Utilisation d'analeptiques respiratoires.
- Utilisation d'antipyrétiques.
Le traitement est le plus efficace et n'entraîne aucune conséquence dans les premiers stades de la peste.

COMPLICATIONS
Parce que la maladie est incluse dans le groupe des maladies mortelles, les principales complications en cas de diagnostic erroné ou d'absence de traitement approprié peuvent être la transformation de la peste d'une forme bénigne en une forme plus grave. Ainsi, la peste cutanée peut évoluer en peste septicémique et la peste bubonique en peste pneumonique.
Les complications de la peste affectent également :
- Système cardiovasculaire (une péricardite se développe).
- Système nerveux central (méningoencéphalite purulente).
Bien qu'un patient guéri de la peste bénéficie de l'immunité, il n'est pas complètement à l'abri de nouveaux cas d'infection, surtout si des mesures préventives sont prises avec négligence.
LA PRÉVENTION
Au niveau des États, toute une série de mesures préventives directives contre la peste ont été élaborées.
Les décrets et règles suivants sont en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie :
- « Directives pédagogiques et méthodologiques pour le diagnostic, le traitement et la prévention de la peste », approuvées par le ministère de la Santé de l'URSS le 14 septembre 1976.
- Règles sanitaires et épidémiologiques SP 3.1.7.1380-03 du 06.06.2003, approuvées par la Résolution du Médecin Hygiéniste en chef de l'État dans la partie « Prévention de la peste ».
Ensemble de mesures :
- surveillance épidémiologique des foyers naturels de maladie ;
- la désinsectisation, réduisant le nombre de porteurs potentiels de maladies ;
- un ensemble de mesures de quarantaine ;
- former et préparer la population à répondre aux épidémies de peste ;
- manipulation soigneuse des cadavres d'animaux;
- vaccination du personnel médical ;
- utilisation de combinaisons anti-peste.
PRONOSTIC DE RÉCUPÉRATION
Le taux de mortalité dû à la peste, au stade actuel du traitement, est d'environ 10 %. Si le traitement est démarré plus tard ou s'il est totalement absent, les risques augmentent jusqu'à 30 à 40 %.
Avec le bon choix de méthodes de traitement le corps récupère en peu de temps, la fonctionnalité est entièrement restaurée.
Vous avez trouvé une erreur ? Sélectionnez-le et appuyez sur Ctrl + Entrée
Lire aussi...
- Pourquoi rêvez-vous du dos d'un homme ?
- La bonne aventure avec des cœurs en ligne : un moyen simple et gratuit de prédire l'amour d'un homme
- Interprétation des rêves : voler au-dessus du sol dans un rêve
- Description du zeste d'orange avec photo, sa teneur en calories ; comment faire à la maison ; utilisation du produit en cuisine; préjudice et propriétés bénéfiques