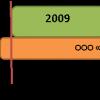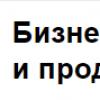Quels organismes sont impliqués dans la formation du pétrole. Comment le pétrole s’est formé. D'où vient le pétrole - une théorie alternative
Le pétrole est le carburant de base de la civilisation moderne. Les produits générés par le recyclage sont utilisés pour le chauffage, la propulsion des véhicules, les revêtements routiers, la production de polymères et divers autres processus, dont chacun fait partie intégrante de la vie humaine.
Le problème de l'épuisabilité des réserves pétrolières a donné lieu à de nombreuses discussions scientifiques sur son origine et les substances impliquées dans sa formation. La nécessité d’expliquer le processus de genèse du pétrole a divisé la communauté scientifique en deux camps irréconciliables :
- les partisans de la théorie biogénique ;
- adeptes de la voie abiogénique de l'éducation.
La théorie abiogénique est considérée comme plus optimiste pour l’humanité. Ses partisans soutiennent que l’hydrocarbure le plus répandu sur notre planète est formé par la synthèse géologique de ses deux composants inorganiques : l’hydrogène et le carbone. Leur connexion est initiée par la haute pression dans les couches souterraines et se produit sur des périodes mesurées en dizaines de milliers d'années.
Mais même si ce scénario se vérifie un jour, il ne rend pas le destin de la race humaine plus simple : le moment de l'invention qui a constitué la base de la roue et la création du premier ordinateur portable sont séparés par moins de 5 mille ans. . Et pour la formation d’importants gisements de pétrole, il ne faut pas moins de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’années.
L'un des éminents scientifiques qui ont partagé cette théorie est Mikhaïl Lomonossov. Avec nos contemporains, il pensait que les réserves pétrolières connues, relativement proches de la surface, ne représentaient qu’une partie microscopique des réserves planétaires.Les adeptes modernes croient que le pétrole formé dans la nature n'est pas seulement une ressource renouvelable, mais aussi une ressource presque inépuisable pour tout volume de consommation.
L'une des preuves de la possibilité de synthèse du pétrole dans la nature est la présence d'hydrocarbures dans l'atmosphère des planètes géantes gazeuses (en particulier Jupiter). Cette circonstance confirme la possibilité de formation des substances organiques les plus simples à partir de substances inorganiques naturelles.
Théorie abiogénique : comment se forme le pétrole ?
Les adeptes expliquent l'origine de « l'or noir » comme le résultat de processus de transformation de la biomasse - les restes de plantes et d'animaux anciens qui existaient sur la planète il y a des millions d'années. Il existe bien plus de preuves que le contraire.
L'une des premières preuves fut une expérience menée par des naturalistes allemands à la fin du XIXe siècle. Engler et Gefer ont pris des lipides d'origine animale (huile isolée du foie de morue) comme base matérielle pour l'expérience, et en les exposant à des températures élevées et à une pression plusieurs fois supérieure à la pression atmosphérique, ils en ont isolé des fractions organiques légères.
Il existe de nombreuses autres expériences et études en laboratoire qui soutiennent cette théorie de la formation de pétrole dans la nature. En outre, les études géologiques et la prévision de la présence de gisements de pétrole reposent exclusivement sur les dispositions de cette théorie.
Événements inexpliqués

Il existe un certain nombre de gisements, le fait même de leur existence réfute les principales dispositions de la théorie abiogénique de l'origine du pétrole dans la nature. Ceux-ci inclus:
- Tersko-Sunzhenskoe ;
- Romashkinskoe;
- Province pétrolière et gazière de Sibérie occidentale.
À différents moments, un « réapprovisionnement » inexplicable en pétrole a été observé dans ces zones. L'essence des événements étonnants était que les méthodes disponibles pour analyser les formations indiquaient qu'elles étaient épuisées, les puits montraient un arrêt presque complet de la production de pétrole, cependant, après quelques années, chacun montra à nouveau la présence de pétrole disponible pour la production. .
Les géologues prévoyaient une production dans le champ de Romashkinskoye d'un peu plus de 700 millions de tonnes d'or noir, mais pendant la seule période de production pétrolière soviétique, au moins 3 milliards de tonnes ont été extraites par une méthode simple.
Le gisement de Tersko-Sunzhenskoye était épuisé au début de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y avait eu aucune production pétrolière « jaillissante » depuis plus de 10 ans. Cependant, après la fin de la guerre, les puits explorés auraient reçu de nouvelles réserves : la production a non seulement repris, mais a commencé à dépasser de plusieurs ordres de grandeur les volumes d'avant-guerre.
Une situation similaire a été observée dans de nombreux domaines de l’URSS. Les partisans de la formation inorganique du pétrole dans la nature expliquent facilement ces cas, en soulignant que dans ces zones, les hydrocarbures sont d'origine inorganique. De plus, leur formation est fortement catalysée par la présence de graphites lourds dans les profondeurs de la terre et l'écoulement des eaux sédimentaires qui, sous l'influence d'une pression colossale, donnent lieu à la formation accélérée de pétrole.
Selon les scientifiques, une partie importante du territoire de la plaine de Sibérie occidentale était recouverte par les eaux de l'ancienne mer. L'origine naturelle du pétrole dans cette zone est critiquée et contestée, mais la formation minérale de méthane, qui n'est pas provoquée par des processus de décomposition de la matière organique, trouve de nombreux partisans. Grâce à un processus appelé hydratation, les sels de fer réagissent avec l’eau de mer, générant la libération de méthane. Il s'est accumulé dans des réservoirs naturels, y est resté même après l'assèchement de la mer et a atteint nos jours sous sa forme originale, formée naturellement dans la nature.
Conclusions et prévisions
Quelle que soit la voie de formation naturelle du pétrole qui reçoive des preuves irréfutables, elle n’aidera que peu la civilisation humaine. La mémoire humaine, les archives d’observations et la recherche scientifique couvrent à peine des périodes de centaines ou de milliers d’années, sans parler de millions.
Il est pour le moins déraisonnable de parler de l'apparition possible d'une crise énergétique : l'humanité développe rapidement des sources d'énergie alternatives, remplace les technologies obsolètes par de nouvelles et modernise les processus d'exploration et de production de ressources déjà connues. Aucune des prévisions modernes n'a de base plus stable que l'observation de la nature et la comparaison des faits, l'analyse des observations et des archives historiques. Couvrir dans une seule étude toutes sortes de cas qui sortent du cadre d'une des théories, les comparer et les ramener à un dénominateur commun est une idée plus ambitieuse que réaliste. La question est donc : « Comment le pétrole se forme-t-il dans la nature ? peut rester ouvert longtemps.
D’ici là, le pétrole, principal carburant de notre planète, restera l’objet de controverses scientifiques et la source de nombreux mystères.
Des chercheurs américains ont découvert des microalgues, à l’origine de toutes les réserves actuelles de pétrole et de charbon. Des experts américains sont convaincus que ce sont les microalgues qu'ils ont découvertes qui sont à l'origine de l'accumulation de ces ressources.
Un groupe d'experts dirigé par le professeur Joe Chapel de l'Université du Kentucky aux États-Unis a découvert un micro-organisme qui est devenu la base d'absolument toutes les réserves de charbon et de pétrole de la planète. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur la modification génétique d'un micro-organisme nouvellement découvert qui pourrait devenir une véritable source de carburant et résoudre tous les futurs problèmes énergétiques de l'humanité.
Auparavant, les scientifiques avaient découvert que le charbon et le pétrole se formaient à la suite de l'activité vitale de micro-organismes qui vivaient sur Terre il y a plus de 500 millions d'années. Et tout récemment, une équipe de chercheurs américains a découvert qu’un seul organisme était la cause la plus directe de l’émergence et de l’accumulation de ces importantes ressources naturelles. Les experts ont découvert qu’il s’agit d’une microalgue appelée Botryococcus braunii, qui possède des « empreintes » chimiques dans tous les types d’huile. Puisque le pétrole finit par se transformer en charbon au fil du temps, l’algue B. braunii est également une source de ce combustible solide.
"Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que cette algue étonnante existe encore aujourd'hui et pourrait bien devenir une cible de recherche majeure pour les grandes industries chimiques et pétrochimiques", explique Joe Chapel.
Malgré le « travail » colossal évident pour constituer les réserves actuelles de pétrole et de charbon, B. braunii, hélas, se développe assez lentement et, par conséquent, sous sa forme naturelle, il n'est pas très approprié comme source directe pour créer des réserves de biocarburants. Mais les experts peuvent utiliser les gènes de B. braunii pour créer des micro-organismes alternatifs capables d’effectuer une biosynthèse efficace et rapide des hydrocarbures.
Aujourd'hui, il existe déjà des exemples très réussis d'isolement des gènes nécessaires, caractérisés par une activité biochimique élevée, et de leur introduction forcée dans le génome de la levure. En conséquence, des sources vivantes de biocarburants, généralement sans prétention, émergent, qui peuvent à l'avenir devenir une alternative renouvelable à la méthode classique de production de pétrole.
Selon les scientifiques, l’utilisation des gènes de B. braunii présente d’énormes avantages, car ce micro-organisme possède un mécanisme moléculaire unique pour la production d’hydrocarbures. Et il faut dire qu'aucune bactérie connue n'est dotée de qualités similaires, ce qui, en général, est confirmé par les réserves colossales de charbon et de pétrole que B. braunii a commencé à créer il y a plusieurs millions d'années. Selon les experts, le transfert de gènes uniques de l'algue Botryococcus braunii dans un organisme à croissance rapide et peu exigeant permettra de créer des bioréacteurs peu coûteux et très efficaces produisant du carburant.
Prévisions
On estime que la croissance économique mondiale, ainsi qu'un hiver glacial dans l'hémisphère nord, augmenteront la demande de pétrole cette année, ce qui dépassera les attentes de nombreux experts et représentants du monde des affaires. C’est ce que rapporte l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Selon les prévisions de l'agence, la demande pétrolière devrait atteindre 89,1 millions de barils par jour, contre 87,7 millions de barils par jour l'an dernier.
L'AIE prévient que la hausse actuelle des prix du pétrole pourrait déclencher un ralentissement de la reprise économique mondiale. En outre, l’AIE estime que les producteurs de pétrole, les investisseurs et les consommateurs pourraient souffrir considérablement si le prix du pétrole reste autour de 100 dollars le baril.
Le pétrole ne manquera-t-il jamais ?
Il y a plusieurs décennies, les géologues pensaient que les réserves de gaz et de pétrole sur Terre auraient dû s'épuiser plus d'une fois. Les dernières données obligent les scientifiques à préciser que les réserves d'hydrocarbures de notre planète dureront, selon toute vraisemblance, encore un demi-siècle. Nous parlons bien entendu d’hydrocarbures d’origine organique.
Entre-temps, des expériences récentes menées à l'Institut de physique des hautes pressions de l'Académie des sciences de Russie à Troitsk ont démontré que notre Terre peut produire du pétrole et du gaz en continu. Il y a beaucoup de carbone dans le manteau supérieur, disent les experts russes, et il remonte souvent à la surface, par exemple sous forme de diamants à travers des cheminées de kimberlite.
Comme l'expliquent les scientifiques nationaux, dans les entrailles de la terre, il y a un transfert constant de masse et de chaleur. Cela signifie que les roches et diverses substances présentes dans le manteau de notre planète sont capables de reproduire de manière inépuisable des hydrocarbures, dont le pétrole.
Vous connaissez probablement la théorie de l’origine du charbon. Le point de vue sur cette question est bien établi : il s'est formé (et continue de se former) à partir des restes d'une végétation luxuriante à feuilles persistantes qui couvrait autrefois la planète entière, y compris même les zones de pergélisol actuelles, et apportés d'en haut par des roches ordinaires, sous l'influence de la pression souterraine et avec un manque d'oxygène.
Il est logique de supposer que l'huile a été fabriquée selon une recette similaire dans la même cuisine naturelle. Au XIXe siècle, le débat était largement centré sur la question de savoir quelle était la matière première utilisée pour la formation du pétrole : des restes végétaux ou animaux ?
En 1888, les scientifiques allemands G. Gefer et K. Engler ont mené des expériences sur la distillation de l'huile de poisson à une température de 400 C et une pression d'environ 1 MPa. Ils ont réussi à obtenir des hydrocarbures saturés, de la paraffine et des huiles lubrifiantes, notamment des alcènes, des naphtènes et des arènes.
Plus tard, en 1919, l'académicien N.D. Zelinsky a mené une expérience similaire, mais le matériau de départ était des boues organiques d'origine végétale - le sapropel - du lac Balshakh. Lors de son traitement, il était possible d'obtenir de l'essence, du kérosène, des huiles lourdes, ainsi que du méthane...
Ainsi, la théorie de l’origine organique du pétrole a été prouvée expérimentalement. Quelles autres difficultés pourrait-il y avoir ?...
Mais d'un autre côté, en 1866, le chimiste français M. Berthelot suggérait que le pétrole se formait dans les entrailles de la Terre à partir de substances minérales. Pour étayer sa théorie, il a mené plusieurs expériences en synthétisant artificiellement des hydrocarbures à partir de substances inorganiques.
Dix ans plus tard, le 15 octobre 1876, D.I. Mendeleïev fit un rapport détaillé lors d'une réunion de la Société chimique russe. Il a exposé son hypothèse sur la formation du pétrole. Le scientifique pensait que lors des processus de formation des montagnes, l’eau s’écoulait profondément dans la croûte terrestre à travers les fissures et les failles. S'infiltrant dans les profondeurs, il finit par rencontrer des carbures de fer et, sous l'influence des températures et de la pression ambiantes, réagit avec eux, entraînant la formation d'oxydes de fer et d'hydrocarbures, comme l'éthane. Les substances résultantes remontent le long des mêmes failles dans les couches supérieures de la croûte terrestre et saturent les roches poreuses. C’est ainsi que se forment les gisements de gaz et de pétrole.
Dans son raisonnement, Mendeleïev fait référence à des expériences de production d'hydrogène et d'hydrocarbures insaturés en exposant de la fonte contenant une quantité suffisante de carbone à l'acide sulfurique.
Certes, les idées du « pur chimiste » Mendeleïev n'ont initialement pas eu de succès auprès des géologues, qui pensaient que les expériences menées en laboratoire étaient très différentes des processus se produisant dans la nature.
Cependant, de manière inattendue, la théorie du carbure ou, comme on l'appelle aussi, la théorie abiogénique sur l'origine du pétrole a reçu de nouvelles preuves - de la part des astrophysiciens. Des études sur les spectres des corps célestes ont montré que des composés de carbone et d'hydrogène se trouvent dans l'atmosphère de Jupiter et d'autres grandes planètes, ainsi que dans les coquilles gazeuses des comètes. Eh bien, puisque les hydrocarbures sont répandus dans l'espace, cela signifie que dans la nature, il existe encore des processus de synthèse de substances organiques à partir de substances inorganiques. Mais c’est précisément sur cela que repose la théorie de Mendeleïev.
Il existe donc aujourd’hui deux points de vue sur la nature de l’origine du pétrole. L’un est biogénique. Selon lui, le pétrole serait formé à partir de restes d’animaux ou de plantes. La deuxième théorie est abiogénique. Il a été développé en détail par D.I. Mendeleev, qui a suggéré que le pétrole dans la nature pouvait être synthétisé à partir de composés inorganiques.
Et bien que la plupart des géologues adhèrent encore à la théorie biogénique, les échos de ces controverses ne se sont pas encore apaisés à ce jour. Le prix de la vérité dans cette affaire est trop élevé. Si les partisans de la théorie biogénique ont raison, la crainte est également vraie que les réserves de pétrole apparues il y a longtemps ne viennent bientôt à épuisement. Si la vérité est du côté de leurs adversaires, alors ces craintes sont probablement vaines. Après tout, les tremblements de terre conduisent encore aujourd'hui à la formation de failles dans la croûte terrestre, il y a suffisamment d'eau sur la planète, son noyau, selon certaines données, est constitué de fer pur... En un mot, tout cela nous permet d'espérer que le pétrole se forme aujourd'hui dans les profondeurs, ce qui signifie qu'il n'y a rien à craindre qu'il puisse s'arrêter demain.
Voyons quels arguments les partisans de l'une et de l'autre hypothèse avancent pour défendre leurs points de vue.
Mais d’abord, quelques mots sur la structure de la Terre. Cela nous aidera à comprendre rapidement les constructions logiques des scientifiques. En termes simples, la Terre est constituée de trois sphères situées les unes dans les autres. La coque supérieure est la croûte terrestre solide. Le manteau est situé plus profondément. Et enfin, au centre même se trouve le noyau. Cette division de la matière, amorcée il y a 4,5 milliards d’années, se poursuit encore aujourd’hui. Il y a d'intenses échanges de chaleur et de masse entre la croûte, le manteau et le noyau, avec toutes les conséquences géologiques qui en découlent : tremblements de terre, éruptions volcaniques, mouvements des continents...
DÉFILÉ INORGANIQUE
Les premières tentatives pour expliquer l’origine du pétrole remontent à l’Antiquité. Par exemple, une déclaration de l'ancien scientifique grec Strabon, qui a vécu il y a environ 2000 ans, a été conservée : « Dans la région des Apolloniens, il y a un endroit appelé Nymphée », écrit-il, « c'est un rocher crachant du feu, et en dessous coulent des sources d'eau chaude et d'asphalte, probablement issues de la combustion de blocs d'asphalte souterrains...".
Strabon a combiné deux faits en un tout : les éruptions volcaniques et la formation d'asphaltes (comme il appelait le pétrole). Et... j'avais tort ! Il n’y a pas de volcans actifs dans les endroits qu’il a mentionnés. Ils n’existaient pas il y a vingt siècles. Ce que Strabon a pris pour des éruptions sont en réalité des explosions, des percées des eaux souterraines (appelées volcans de boue) qui accompagnent la libération de pétrole et de gaz à la surface. Et aujourd’hui, des phénomènes similaires peuvent être observés à Absheron et dans la péninsule de Taman.
Cependant, malgré cette erreur, le raisonnement de Strabon contenait un grain de sel : son interprétation de l’origine du pétrole reposait sur une base matérialiste. Cette ligne a été interrompue pendant longtemps. Ce n'est qu'en 1805, sur la base de ses propres observations faites au Venezuela, sur la description de l'éruption du Vésuve, que le célèbre naturaliste allemand A. Humboldt revint à nouveau au point de vue matérialiste. "... Nous ne pouvons douter", écrit-il, "que le pétrole soit le produit d'une distillation à d'énormes profondeurs et qu'il provienne de roches primitives, sous lesquelles repose l'énergie de tous les phénomènes volcaniques."
La théorie inorganique de l'origine du pétrole s'est cristallisée progressivement, et au moment où Mendeleïev a présenté sa théorie de l'origine des carbures du pétrole, les matières inorganiques avaient accumulé un nombre suffisant de faits et de raisonnements. Et les années suivantes ont ajouté de nouvelles informations à leur collection.
En 1877-1878, des scientifiques français, utilisant de l'acide chlorhydrique sur de la fonte miroir et de la vapeur d'eau sur du fer à chaleur blanche, obtinrent de l'hydrogène et une quantité importante d'hydrocarbures, qui sentaient même le pétrole.
Outre l'hypothèse volcanique, les partisans de l'origine abiogénique du pétrole en ont également une hypothèse cosmique. Le géologue V.D. Sokolov a suggéré en 1889 qu'à cette époque lointaine où notre planète entière était encore un caillot de gaz, des hydrocarbures étaient également présents dans la composition de ce gaz. Au fur et à mesure que les gaz chauds se refroidissaient et passaient en phase liquide, les hydrocarbures se dissolvaient progressivement dans le magma liquide. Lorsque la croûte terrestre solide a commencé à se former à partir de magma liquide, selon les lois de la physique, elle ne pouvait plus contenir d'hydrocarbures. Ils ont commencé à se libérer le long des fissures de la croûte terrestre, ont atteint ses couches supérieures, se condensant et formant ici des accumulations de pétrole et de gaz.
Déjà à notre époque, les deux hypothèses - volcanique et cosmique - ont été combinées en un seul tout par le chercheur de Novossibirsk V. Salnikov. Il a utilisé l'hypothèse que la planète, qui contenait une grande quantité d'hydrocarbures dans sa composition, étant sur une orbite trop basse, était progressivement ralentie par les couches supérieures de l'atmosphère et finissait par tomber sur Terre, comme c'est le cas avec les satellites artificiels. Le choc brutal a intensifié l’activité volcanique et de construction de montagnes. Des milliards de tonnes de cendres volcaniques et de puissantes coulées de boue ont submergé les hydrocarbures apportés de l'espace, les ont enfouis dans les profondeurs profondes, où, sous l'influence de températures et de pressions élevées, ils se sont transformés en pétrole et en gaz.
Pour étayer ses conclusions, Salnikov souligne la localisation inhabituelle des gisements de pétrole et de gaz. En reliant de vastes zones de gisements découverts, il a obtenu un système de lignes sinusoïdales parallèles qui, selon lui, rappelle beaucoup les projections des trajectoires des satellites artificiels de la Terre.
L'histoire des hypothèses inorganiques ne peut être considérée comme complète sans mentionner le célèbre géologue pétrolier N.A. Kudryavtsev. Dans les années 50, il a collecté et résumé d’énormes matériaux géologiques sur les gisements de pétrole et de gaz du monde.
Tout d’abord, Kudryavtsev a attiré l’attention sur le fait que de nombreux gisements de pétrole et de gaz se trouvent sous des zones de failles profondes dans la croûte terrestre. En soi, une telle idée n'était pas nouvelle : D.I. Mendeleïev a attiré l'attention sur cette circonstance. Mais Kudryavtsev a considérablement élargi la géographie d'application de telles conclusions et les a étayées plus profondément.
Par exemple, dans le nord de la Sibérie, dans la zone dite du puits Markhininsky, les fuites de pétrole à la surface sont très courantes. Jusqu'à une profondeur de deux kilomètres, toutes les roches sont littéralement saturées de pétrole. Dans le même temps, comme l'a montré l'analyse, la quantité de carbone formée simultanément avec la roche est extrêmement faible - 0,02 à 0,4 %. Mais à mesure que l'on s'éloigne du puits, la quantité de roches riches en composés organiques augmente, mais la quantité de pétrole diminue fortement.
Sur la base de ces données et d'autres, Kudryavtsev affirme que le potentiel pétrolier et gazier de la houle de Markhininsky n'est très probablement pas associé à de la matière organique, mais à une faille profonde, qui fournit du pétrole provenant des entrailles de la planète.
Des formations similaires existent dans d’autres régions du monde. Par exemple, dans l'État du Wyoming (États-Unis), les habitants chauffent depuis longtemps leurs maisons avec des morceaux d'asphalte qu'ils extraient des fissures des montagnes des Copper Mountains voisines. Mais les granites eux-mêmes, qui composent ces montagnes, ne peuvent pas accumuler de pétrole et de gaz. Ces minéraux ne peuvent provenir des profondeurs de la terre que par les fissures formées.
De plus, des traces de pétrole ont été trouvées dans des cheminées de kimberlite, celles-là mêmes dans lesquelles la nature synthétisait les diamants. De tels canaux de fracture explosive de la croûte terrestre, formés à la suite de la percée de gaz profonds et de magma, peuvent s'avérer être un endroit tout à fait approprié pour la formation de pétrole et de gaz.
En résumant ces faits et bien d'autres, Kudryavtsev a créé son hypothèse magmatique sur l'origine du pétrole. Dans le manteau terrestre, sous pression et à haute température, les radicaux hydrocarbonés CH, CH2 et CH3 se forment d'abord à partir du carbone et de l'hydrogène. Ils se déplacent dans le manteau des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Et comme la différence de pression est particulièrement perceptible dans la zone de faille, le carbone est principalement dirigé ici. En s'élevant dans les couches de la croûte terrestre, les hydrocarbures des zones moins chauffées réagissent entre eux et avec l'hydrogène pour former du pétrole. Ensuite, le liquide résultant peut se déplacer verticalement et horizontalement le long des fissures de la roche, s'accumulant dans des pièges.
Sur la base de concepts théoriques, Kudryavtsev a conseillé de rechercher du pétrole non seulement dans les couches supérieures, mais aussi plus profondément. Cette prévision se confirme brillamment et la profondeur de forage augmente chaque année.
Au milieu des années 60, il était possible de répondre à une question aussi importante : « Pourquoi les composés d'hydrocarbures « délicats » qui composent le pétrole ne se désintègrent-ils pas dans les entrailles de la Terre en éléments chimiques à haute température ? En effet, une telle décomposition peut facilement être observée même dans un laboratoire scolaire. Le raffinage destructeur du pétrole est basé sur de telles réactions. Il s'est avéré que dans la nature, la situation est exactement le contraire : des composés complexes sont formés à partir de composés simples... La modélisation mathématique des réactions chimiques a prouvé qu'une telle synthèse est tout à fait acceptable si l'on ajoute des pressions élevées à des températures élevées. Comme on le sait, les deux sont disponibles en abondance dans les entrailles de la terre.
Les experts perçoivent différemment les prévisions largement répandues concernant l'épuisement imminent (dans 30 à 50 ans) des réserves de pétrole. La plupart avec respect (« c’est ainsi »), d’autres avec scepticisme (« les réserves de pétrole sont illimitées ! »), et d’autres encore avec regret (« cela pourrait durer des siècles… »). « Popular Mechanics » a décidé de se pencher sur cette question.

Formation de pétrole selon la théorie biogénique

Les volumes de production pétrolière du champ White Tiger, sur le plateau vietnamien, ont dépassé les prévisions les plus optimistes des géologues et ont inspiré de nombreux travailleurs du pétrole avec l'espoir que d'énormes réserves d'« or noir » sont stockées à de grandes profondeurs.

1494−1555 : Georgius Agricola, médecin et métallurgiste. Jusqu'au XVIIIe siècle, il existait de nombreuses versions curieuses sur l'origine du pétrole (de la « graisse de la terre sous l'influence des eaux du Déluge », de l'ambre, de l'urine de baleine, etc.). En 1546, George Agricola a écrit que le pétrole est d'origine inorganique et que les charbons se forment par son épaississement et sa solidification.

1711−1765 : Mikhaïlo Vassilievitch Lomonosov, scientifique encyclopédiste - chimiste, physicien, astronome, etc. L'un des premiers à exprimer un concept scientifiquement fondé sur l'origine du pétrole à partir de résidus végétaux soumis à la carbonisation et à la pression dans les couches de la terre (« Sur les couches de la terre », 1763) : « Les matières huileuses brunes et noires sont expulsées des charbons préparés par la chaleur souterraine... »

1834−1907 : Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, chimiste, physicien, géologue, météorologue, etc. Dans un premier temps, il partage l'idée del'origine organique du pétrole (résultat de réactions se produisant à de grandes profondeurs, à haute température et pressions, entre le fer carboné et l'eau suintant de la surface du sol). Plus tard, nous avons adhéré à la version « inorganique »

1861−1953 : Nikolai Dmitrievich Zelinsky, chimiste organique. A apporté une contribution significative à la résolution du problème de l’origine du pétrole. Il a été démontré que certains composés carbonés qui font partie des animaux et des plantes, à basse température et dans des conditions appropriées, peuvent former des produits similaires au pétrole en termes de composition chimique et de propriétés physiques.

1871−1939 : Ivan Mikhaïlovitch Gubkine, géologue pétrolier. Fondateur de la géologie pétrolière soviétique, partisan de la théorie biogénique. Il a résumé les résultats des études sur la nature du pétrole et est arrivé à la conclusion : le processus de sa formation est continu ; les zones de la croûte terrestre qui étaient instables dans le passé aux limites des zones d'affaissement et de soulèvement sont les plus favorables à la formation de pétrole
En gros, personne ne sait combien d’années dureront les réserves de pétrole. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’à ce jour, personne ne peut dire exactement comment se forme le pétrole, même si ce sujet fait l’objet de débats depuis le XIXe siècle. Les scientifiques, selon leurs convictions, étaient divisés en deux camps.
De nos jours, la théorie biogénique prévaut parmi les spécialistes du monde entier. Il affirme que le pétrole et le gaz naturel se sont formés à partir de restes d’organismes végétaux et animaux au cours d’un processus en plusieurs étapes qui a duré des millions d’années. Selon cette théorie, dont l'un des fondateurs était Mikhaïlo Lomonossov, les réserves de pétrole sont irremplaçables et tous ses gisements seront un jour épuisés. Non renouvelable, bien sûr, compte tenu de la fugacité des civilisations humaines : le premier alphabet et l’énergie nucléaire ne sont séparés que de quatre mille ans, tandis que la formation d’un nouveau pétrole à partir des restes organiques actuels en nécessitera des millions. Cela signifie que nos descendants pas si lointains devront se passer d’abord du pétrole, puis du gaz…
Les partisans de la théorie abiogénique envisagent l’avenir avec optimisme. Ils croient que les réserves de pétrole et de gaz dureront plusieurs siècles. Dmitri Ivanovitch Mendeleev, à Bakou, a appris un jour du géologue Herman Abikh que les gisements de pétrole sont très souvent géographiquement confinés à des failles - un type particulier de fissures dans la croûte terrestre. Dans le même temps, le célèbre chimiste russe est convaincu que les hydrocarbures (pétrole et gaz) sont formés à partir de composés inorganiques en profondeur. Mendeleïev pensait que lors des processus de construction des montagnes, à travers les fissures coupant la croûte terrestre, l'eau de surface s'infiltrait profondément dans la Terre jusqu'aux masses métalliques et réagissait avec les carbures de fer, formant des oxydes métalliques et des hydrocarbures. Les hydrocarbures remontent ensuite à travers les fissures dans les couches supérieures de la croûte terrestre et forment des gisements de pétrole et de gaz. Selon la théorie abiogénique, la formation de nouveau pétrole ne devra pas attendre des millions d’années ; il s’agit d’une ressource entièrement renouvelable. Les partisans de la théorie abiogénique sont convaincus que de nouveaux gisements attendent d'être découverts à de grandes profondeurs, et que les réserves de pétrole actuellement explorées pourraient bien s'avérer insignifiantes par rapport à celles encore inconnues.
À la recherche de preuves
Les géologues sont cependant plus pessimistes qu’optimistes. Au moins, ils ont davantage de raisons de faire confiance à la théorie biogénique. En 1888, les scientifiques allemands Gefer et Engler ont mené des expériences prouvant la possibilité d'obtenir de l'huile à partir de produits d'origine animale. Lors de la distillation de l'huile de poisson à une température de 4 000 °C et une pression d'environ 1 MPa, ils en ont isolé des hydrocarbures saturés, de la paraffine et des huiles lubrifiantes. Plus tard, en 1919, l'académicien Zelinsky, à partir de boues organiques du fond du lac Balkhash, principalement d'origine végétale, a obtenu du goudron brut, du coke et des gaz - méthane, CO, hydrogène et sulfure d'hydrogène lors de la distillation. Il a ensuite extrait de la résine de l’essence, du kérosène et des huiles lourdes, prouvant ainsi expérimentalement que l’huile peut également être obtenue à partir de matières végétales organiques.
Les partisans de l'origine inorganique du pétrole ont dû ajuster leur point de vue : désormais, ils ne nient pas l'origine des hydrocarbures à partir de matière organique, mais croient qu'ils peuvent être obtenus d'une manière alternative, inorganique. Bientôt, ils eurent leurs propres preuves. Des études spectroscopiques ont montré que des hydrocarbures simples sont présents dans l'atmosphère de Jupiter et d'autres planètes géantes, ainsi que de leurs satellites et dans les coquilles gazeuses des comètes. Cela signifie que si dans la nature il existe des processus de synthèse de substances organiques à partir de substances inorganiques, rien n'empêche la formation d'hydrocarbures à partir de carbures sur Terre. Bientôt, d’autres faits furent découverts qui n’étaient pas cohérents avec la théorie biogénique classique. Dans un certain nombre de puits de pétrole, les réserves de pétrole ont commencé à se reconstituer de manière inattendue.
Magie du pétrole
L'un des premiers paradoxes de ce type a été découvert dans un champ pétrolier de la région de Tersko-Sunzha, non loin de Grozny. Les premiers puits ont été forés ici en 1893, sur des sites d'expositions pétrolières naturelles.
En 1895, l'un des puits d'une profondeur de 140 m a produit un énorme jet de pétrole. Après 12 jours de jaillissement, les murs du hangar à pétrole se sont effondrés et le flux de pétrole a inondé les derricks des puits voisins. Seulement trois ans plus tard, il a été possible d'apprivoiser la fontaine, puis elle s'est asséchée et ils sont passés de la méthode de production de pétrole par fontaine à la méthode de pompage.
Au début de la Grande Guerre patriotique, tous les puits étaient abondamment arrosés et certains d'entre eux étaient mis en veilleuse. Après le retour de la paix, la production a été rétablie et, à la surprise générale, presque tous les puits à forte teneur en eau ont commencé à produire du pétrole anhydre ! Inexplicablement, les puits ont reçu un « second souffle ». Après encore un demi-siècle, la situation s'est répétée. Au début des guerres tchétchènes, les puits étaient à nouveau abondamment arrosés, leur débit avait considérablement diminué et pendant les guerres, ils n'étaient pas exploités. Lorsque la production a repris, les cadences de production ont considérablement augmenté. De plus, les premiers petits puits ont recommencé à pomper du pétrole à travers l’anneau jusqu’à la surface de la Terre. Les partisans de la théorie biogénique étaient désemparés, alors que les « inorganiques » expliquaient facilement ce paradoxe par le fait qu'à cet endroit l'huile est d'origine inorganique.
Un phénomène similaire s’est produit dans l’un des plus grands gisements pétroliers du monde, Romashkinskoye, exploité depuis plus de 60 ans. Selon les géologues tatars, 710 millions de tonnes de pétrole pourraient être extraites des puits du gisement. Pourtant, à ce jour, près de 3 milliards de tonnes de pétrole ont déjà été produites ici ! Les lois classiques de la géologie pétrolière et gazière ne peuvent expliquer les faits observés. Certains puits semblaient palpiter : une baisse des taux de production était soudainement remplacée par une augmentation à long terme. Un rythme pulsé a également été constaté dans de nombreux autres puits sur le territoire de l'ex-URSS.
Il est impossible de ne pas évoquer le champ « Tigre Blanc » sur le plateau vietnamien. Dès le début de la production pétrolière, « l’or noir » était extrait exclusivement des couches sédimentaires ; ici, les couches sédimentaires (environ 3 km) étaient forées, pénétraient dans les fondations de la croûte terrestre et le puits coulait. De plus, selon les géologues, environ 120 millions de tonnes pourraient être extraites du puits, mais même après l'extraction de ce volume, le pétrole a continué à couler des profondeurs avec une bonne pression. Ce domaine a soulevé une nouvelle question pour les géologues : le pétrole s’accumule-t-il uniquement dans les roches sédimentaires ou peut-il être contenu dans les roches du socle ? S'il y a aussi du pétrole dans les fondations, alors les réserves mondiales de pétrole et de gaz pourraient être bien plus importantes que nous ne le pensons.
Rapide et inorganique
Qu’est-ce qui provoque le « second souffle » de nombreux puits, inexplicable du point de vue de la géologie classique du pétrole et du gaz ? "Dans le champ de Tersko-Sunzhenskoye et dans quelques autres, le pétrole peut se former à partir de matière organique, mais pas sur des millions d'années, comme le prévoit la géologie classique, mais en quelques années", explique le chef du département de géologie de la Russie. Université d'État du pétrole et du gaz. EUX. Goubkine Viktor Petrovitch Gavrilov. « Le processus de sa formation peut être comparé à la distillation artificielle de la matière organique, semblable aux expériences de Gefer et Zelinsky, mais réalisée par la nature elle-même. Ce taux de formation de pétrole est devenu possible grâce aux caractéristiques géologiques de la région, où, avec la partie inférieure de la lithosphère, une partie des sédiments est attirée dans le manteau supérieur de la Terre. Là, dans des conditions de températures et de pressions élevées, se produisent des processus rapides de destruction de la matière organique et de synthèse de nouvelles molécules d’hydrocarbures.
Sur le terrain de Romashkinskoye, selon le professeur Gavrilov, un mécanisme différent fonctionne. Ici, dans l'épaisseur des roches cristallines de la croûte terrestre, au sous-sol, se trouve une épaisse couche de gneiss à haute teneur en alumine vieille de plus de 3 milliards d'années. Ces roches anciennes contiennent beaucoup (jusqu'à 15 %) de graphite, à partir duquel des hydrocarbures se forment à haute température en présence d'hydrogène. Le long des failles et des fissures, ils s'élèvent dans la couche sédimentaire poreuse de la croûte.
Il existe un autre mécanisme permettant de reconstituer rapidement les réserves d'hydrocarbures, découvert dans la province pétrolière et gazière de Sibérie occidentale, où sont concentrées la moitié de toutes les réserves d'hydrocarbures de Russie. Ici, selon le scientifique, dans la vallée du Rift enfouie de l'océan antique, des processus de formation de méthane à partir de matières inorganiques se sont produits et se produisent, comme chez les « fumeurs noirs » (voir encadré). Mais la vallée du rift locale est obstruée par des sédiments, ce qui empêche la dispersion du méthane et le concentre dans des réservoirs rocheux. Ce gaz a alimenté et continue d’alimenter toute la plaine de Sibérie occidentale en hydrocarbures. Ici, le pétrole se forme rapidement à partir de composés organiques. Alors, y aura-t-il toujours des hydrocarbures ici ?
"Si nous construisons notre approche du développement des champs sur de nouveaux principes", répond le professeur, "nous coordonnons le taux d'extraction avec le taux de réception des hydrocarbures des centres de production de ces zones, les puits fonctionneront pendant des centaines d'années".
Mais c’est un scénario trop optimiste. Les réalités sont plus cruelles : pour que les réserves soient reconstituées, l’humanité devra abandonner les technologies d’extraction « violentes ». En outre, il sera nécessaire d'introduire des périodes spéciales de réhabilitation, abandonnant temporairement l'exploitation des gisements. Pouvons-nous y parvenir face à une population mondiale croissante et à des besoins croissants ? À peine. Après tout, hormis l’énergie nucléaire, le pétrole n’a pas encore d’alternative valable.
Dmitri Ivanovitch Mendeleev a déclaré au siècle dernier que brûler du pétrole était comme brûler un fourneau avec des billets de banque. Si le grand chimiste vivait aujourd’hui, il nous qualifierait probablement de génération la plus folle de l’histoire de la civilisation. Et peut-être que je me trompe : nos enfants peuvent encore nous surpasser. Mais les petits-enfants n’auront probablement jamais une telle chance…
Il existe essentiellement deux théories sur l’origine du pétrole et du gaz : organique (migration sédimentaire) et inorganique (abiogène). Il convient de noter d'emblée que l'écrasante majorité des scientifiques et géologues pétroliers qui effectuent pratiquement la recherche de pétrole et de gaz sont favorables à la théorie de l'origine organique du pétrole. Cependant, certains scientifiques de notre pays défendent la genèse abiogénique du pétrole.
La base de la théorie de l'origine inorganique du pétrole et du gaz a été posée en 1877 par le grand scientifique russe D.I. Mendeleïev.
D.I. Mendeleïev pensait que les hydrocarbures se formaient profondément dans les entrailles de la Terre grâce à l'interaction des carbures de métaux lourds avec l'eau provenant de la surface le long des failles. Puis, sous la pression de la vapeur surchauffée, le mélange de ces hydrocarbures remonte le long des mêmes failles jusqu'à la partie supérieure de la croûte terrestre. De faibles pressions et des températures nettement plus basses règnent ici, de sorte que les hydrocarbures gazeux se condensent et forment des accumulations.
Les objections les plus convaincantes à la théorie des carbures de D. I. Mendeleïev ont été exprimées par I. M. Gubkin. Premièrement, il n’y a pas de failles dans la croûte terrestre qui pénètrent dans le manteau et même dans le noyau jusqu’à une profondeur de 2 900 km ; deuxièmement, il n'a pas été prouvé que les roches profondes contiennent des carbures métalliques.
Des facteurs biologiques et chimiques militent également contre l’origine inorganique des hydrocarbures. Il existe de nombreuses objections motivées de ce type.
N. B. Vassoevich avance un argument convaincant en faveur de l'origine biologique des composés carbonés contenus dans les roches anciennes. Il souligne que dans la nature, il existe deux isotopes du carbone - 12 C et 13 C, et que dans les organismes vivants, il y a moins d'isotope 13 C que dans les minéraux. La carence en isotope 13 C dans le pétrole résout clairement la question de son lien avec la nature vivante.
A.I. Kravtsov estime que le pétrole aurait pu se former à partir du méthane, mais le méthane lui-même n'est pas le résultat de la décomposition de la matière organique d'origine animale, mais de la synthèse de l'hydrogène et du monoxyde ou dioxyde de carbone provenant des profondeurs sous-crustales de la Terre le long de failles profondes pouvant être attribuées au manteau. De plus, A.I. Kravtsov fournit des données selon lesquelles, tout au long de l'histoire de la Terre, l'activité volcanique était en moyenne égale à l'activité moderne et donne l'exemple suivant. En 83 millions d'années, 9,0 * 10 19 t H 2, 2,7 * 10 11 t CO, 2,7 * 10 11 t CH 4, 9,0 * 10 14 t CO ont été remontés à la surface sur les seules îles Kouriles 2. Il affirme ensuite que les molécules de méthane sont capables de polymériser en hydrocarbures lourds sous l'action catalytique des silicates, ainsi qu'en oxydes de fer et de nickel contenus dans les roches. Selon le même scientifique, la plupart des accumulations initiales d'hydrocarbures sont représentées principalement par le méthane et ses homologues légers - le « gaz sec », se transformant progressivement en condensat constitué de « gaz liquide » ; ces dernières se transforment ensuite en essences légères qui, dans des conditions thermodynamiques appropriées, deviennent de plus en plus lourdes jusqu'à se transformer en bitume. On conclut donc que les régions gazières et pétrolières ne devraient pas être associées à des bassins sédimentaires, mais à des zones de failles profondes pénétrant dans le manteau et facilitant la libération des gaz.
Ce sont les idées modernes de l’un des partisans de l’origine inorganique (abiogène) du pétrole et du gaz.
La théorie de l'origine organique du pétrole a été développée avec succès par I.M. Gubkin. Selon lui, la matière première pour la formation du pétrole est les graisses, la cire et d'autres composés, et le charbon - la lignine, les fibres, etc. Dans un environnement oxydant (avec accès à l'oxygène), la matière organique est transformée en charbon et dans un environnement réducteur - en hydrocarbures pétroliers.
Ces dernières années, de nombreux scientifiques ont étudié avec succès le problème de l’origine du pétrole. La théorie de N.B. Vassoevich sur sa formation sédimentaire-migration est particulièrement intéressante. Selon l'auteur de cette théorie, le pétrole se forme dans les roches sédimentaires sous la forme d'une substance bitumineuse uniformément dispersée, qu'il appelle micro-huile, à partir de plancton contenant des corps gras. La teneur totale en hydrocarbures dispersés dans le secteur continental de la stratisphère est d'environ (70÷80) 10 12 m. Par la suite, à mesure que la profondeur des strates sédimentaires mères augmente, la « maturation » du micro-pétrole se produit. Les principaux facteurs qui stimulent ce processus sont la température, le temps d'exposition et la pression. La phase principale de formation du pétrole est caractérisée par une plage de température de 60 à 150°C et une pression de 15 à 45 MPa. De telles conditions sont généralement observées à une profondeur de 1 500 à 5 000 m. Au cours de la phase principale, non seulement des hydrocarbures liquides se forment, mais également des conditions sont créées pour leur émigration à partir des roches mères.
Selon I. O. Brod et N. B. Vassoevich, les zones pétrolifères et gazières sont des dépressions dans la croûte terrestre, communément appelées bassins de roches sédimentaires. Ces bassins se sont formés sur des millions et des dizaines de millions d’années. N.B. Vassoevich et d'autres scientifiques indiquent que les superficies de ces dépressions atteignent plusieurs milliers, voire centaines de milliers de kilomètres carrés, et que les volumes de roches qui les remplissent varient de n10 3 à n10 6 km 3. Ces bassins sont le berceau du pétrole.
Parallèlement à la formation de pétrole, le processus de génération de gaz d'hydrocarbures se produit.
Les travaux d'exploration menés chaque année dans les bassins sédimentaires des continents assurent une augmentation des réserves de pétrole et de gaz. Le pétrole et le gaz se cachent au fond des mers, dans des bassins sédimentaires développés presque partout dans la zone du plateau (et de la pente continentale) autour des continents.
Pour résumer la discussion sur l'origine du pétrole et du gaz, il convient de souligner que la principale source de leur formation est la matière carbonée enfouie dans les roches sédimentaires. Actuellement, un matériel factuel et expérimental important, convaincant et soigneusement vérifié a été accumulé sur cette question.
Ainsi, la théorie de l’origine organique, ou migration sédimentaire, du pétrole et du gaz est la plus acceptable. Lors de la prévision de la teneur en pétrole et en gaz du sous-sol et lors de la recherche de pétrole et de gaz, les géologues sont généralement guidés par la théorie décrite ci-dessus.
Lire aussi...
- Comptabilité fiscale dans une organisation
- Gagner de l'argent en rachetant les dettes d'autrui. Façons de gagner de l'argent sur les créances des particuliers
- La notion de bénéfice non distribué et son affichage au bilan
- Combien de chars sont en service dans les forces terrestres des forces armées russes ?